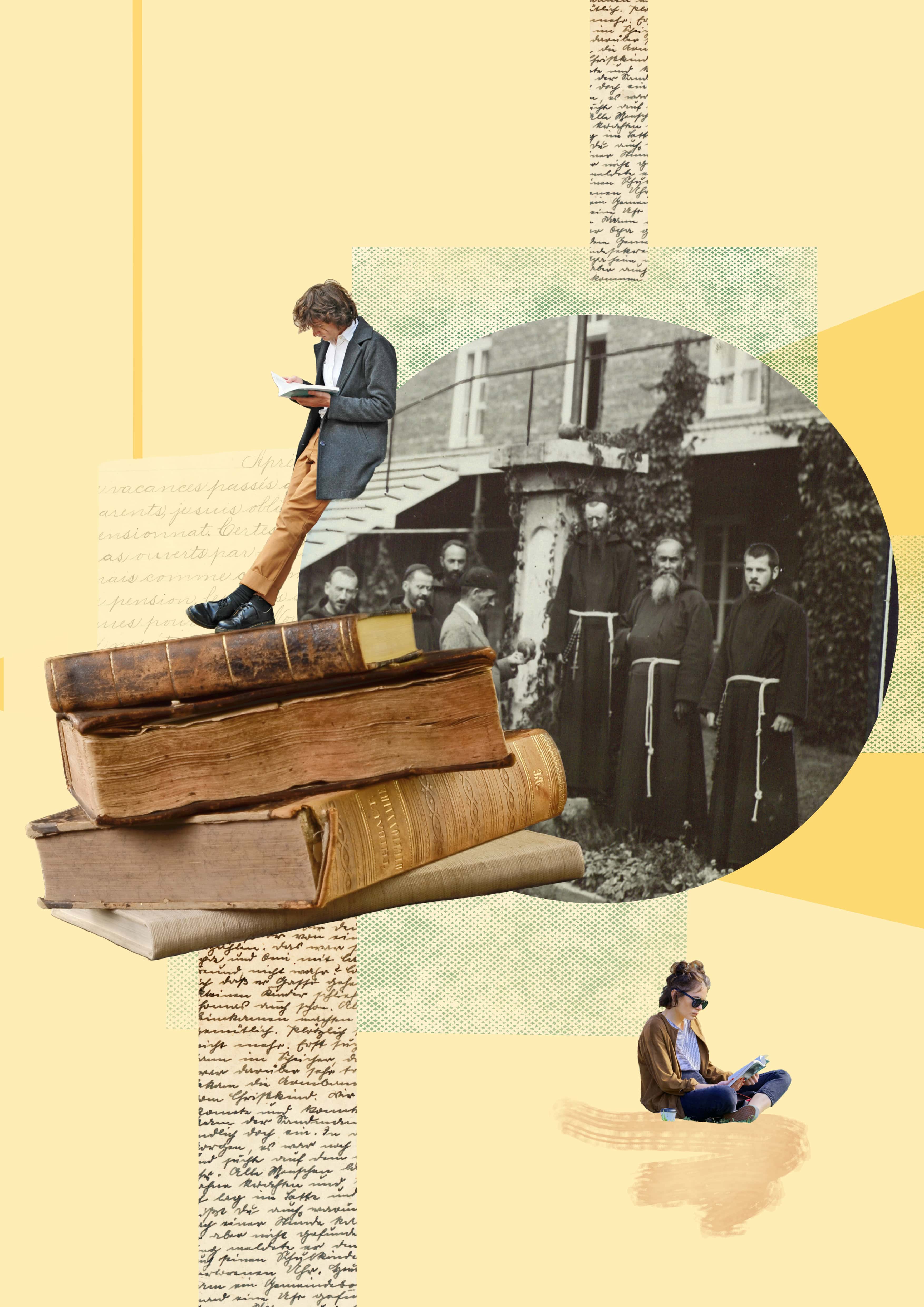
Sauvons les livres!
Le patrimoine imprimé des communautés religieuses du Québec est en mouvement. En recherche de solutions pour conserver une partie essentielle de l'histoire du Québec et de l'Église, des archivistes, bibliothécaires et religieux trouvent des solutions surprenantes et novatrices. Entre deuil et espérance, un processus de legs où la transmission est à échelle humaine. Le Verbe vous offre une entrée VIP dans les coulisses du patrimoine.
Je suis déjà en retard et j'arrive en nage à la bibliothèque de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), étrangement convaincue que les livres ne m'attendront pas. N’ont-ils pas, bien au contraire, l’habitude d’attendre les intéressés et les curieux en tout genre?
En longeant les corridors qui mènent à la bibliothèque, je ne peux m'empêcher de relever l’ironie de la rencontre entre les livres anciens des communautés religieuses et un établissement connu pour son appui aux élans de la Révolution tranquille.
Si l'UQAM a davantage l'habitude de recueillir les collections qui proviennent de collectivités, soit du travail collaboratif au sein d’institutions d’intérêt public, son attrait pour le patrimoine religieux est plus récent. Entre ses murs se trouvent notamment celle du Collège Sainte-Marie (un collège jésuite), celles de l'École des Beaux-arts de Montréal et de l'École normale Jacques-Cartier – pour la formation des maitres.
Une fois arrivée, je suis accueillie par Hugues Ouellet, bibliothécaire responsable des livres rares à l'UQAM. Il me présente son domaine, sur lequel il règne avec fierté: les livres anciens du Québec, c'est-à-dire ceux antérieurs à 1850. Ces merveilles, cachées pour la plupart, n’ont plus aucun secret pour lui. Elles ont longtemps circulé au sein des communautés religieuses à divers desseins: l'éducation des prêtres et des religieux, l'éducation des élèves dans les collèges classiques, ou encore la conservation de volumes rares pour le prestige et l'intérêt de la communauté. Il est temps de mettre tous ces trésors à la disposition du public.
Une collaboration de haut niveau
À l'UQAM, le succès de l’exposition Franciscana, résultat d'une collaboration étroite entre les franciscains et la bibliothèque de l'université, a ouvert la voie à un projet semblable avec les capucins, arrivés au Québec en 1890. La pensée et l'influence de cette communauté perdurent désormais à travers près de 500 documents anciens conservés à l'UQAM. Parmi ceux-ci, notons un incunable, c'est-à-dire un ouvrage imprimé avant 1500 et tiré à peu d'exemplaires, du théologien et exégète Nicolas de Lyre. Il a été publié en 1489! Certains exemplaires datent aussi du XVIe au XIXe siècle.
L’assemblage d’une collection patrimoniale est un processus de longue haleine, nous confie le bibliothécaire. Les religieux et les religieuses sélectionnent d’abord «les choses les plus précieuses ou plus significatives» qu’ils désirent transmettre. Les livres et les objets doivent ensuite être soigneusement mis dans des boites et apportés dans les lieux de conservation de l'UQAM, un environnement contrôlé qui assure la longue vie des livres. Ainsi, les étagères jadis fréquentées par les frères se retrouvent vides et un deuil s'amorce.
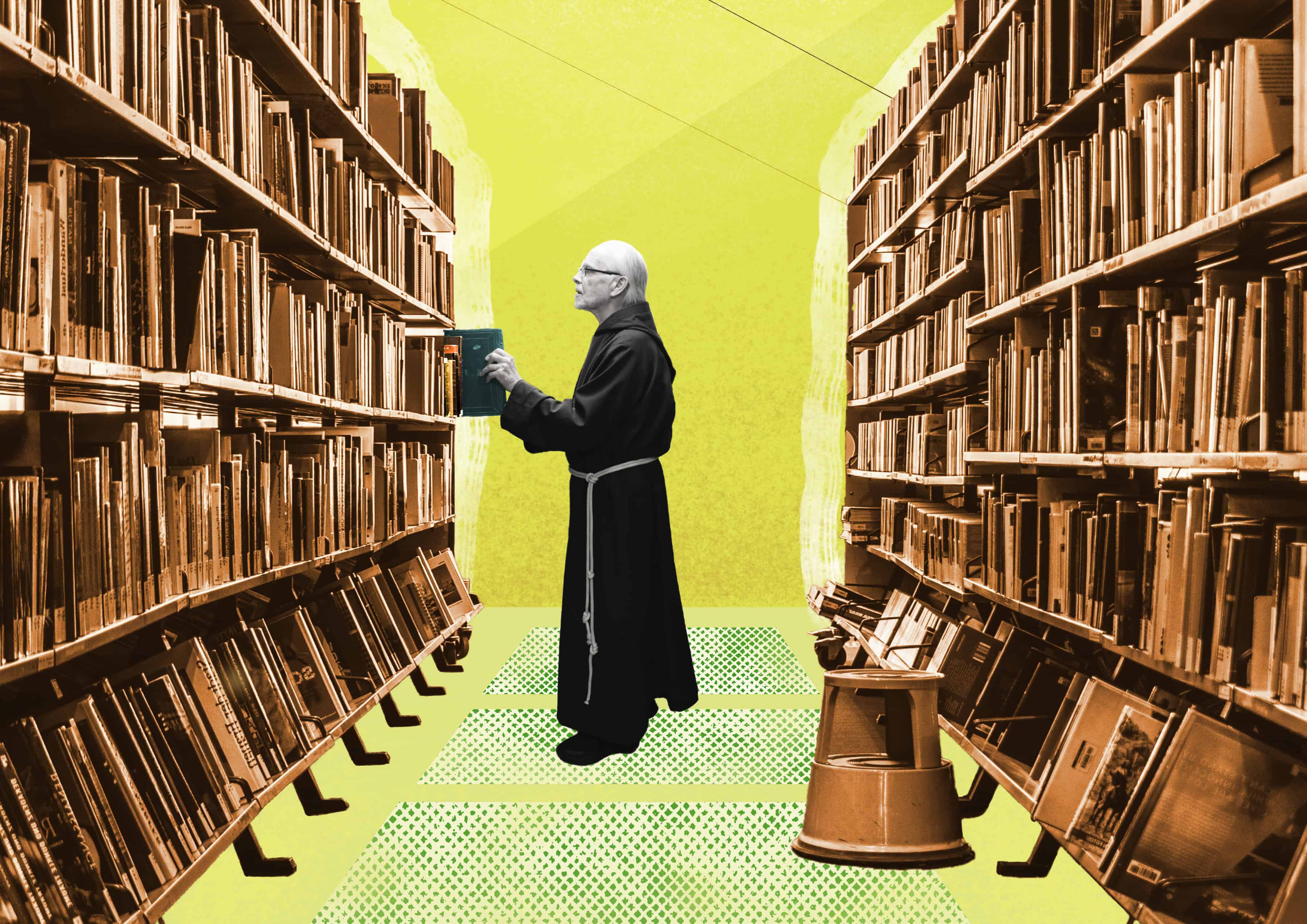 Illustration: Caroline Dostie
Illustration: Caroline Dostie
D’un univers à l’autre
Plusieurs communautés religieuses sont «des organisations qui gèrent la décroissance», nous dit Hugues Ouellet. L'UQAM espère pouvoir non seulement accueillir des livres dans ce processus, mais aussi créer des liens qui établissent une véritable transmission à échelle humaine.
Les capucins proviennent d'un contexte culturel francophone québécois qui représente une certaine forme de collectivité, la communauté religieuse. L'UQAM, quant à elle, est laïque et accueille dans sa communauté les étudiants, les chercheurs et les professeurs ainsi que le grand public. Ce passage d'une collectivité à l'autre fascine Hugues Ouellet: «C'est un peu ça aussi qui est merveilleux dans ce genre de projet: on a une transmission d'un univers culturel vers un autre univers culturel où ça peut se poursuivre autrement.»
Le frère capucin André Chicoine parle avec enthousiasme de la portée de ce don pour sa communauté. Les capucins doivent en effet réduire leurs biens mobiliers, mais ils refusent de délaisser ces livres dont ils ont la garde depuis si longtemps. Ancien missionnaire au Tchad pendant la guerre civile, ce frère parle avec la même vivacité de l'aventure de la mission que de celle de la conservation. Il a choisi de reprendre le dossier de ce don de livres il y a un peu moins de deux ans «pour permettre justement que la tradition, que le savoir puisse se poursuivre dans un milieu plus idéal». Il espère par ce geste intéresser le grand public à la pensée des capucins, si riche d’un point de vue tant historique que spirituel.
C'est le propre des communautés religieuses que de prendre en charge l'avenir de leur patrimoine, mais cela demande beaucoup de travail et d'initiative de la part des religieux et des religieuses. La gestion de l’héritage de leur communauté en déclin n’est pas une responsabilité qu’ils pensaient devoir assumer au début de leur vocation, c’est très difficile pour eux. Avec l’humilité typique de ces gestionnaires par défaut, le frère Chicoine avoue en toute simplicité: «Vous n'avez pas devant vous un expert, mais quelqu'un qui sensibilise, qui veut faire sa petite part dans cette démarche
Une autre éducation
Si j’ai été charmée par l’humilité du frère capucin, c’est la détermination et l’érudition qui me surprennent chez Catherine Foisy, professeure en sciences des religions à l'UQAM. Son arrière-plan Zoom qui montre toute une panoplie de jeux d'enfants révèle qu’elle est aussi jeune maman. J’ai devant moi une vraie passionnée de la transmission du savoir, à tous les points de vue!
Elle a collaboré à l'initiative de l'UQAM en favorisant l'accès à ces livres rares pour ses étudiants et en les remettant en contexte pour eux. Ces derniers, dont une majorité se prépare à l'enseignement au secondaire du cours de culture et citoyenneté québécoise, se sentent souvent perdus devant les objets religieux et les riches collections de livres issues de l'héritage catholique. «Je trouvais important de les mettre en contact avec le réel. Le réel, c'est entre autres les archives, les bibliothèques, les livres.»
Ces livres sont aussi d’intéressants outils pédagogiques pour présenter la tradition catholique du Québec aux prêtres immigrants. Ils sont souvent «parachutés» au Québec avec très peu d'informations sur la manière dont a été vécue la foi catholique par le passé. Lors d’une conférence qu’elle donnait à l'Association des trésorières et des trésoriers des instituts religieux (ATTIR), madame Foisy a constaté que plusieurs des membres présents ignoraient malheureusement l'ampleur de cet héritage.
 Illustration: Caroline Dostie
Illustration: Caroline Dostie
Un tournant dans la gestion des archives
Catherine Foisy situe la gestion des archives plus largement dans un contexte socioecclésial. Cette gestion doit être soutenue non seulement par des institutions laïques comme l'UQAM et le gouvernement provincial, mais aussi par le clergé. «Je trouve qu'il manque énormément de leadeurship du point de vue épiscopal sur ces questions-là, sur la question du patrimoine», m'avoue-t-elle. Elle relève aussi le fait que le gouvernement provincial revendique plus facilement cet héritage catholique en discours qu'en actions concrètes.
Elle n'est pas la seule à témoigner que ce nouvel élan est bienvenu dans le milieu des archives. Au début des années 2000, un refroidissement à l'égard de l'héritage documentaire de l'Église a été observé, en raison notamment de sentiments anticléricaux qui ont failli effacer complètement certains documents. Depuis quelques années, cette tendance s’inverse enfin grâce à des acteurs particulièrement vigoureux, comme l'UQAM.
Si l'urgence est la même un peu partout, les démarches, elles, varient. Certaines communautés déposent des documents dans des centres d'archives privés en quittant leur résidence, comme les Sœurs de Sainte-Anne ont déposé les leurs au Centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges. Les Sulpiciens, dont la collection est sans doute la plus grande et la plus complexe à conserver, demeurent malheureusement dans un certain statuquo pour le moment. Le résultat jusqu'à nouvel ordre est un catalogue en ligne inaccessible et un accès en personne couteux et limité. Cela dit, la numérisation des ouvrages les plus précieux est prévue prochainement ainsi que l'arrivée d'un nouveau catalogue plus performant. Des visites guidées de la bibliothèque sont également offertes, mais il y a une liste d'attente.
D'autres collections, ou parties de collections, ont été inscrites dans un catalogue numérique dans le cadre du projet d'Inventaire des imprimés anciens du Québec (IMAQ). C’est le cas de celles de l’abbaye Saint-Benoît-du-Lac et de l'Oratoire Saint-Joseph. L'accès sur place demeure une option, mais il n'est pas aussi aisé.
Est-ce que certains s'en sortent mieux que d'autres? La professeure Catherine Foisy remarque que les congrégations féminines ont généralement une gestion plus proactive de leurs archives. Les Sœurs grises, les Ursulines et les Augustines ont même connu le succès dans leur démarche, comme en témoignent leurs musées respectifs. C'est également le cas chez les religieuses hospitalières de Saint-Joseph à Montréal, les Sœurs de la congrégation de Notre-Dame et les sœurs des Saints Noms de Jésus et Marie, trois communautés qui ont influencé la formation de la Fondation archives et patrimoine religieux du Grand Montréal (FAR).
La Fondation archives et patrimoine religieux du Grand Montréal (FAR) est une initiative sans but lucratif créée sur mesure pour les besoins des communautés religieuses.
Lancée en 2014, elle regroupe 14 communautés religieuses qui désirent centraliser leurs archives. On y rassemble principalement les «documents constitutifs et historiques des congrégations et, dans la plupart des cas, ceux des administrations générales et locales». S'ajoutent à cela des archives personnelles, des livres de fondateurs, quelques livres anciens ainsi que des œuvres d'art et des objets liturgiques.
L'ouverture du centre, situé dans l'ancienne Maison de prière de la Congrégation de Notre-Dame à Longueuil, est prévue au début de 2026.
Une oasis dans le désert
Céline Widmer, directrice des archives du FAR, explique que ces communautés ont «leur propre cheminement, leur propre histoire et leurs propres initiatives. La mise en commun [de leurs archives] devient ainsi très intéressante pour les gens qui s'intéressent au patrimoine religieux». Dans un milieu où il est complexe pour un chercheur, et plus encore pour un membre du grand public, d'avoir accès aux collections documentaires des communautés, cette initiative facilitera grandement les recherches sur leur histoire.
L'enthousiasme de la directrice pour le projet est évident, notamment dans sa manière de situer l'unicité des documents, tableaux et autres objets précieux pour les communautés, comme des journaux personnels et des objets de prière. Ces derniers, même si ce ne sont pas des livres anciens dont la valeur est plus spontanément reconnue, sont précieux pour la postérité, puisque c'est leur histoire humaine qu'il s'agit de transmettre.
Les archivistes aident les communautés à choisir les éléments de leur legs sans le faire à leur place. Si ces dernières peuvent avoir une forte tendance à la modestie, leurs membres sont encouragés à conserver les documents et les objets qui leur sont chers, car ce sont eux qui permettront à l'équipe du FAR et aux visiteurs de bien comprendre l'histoire des communautés, le contexte historique de l'époque. Le FAR présentera diverses collections à partir de 2026 pour mettre en relief le rôle des communautés dans les paroisses, par exemple, ou encore pour permettre aux visiteurs de manipuler certaines archives au sein de leur collection pédagogique.
*
En sondant les acteurs du milieu, il est évident que les préoccupations des religieux font écho à celles des archivistes. Les premiers cherchent à relocaliser leurs vastes collections de livres ainsi que leurs archives personnelles dans un contexte où ils doivent vendre leurs biens immobiliers; les seconds, à protéger l'héritage historique du Québec. La part des communautés religieuses dans cette démarche est essentielle. Il y a lieu d'espérer que cette amitié se poursuivra jusqu'au réveil d'un intérêt plus étendu pour cette partie de notre histoire collective.













