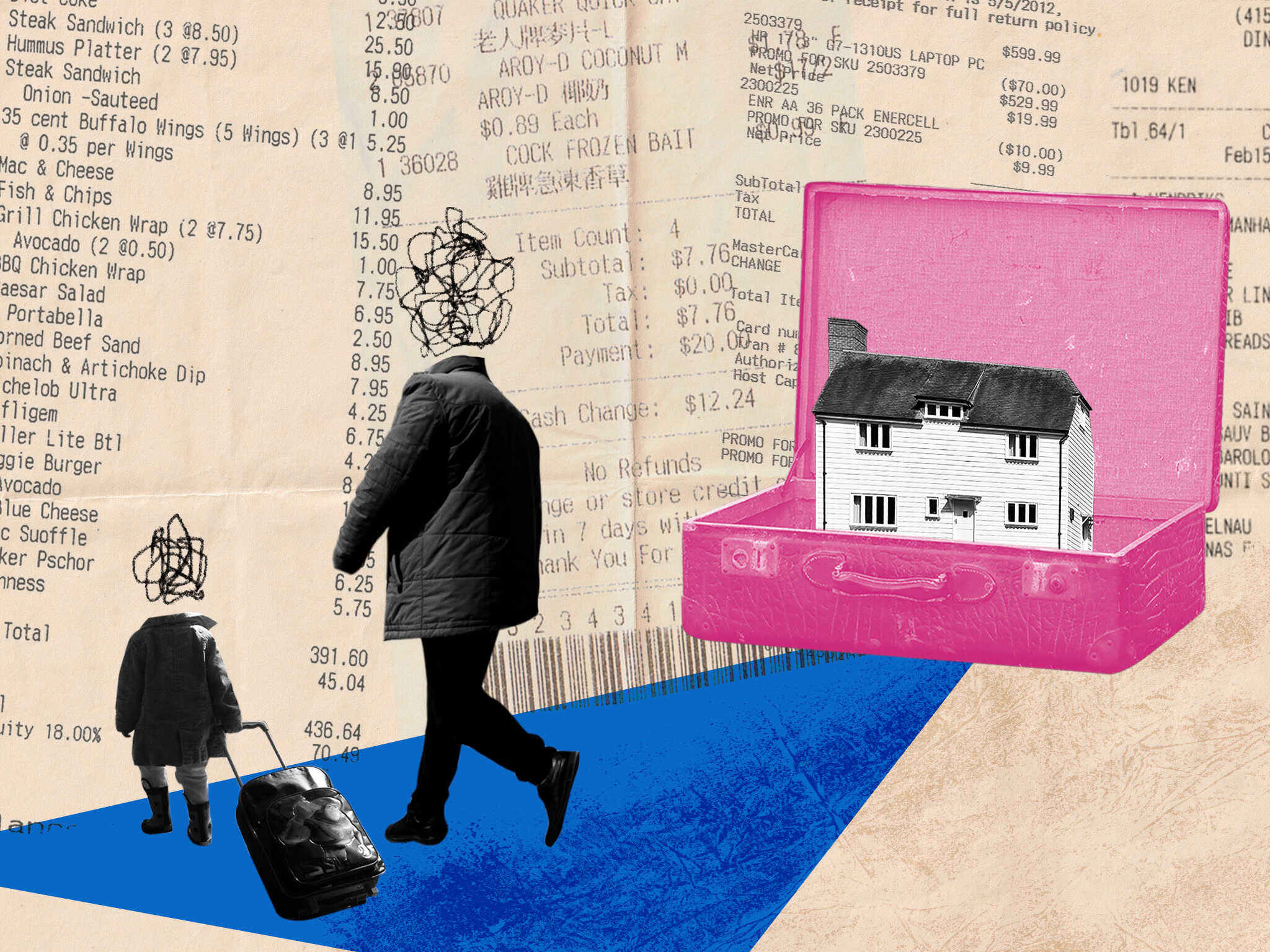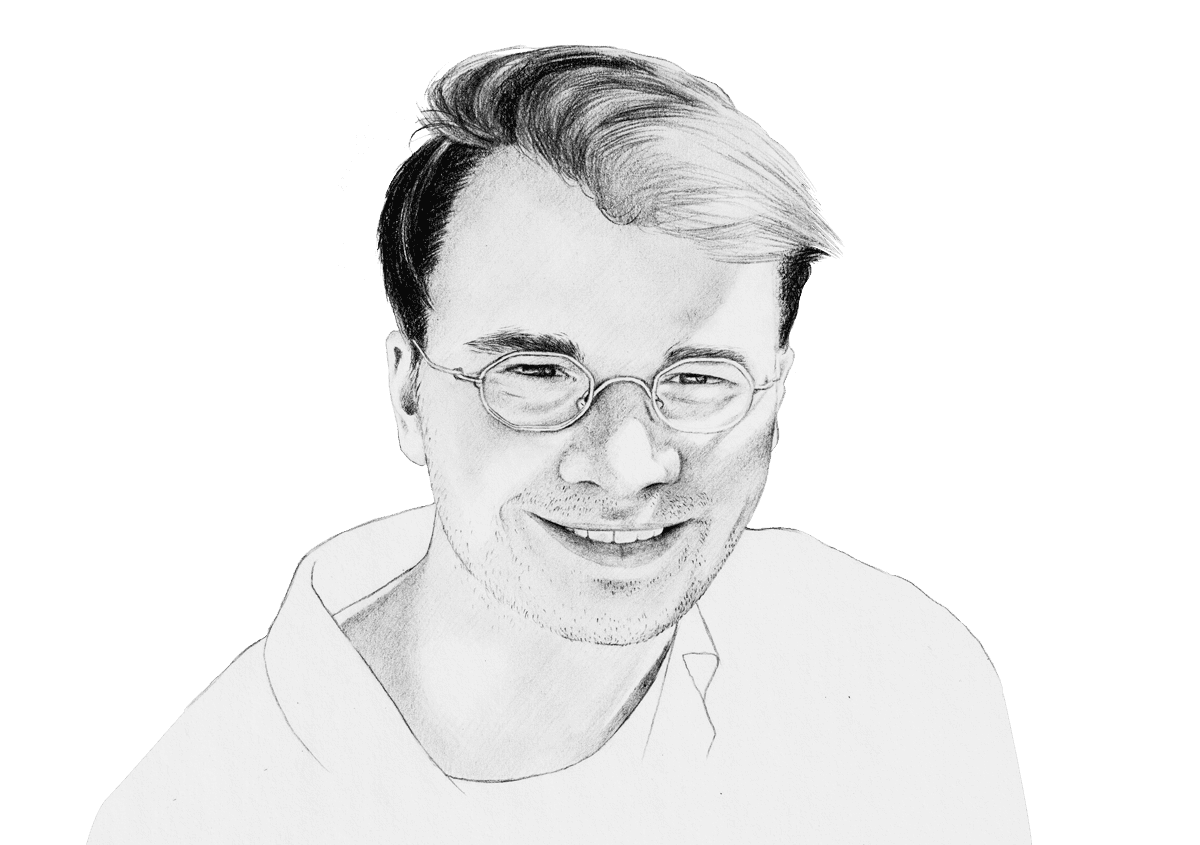
Il faut détruire la religion
«Delenda est Carthago», dit le vieux Caton. «Il faut détruire Carthage.» Pour le sénateur romain, la seule existence de l’Empire carthaginois – la civilisation nord-africaine contre laquelle Rome a deux fois fait la guerre – représente une aberration telle qu’il conclut ainsi tous ses discours devant l’auguste Sénat romain. Dans la lutte sans merci qu’il mène contre la religion, l’actuel gouvernement du Québec témoigne lui aussi d’une ardeur à combattre dont la rareté n’a d’égale que l’obstination. Non content de sa Loi sur la laïcité de l’État, il met en place un «Comité d’étude sur le respect des principes de la Loi sur la laïcité de l’État et sur les influences religieuses». Alors que ses conclusions font l’objet de délibérations médiatiques, on discute maintenant à visage découvert de l’interdiction de la prière dans l’espace public.
Proposant un amendement majeur au programme de restrictions imposées à la religion dans notre vie commune, les coprésidents du Comité semblent avoir été dépêchés pour recouvrir de sel les champs spirituels du Québec afin que sur eux plus rien ne pousse jamais.
Alliance mercenaire
Jusque dans sa composition, le Comité Pelchat-Rousseau représente le plus récent ouvrage d’une alliance mercenaire entre deux contingents intellectuels. Mus par une hostilité parfois transparente, les authentiques laïcards cherchent à purifier notre vie sociale de toute forme d’expression du religieux.
Au Québec, ces idéologues sont pourtant peu nombreux. Pour ainsi contempler le triomphe, ils ont dû s’allier aux nationalistes. Préoccupés par les impacts de la diversification ethnique et religieuse de la société québécoise, ces derniers ont souvent maille à partir avec un groupe particulier, une communauté qui défie plus que les autres leur idée de ce que devrait être notre éthos commun: les musulmans. À la recherche d’un langage et de moyens pour répondre à cette inquiétude, les nationalistes sont tombés dans le laïcisme comme Obélix dans la marmite. À l’image du dernier, ils ne mesurent peut-être pas leur force ni l’ampleur de la destruction à laquelle ils s’adonnent.
Opération kamikaze
Alors que les gouvernements croulent sous les charges, ils peinent à livrer les services publics auxquels la population s’attend. Or, une étude menée il y a peu par l’Institut Cardus démontre que les activités des organisations religieuses au pays offrent un bénéfice social et économique dix fois supérieur au cout des mesures fiscales qui les rendent possibles. Si notre système scolaire est marqué par des défis générationnels majeurs, l’organisme de recherche prouvait dans un même esprit que les écoles privées religieuses continuent de former certains des citoyens les plus susceptibles de s’investir dans leur communauté au Canada. Tandis que les problèmes de solitude, de désocialisation et de désolidarisation sont sur toutes les lèvres, les communautés de foi sont parmi ces désormais rares espaces tiers entre le travail et la maison qui stimulent le lien social et canalisent la quête de sens. En s’attaquant ainsi à elles, les tenants de la laïcité républicaine s’adonnent à une véritable opération kamikaze. La destruction de la religion l’emporte ainsi sur la poursuite du bien commun.
Idéologie de combat
Dans un récent ouvrage, le politiste Marc Chevrier, professeur à l’Université du Québec à Montréal, illustre la grande diversité des régimes d’interaction entre le religieux et le politique. Loin de conclure au relativisme, il soutient cependant que, s’agissant d’une question pratique, le rapport entre les religions et la cité exige une certaine prudence, cette aptitude au jugement et à la prise de décision informée par les circonstances.
Les raisons pratiques de ne pas s’attaquer si cruellement aux communautés de foi sont nombreuses, mais par-delà ces considérations demeurent une question plus fondamentale. À toutes les époques, des êtres humains se représentent le monde selon un mode religieux qui donne un sens à leur vie commune. On est tenté de dire que la personne humaine, animal politique selon Aristote, n’est pas moins un animal religieux. À leur manière, les généreuses déclarations et chartes de droits reconnaissent cette expression de la nature humaine et cherchent à garantir sa protection.
Par les diverses mesures dont il fait la promotion, le Comité Pelchat-Rousseau ne se contente pas d’étoffer le principe de séparation entre les religions et l’État. Bien plus qu’exclure la religion de l’espace public étroitement considéré, on veut l’asphyxier en la radiant de la vie sociale et lui enlever les moyens de s’exprimer autrement que sous la forme d’une conviction privée, confidentielle. Sous couvert de neutralité, le Comité Pelchat-Rousseau semble s’être donné pour mission d’imposer à la société québécoise son idéologie de combat: une forme d’athéisme d’État.