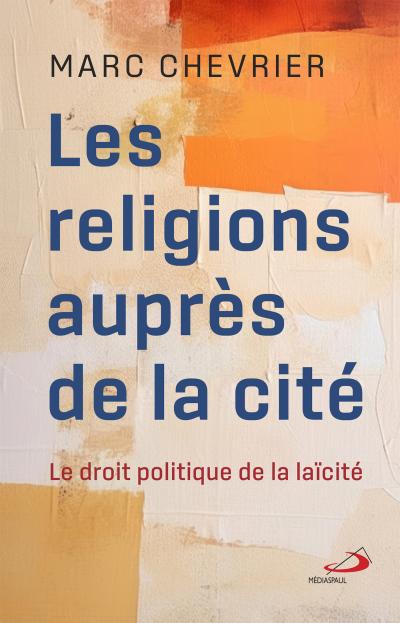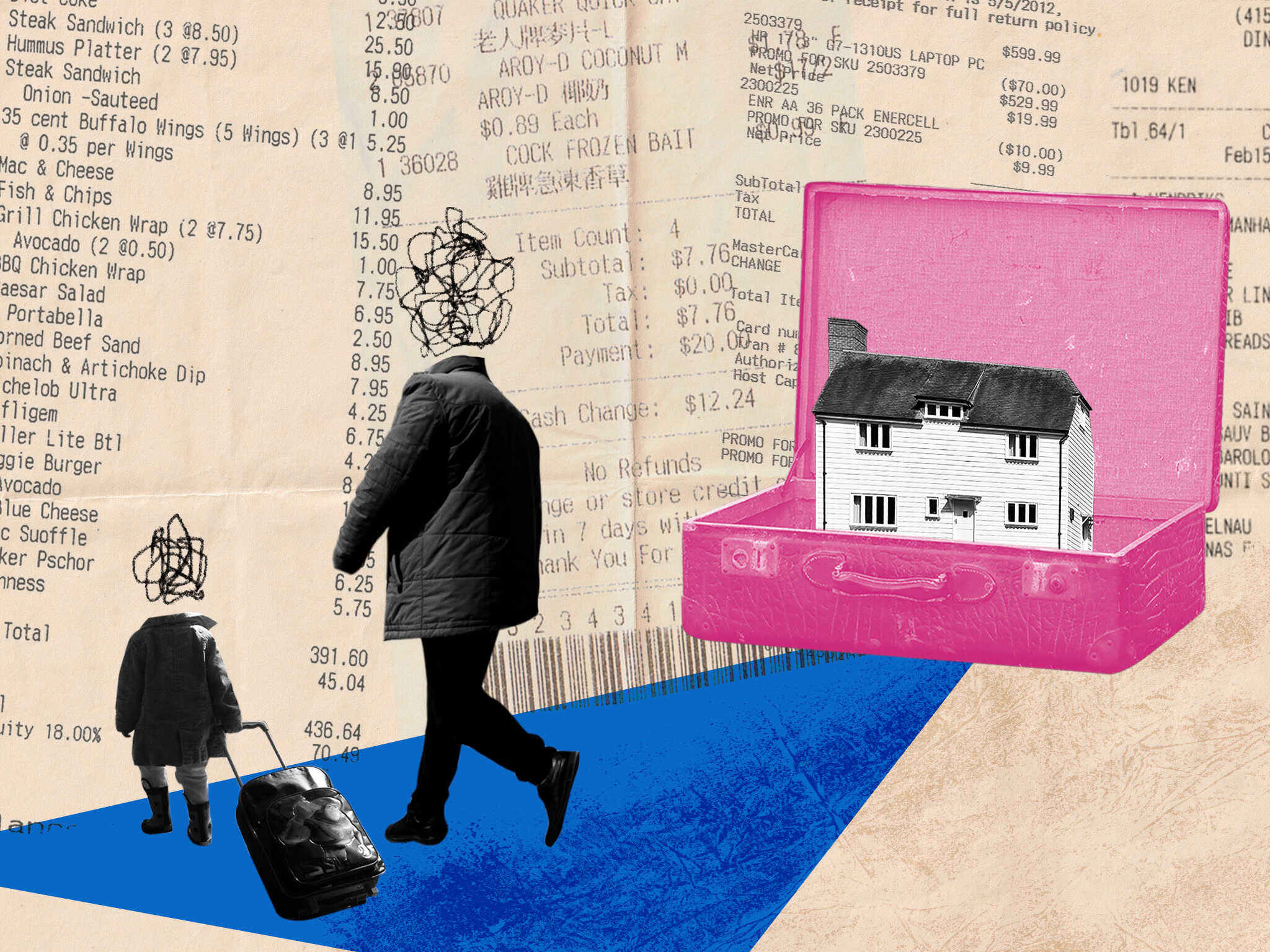La laïcité de l’État vue par l'un de ses acteurs
Professeur de science politique à l’Université du Québec à Montréal, Marc Chevrier est tout à la fois essayiste, juriste et politiste. Auteur de plusieurs ouvrages, collaborateur de longue date aux revues Argument et L’Inconvénient, il publiait récemment chez Médiaspaul Les religions auprès de la cité. Le droit politique de la laïcité (2024). Rencontre avec un penseur dont l’érudition n’a d’égale que la discrétion.
Sur la rue Saint-Jacques, dans le Vieux-Montréal, j’attends Marc Chevrier. Entre la panne de métro, la pluie battante et le café trop plein, il a fallu jouer du coude. Assis devant moi, le docteur subtil me fixe d’un regard austère, contenant un humour sibyllin. Observateur attentif des affaires publiques au Québec depuis plusieurs décennies, il a développé dans les dernières années un intérêt particulier pour les questions relatives au rapport entre la religion et la politique.
Miroir des princes
Dans un contexte de débats prolongés sur la laïcité au Québec, l’expertise de Chevrier s’avère précieuse. «J’ai été appelé par le procureur général du Québec à agir comme témoin expert dans la fameuse cause sur la loi 21, un rôle auquel je ne m’attendais pas du tout. Et pour remplir ce rôle, on m’a demandé de répondre à des questions très générales sur la laïcité», raconte-t-il. «Après avoir fait ça, j’avais comme l’impression d'être resté sur ma faim, puisqu’on m’avait posé des questions très vastes, de grande importance.»
Ainsi l’auteur se lance-t-il dans une solitaire et vertigineuse entreprise: construire une sorte de somme sur le rapport entre la religion et la laïcité: «Je l’ai fait avec une finalité: j’ai essayé non pas de répondre à des questions pour éclairer un débat judiciaire, mais d’éclairer le législateur d’aujourd’hui, quel qu’il soit.»
Ce faisant, le professeur uqamien fait revivre le «miroir des princes», une forme de traité destinée à éclairer les gouvernants et ayant connu une certaine fortune entre l’Antiquité et la Renaissance. Dans l’imaginaire collectif, Le prince de Machiavel en est à la fois le plus célèbre et le plus sinistre représentant. «Le prince, aujourd’hui, ce n’est pas nécessairement le seigneur au sens aristocratique du terme, mais plutôt le législateur démocratique contemporain», m’explique Chevrier.
Faux dilemme
Dans le débat québécois, on a souvent opposé deux idées de la laïcité: l’une libérale, à l’américaine ou à l’anglaise; l’autre républicaine, à la française. Dans le premier cas, l’État est réputé protéger la liberté des citoyens de pratiquer leur religion sans interférence aucune, selon le dictat de leur conscience individuelle. Dans le second, l’État se donne la responsabilité de maintenir un espace public exempt de référents religieux, protégeant les individus et la société dans son ensemble contre la tyrannie potentielle d’une forme ou une autre de religiosité.
Pour Marc Chevrier, à bien des égards défenseur du principe de laïcité, cette dichotomie est «intellectuellement insatisfaisante». D’une part, elle ne reflèterait pas la complexité et la diversité des modèles de laïcité qui existe en Amérique latine et en Occident. D’autre part, elle éluderait une troisième approche, une laïcité dite «conservatrice».
Si les tenants d’une laïcité conservatrice demeurent acquis à l’idée de séparation entre l’autorité politique et l’autorité religieuse, ils soutiennent typiquement qu’une tradition nationale, éventuellement teintée d’un héritage religieux, peut légitimement être prise en compte dans la réflexion sur le bien commun.
«Est-ce qu'on peut vraiment créer de l'unité sur la base de la laïcité elle-même? C'est un principe négatif. Elle ne dit pas positivement ce à quoi il faut adhérer, si ce n'est à une éthique de tolérance. Est-ce que c'est suffisant?»
De même, Chevrier m’explique qu’un conservateur comme «le poète T. S. Eliot était convaincu qu'en fait, l'État libéral, c'est un État qui n'est pas neutre, parce que, justement, son but, c'est de sortir le croyant de sa communauté de foi» en le soumettant à une vie ordonnée par des institutions qui, souvent, rompent la transmission des valeurs entre les générations, pourrait-on dire, au profit d’autres principes que soutiendrait l’État.
Enfin se pose pour les conservateurs la question du lien qui soude la communauté politique ensemble. Chevrier explique: «Est-ce qu'on peut vraiment créer de l'unité sur la base de la laïcité elle-même? C'est un principe négatif. Elle ne dit pas positivement ce à quoi il faut adhérer, si ce n'est à une éthique de tolérance. Est-ce que c'est suffisant?»
Aussi différents qu’ils puissent être, libéraux et républicains partagent, m’explique l’intellectuel montréalais, un optimisme quant à la possibilité de trouver autrement des moyens de faire l’unité dans la société. Les tenants de «la vision conservatrice sont plus pessimistes». «Ou bien on conserve ce que l’on a déjà, relate Chevrier, ou alors on se risque à une aventure collective dont on ne connait pas la solution.»
 Photo : Ioana Bezman
Photo : Ioana Bezman
Question de pratique
Constater la diversité des modèles ne devrait pas nous conduire au relativisme, soutien Chevrier: «Le lecteur, en voyant cela, devrait conclure non pas à la simple variation ou relativité des formules, ce qui est un constat assez banal. Ce que j'essaie de rappeler, c'est que légiférer en cette matière, c'est une question de pratique.»
Or, après cette enquête à la fois philosophique et comparative, Chevrier aborde la question de la laïcité à l’aune de la vertu ancienne de prudence, qui chez Aristote caractérise une personne capable d’exercer un bon jugement pratique, c’est-à-dire de prendre les bonnes décisions dans des circonstances particulières.
«La politique est toujours faite d'imprévus, explique Chevrier. On peut avoir les meilleures intentions du monde derrière une politique, puis on s'aperçoit qu'il y a des effets indésirables qu'il faut ensuite corriger. C'est un processus qui est sans fin. Donc, je ne crois pas que la question des rapports entre les religions et l'État échappe à cette dimension-là.»
Chevrier oppose la vertu de prudence à ce qu’il considère comme étant devenu un nouvel absolu dans le gouvernement de nos sociétés politiques moderne et laïques, soit l’idée des droits de la personne. «On peut tout à fait en souligner l'importance, la nécessité, dit-il. Mais le problème avec le discours politique qui est seulement indexé sur les droits de la personne, c'est que finalement, il réduit la politique à une question de mathématiques: vous avez des droits, il faut les reconnaitre, et on les applique. Il y a plus de place pour une délibération qui tient compte de la coutume, des valeurs existantes, de l'histoire, de la mémoire, des usages.»
«Une politique qui ne parle que le langage des droits peut être une politique qui manque de prudence et qui fait en sorte que, finalement, on arrive à des solutions qui sont très tranchées ou qui escamotent une dimension importante de la vie sociale», conclut-il.
Religion de l’humanité
Dans la dernière partie de son récent ouvrage, Marc Chevrier aborde une question étonnante: et si cette idée des droits de la personne, caractéristique d’un État moderne et laïc, jouait aujourd’hui un rôle assimilable à celui de la religion dans la société d’Ancien Régime? Peut-on parler d’une religion des droits de la personne? D’une religion de l’humanité?
Chevrier montre en effet que certains constatent, au-delà des formes classiques de religions, l’émergence de religions nouvelles, politiques ou autres, héritières d’idéaux modernes: «Il y a quand même encore aujourd'hui, selon plusieurs auteurs, une religion de l'humanité ou une idéologie humanitaire très puissante qui est à l'œuvre dans les démocraties libérales et qui fait concurrence aux religions dites traditionnelles.»
Cette religion de l’humanité, qu’exprime l’État moderne laïc, porte-t-elle préjudice à l’idée de neutralité qu’il prétend défendre et sur laquelle il repose? «Est-ce qu'il est concevable que l'État libéral et démocratique en vienne, par un exercice de réflexivité, à créer une distance avec ses propres assises? Je n’ai pas nécessairement la réponse, je pose la question.»