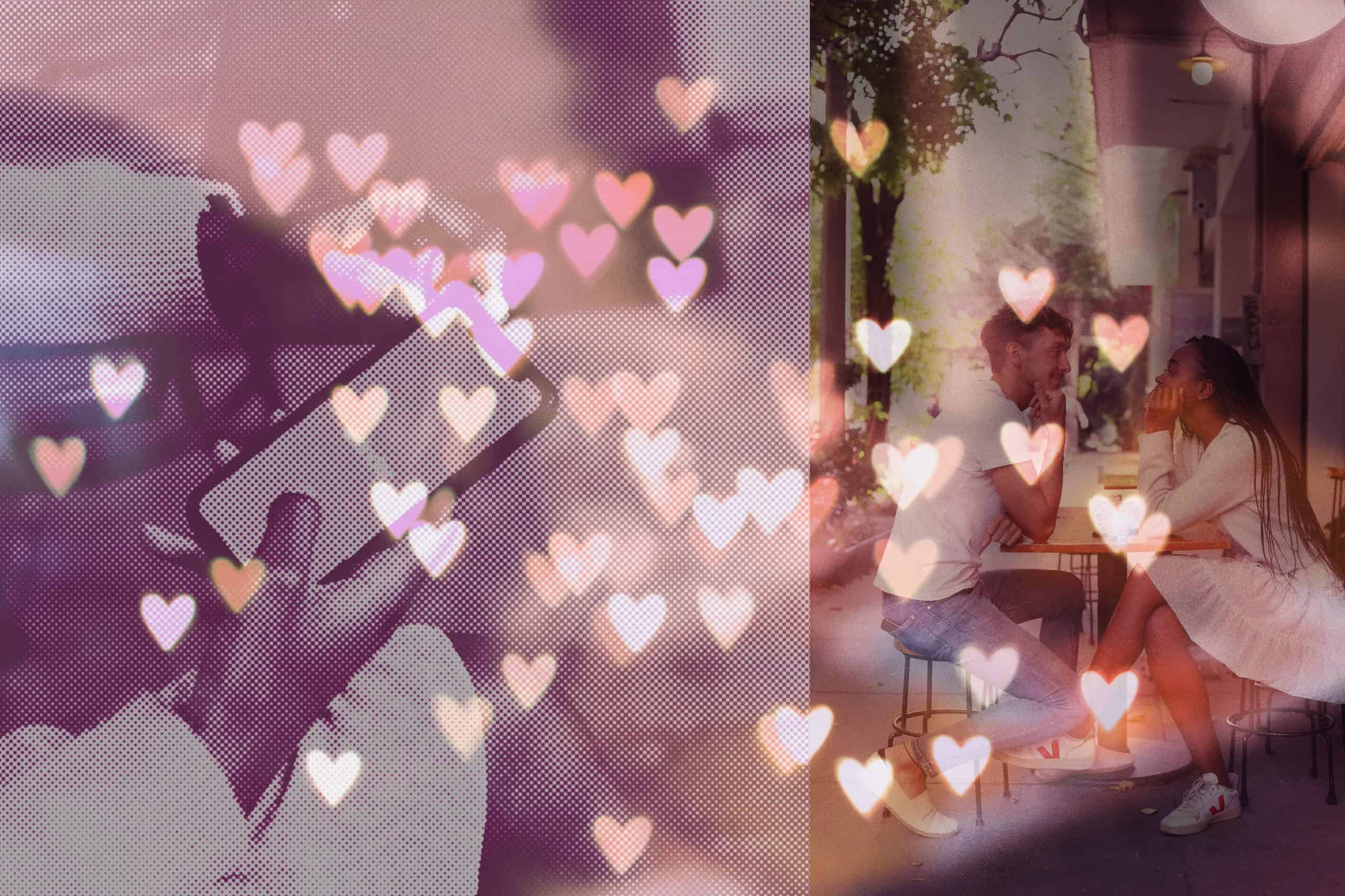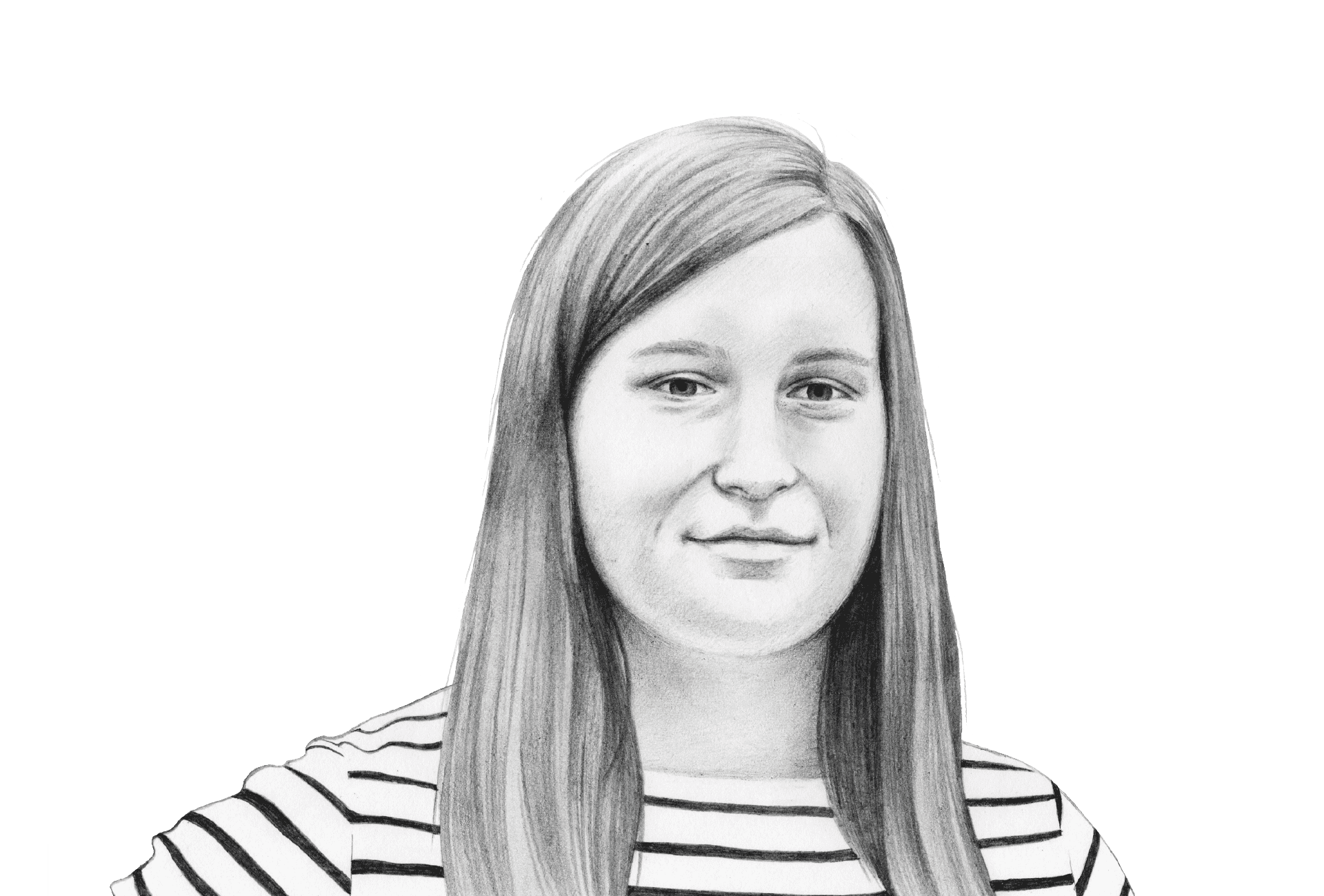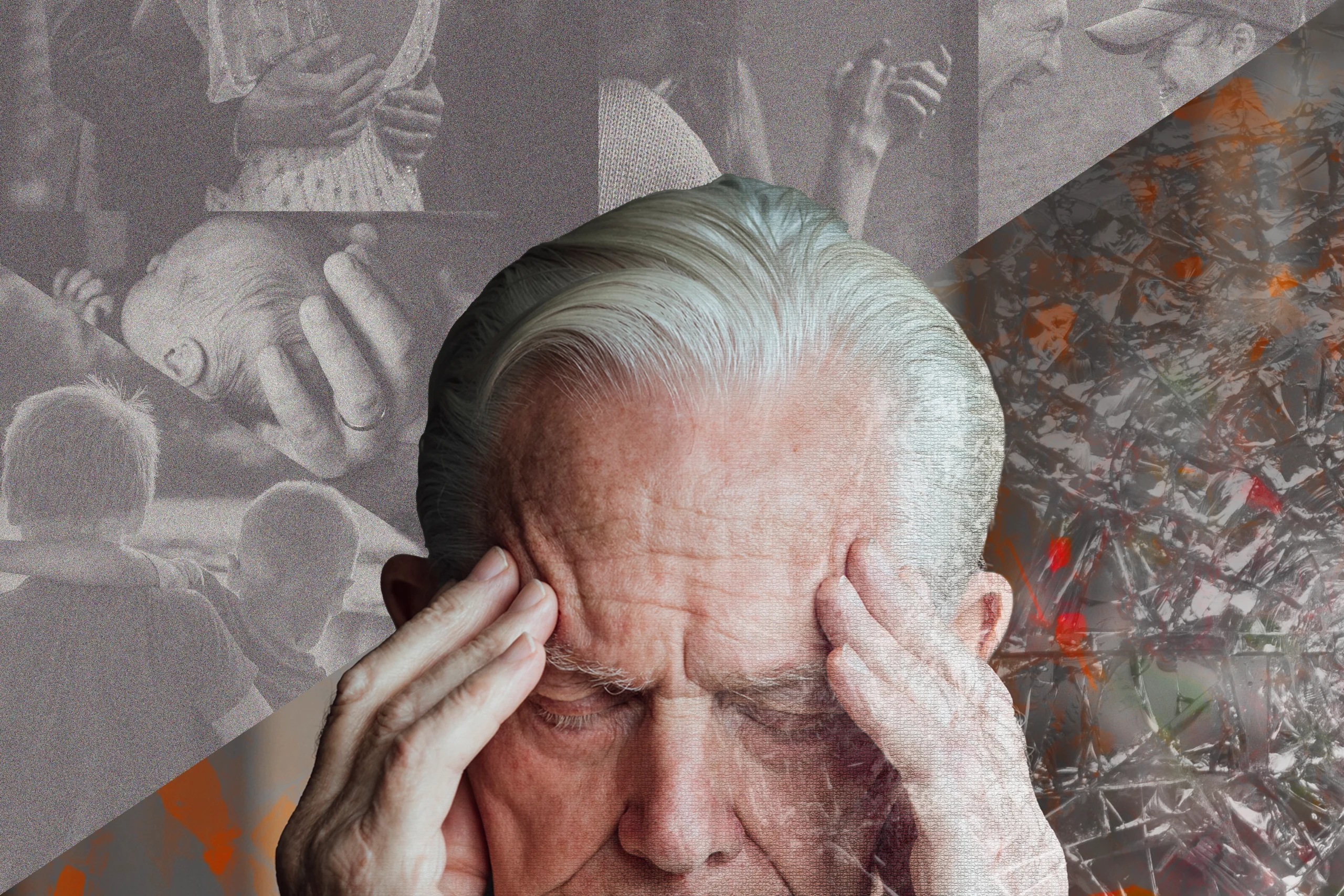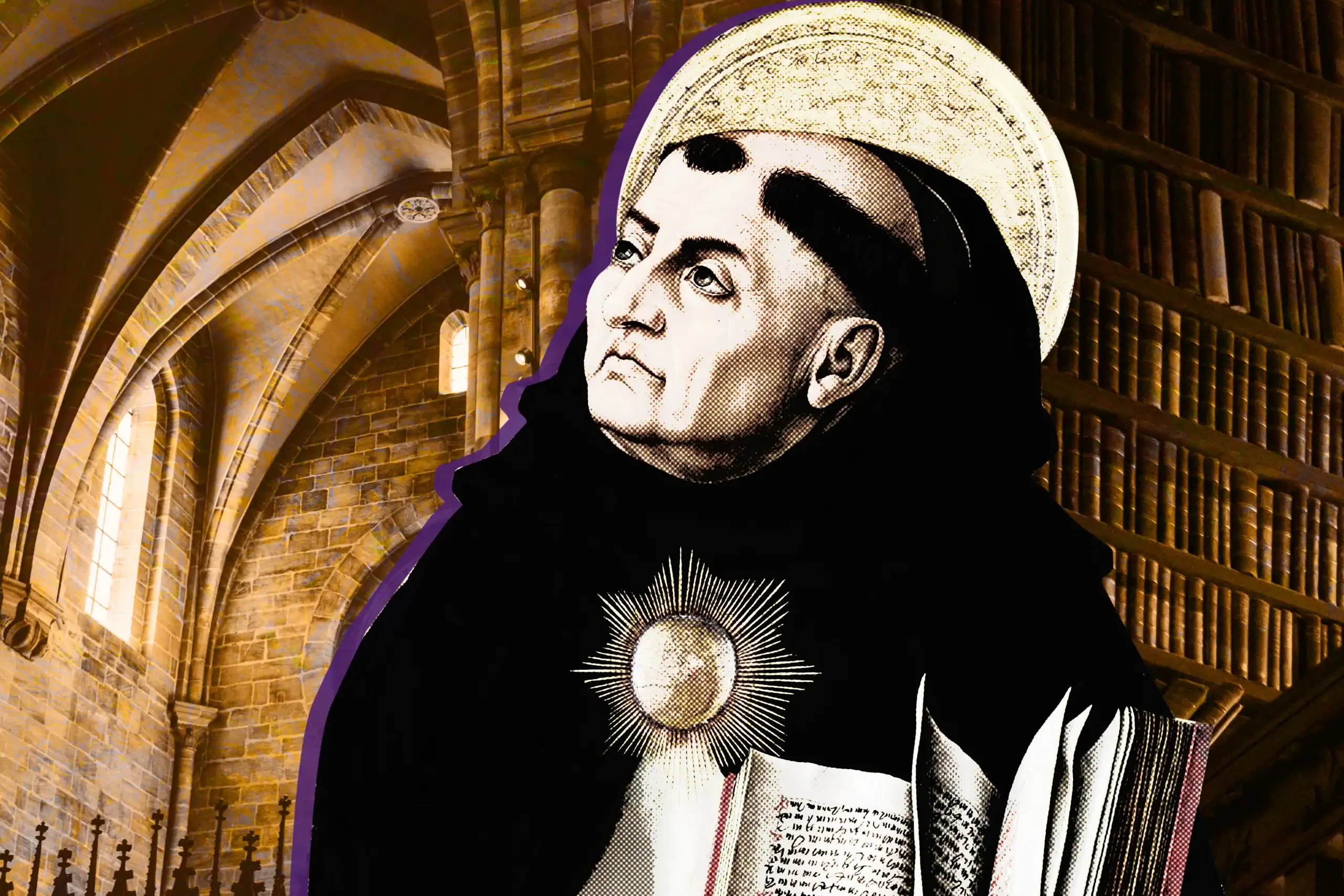Le beau métier de tueur en Syrie
Le 15 mars dernier, les médias nous signalaient que le conflit syrien entrait dans sa cinquième année. Ce qui dans la foulée du « printemps arabe » avait démarré comme une révolte populaire contre le régime dictatorial de Bachar el-Assad s’est mué, quatre ans plus tard, en une énième guerre du Moyen-Orient où cette fois les pays occidentaux essaient de ne pas trop s’embourber, en espérant que leurs alliés régionaux (Arabie Saoudite, Qatar, Turquie) pourront faire le gros du travail au sol.
Si personne aujourd’hui ne voit la fin à court terme du conflit, il n’en était pas ainsi en 2011 et 2012. Depuis Paris ou Washington, tout semblait simple et prévisible. Ben Ali était tombé, Moubarak était tombé, Kadhafi était tombé (moyennant quelques bombardements) et el-Assad allait tomber. L’Histoire se pliait, au prix d’un peu de wishful thinking et de quelques entorses rhétoriques faites à la vérité, au schéma narratif qui structure le récit fondateur de l’Occident moderne, celui de la révolution libérale et démocratique, dans lequel s’enchainent, comme par une loi de nécessité, despotisme, oppression, révolte et libération.
Le mythe occidental
Les médias occidentaux, conditionnés dans leur lecture des évènements par un certain romantisme révolutionnaire, voyaient de même dans la chute anticipée du dictateur syrien la réactualisation prochaine de l’évènement fondateur (1) de l’Occident moderne. Durant de longs mois, ils se sont complus dans un discours mythopoïétique (2) manichéen. Mais sous l’effet du désenchantement suscité par le spectacle moins lyrique que prévu d’un pays où le tyran résiste et lutte désormais contre le pire monstre politique du dernier quart de siècle (l’État islamique), la couverture journalistique s’est peu à peu transformée en compte-rendu tour à tour prudent, perplexe ou atterré.
Maintenant que l’illusion lyrique s’est dissipée, la situation réelle, bien qu’en constante évolution, nous apparait plus clairement. Qui plus est, des livres intéressants sont parus, qui nous permettent de démêler au moins partiellement l’écheveau des évènements, d’identifier les acteurs, de soupeser les responsabilités. Parmi ces publications, il y a Syrie. Pourquoi l’Occident s’est trompé (3), du chercheur arabisant Frédéric Pichon, et Le retour des djihadistes. Aux racines de l’État islamique (4), du journaliste irlandais Patrick Cockburn. Je ne peux pas dire que les réflexions qui suivent les résument, mais elles en sont tributaires.
Grand reporter au service du quotidien The Independent, Cockburn présente ainsi la situation en Syrie:
la crise syrienne se décompose en cinq conflits distincts qui s’alimentent et s’exacerbent les uns les autres. La guerre a commencé par une authentique révolte populaire contre une dictature brutale et corrompue, qui s’est vite retrouvée imbriquée dans le combat des sunnites contres les alaouites (5), s’inscrivant lui-même dans une plus vaste guerre entre sunnites et chiites au niveau régional, laquelle met face à face les États-Unis, l’Arabie Saoudite, les États sunnites d’un côté, et l’Iran, l’Irak et les chiites libanais de l’autre. Vient s’y ajouter la nouvelle guerre froide entre Moscou et l’Occident, exacerbée par le conflit en Libye, et plus récemment aggravée par la crise en Ukraine (6). »
Quand les manifestations populaires ont tourné à l’affrontement armé et que l’opposition au régime s’est cristallisée, l’Occident a voulu y déceler des éléments favorables à l’établissement d’un État de droit laïc et démocratique, et leur a donné son appui. Ces éléments, qui n’étaient pas aussi libéraux que le bloc atlantiste l’aurait souhaité, ont par la suite été supplantés comme principale force d’opposition au régime par les brigades salafistes financées par les États sunnites du Golfe, à qui l’Occident a choisi de laisser la gestion du conflit (7), et qui ont naturellement cherché à hâter la chute de Bachar avec leurs propres moyens, ceux du sectarisme et du djihadisme (8).
L’esthétisation de la mort
Aujourd’hui, la plus « célèbre » force djihadiste en action sur les théâtres d’opération mésopotamiens est celle de l’État islamique en Irak et au Levant (EIIL). Devenu une entité autonome vivant de son pétrole de contrebande et du rêve d’un califat rétabli, l’EIIL attire de partout des combattants aguerris, mais aussi, comme nous l’avons constaté ici même au Québec, de jeunes musulmans (et pas seulement des désaxés), qui sont pleins du désir de se vouer à une grande cause. Ne voyant rien qui les enchante dans la prosaïque vie d’un petit salarié anonyme, ces jeunes succombent aux attraits du beau métier de tueur en Syrie (9).
Je parle du « beau » métier de tueur, car les djihadistes de l’EIIL, comme les nazis avant eux, ont su esthétiser la force et la violence avec maestria, donnant à leur action armée un retentissement médiatique mondial. Parfaitement conscients que plus ils iraient loin dans la cruauté, plus ils auraient d’impact et de magnétisme, ils n’ont pas hésité à livrer au supplice et au massacre leurs captifs, en employant des méthodes d’un autre âge, et en filmant le tout aux fins de propagande (10). L’EIIL importe, mais exporte aussi sa terreur, comme l’attentat du 18 mars à Tunis ou celui du 20 mars à Sanaa l’ont confirmé.
L’EIIL est véritablement entré dans le champ de la conscience occidentale en juin 2014, à cause de l’effet de choc et du retentissement médiatique qu’a eu la prise de Mossoul. Triomphant contre une armée irakienne minée par la corruption et rapidement débandée, les combattants de l’EIIL engagés dans cette opération ont conquis la deuxième ville du pays, révélant du même coup au monde la vanité des efforts de reconstruction – sous supervision américaine – de l’Irak d’après Saddam Hussein. Cet échec s’explique en grande partie de l’intérieur par le déclassement sociopolitique des sunnites irakiens (11), qui lui-même découle de la rivalité pluriséculaire entre chiites et sunnites (12).
L’état des lieux
Désormais, l’EIIL contrôle un territoire équivalent à celui de la Grande-Bretagne, comprenant l’est de la Syrie et le nord-ouest de l’Irak. On estime qu’entre 7 et 10 millions d’individus subissent sa loi, avec plus ou moins de satisfaction ou de résignation. Son indépendance de vue, sa puissance croissante, son ambition hégémonique déclarée et ses succès militaires ont fini par effrayer les Arabes et les Occidentaux. Depuis août (Irak) et septembre (Syrie) derniers, une stratégie d’endiguement a été déployée du haut des airs (13), tandis qu’au sol on tente toujours de susciter et de soutenir de nouvelles forces combattantes dites « modérées », capables de faire barrage à l’enracinement et à l’expansion de ce nouvel acteur qui déstabilise la région.
À l’heure qu’il est, la progression des fantassins de l’EIIL est stoppée, surtout en raison des frappes aériennes. Mais il faudra plus que des avions de chasse pour reprendre le dessus dans ce conflit éclaté, où le foisonnement des groupes armés, qui tantôt s’opposent, tantôt se coalisent ou se soudent avant de se dissoudre et de se refondre, limite la clairvoyance et empêche les actions décisives. Et comme si la situation n’était pas déjà assez complexe, il faut aussi composer avec les Kurdes, qui, s’ils sont des alliés de l’Occident, jouent leur propre partition sans trop chercher à provoquer le pouvoir en place à Damas (14).
Ainsi, un conflit supplémentaire s’ajoute aux cinq conflits mentionnés plus haut; un conflit où une nouvelle entité sunnite cherchant à pérenniser son implantation affronte toutes les autres forces présentes sur le terrain:
- les alaouites (qui s’accrochent au pouvoir à Damas);
- les chiites d’Irak (qui tentent d’éviter l’effondrement de leur État);
- les Iraniens (principal soutien régional d’el-Assad);
- la Russie (allié essentiel de Bachar);
- les monarchies du Golfe (qualifiées de « pompiers pyromanes » par Pichon);
- les puissances occidentales (entrainées de nouveau dans l’engrenage de la guerre par leurs intérêts stratégiques dans la région, mais aussi par leurs très étroites relations économiques avec les régimes sunnites).
Et pendant ce temps les chrétiens d’Orient marchent dans les pas de leur Maitre, sur le chemin du calvaire.
_________
(1) Fondateur, donc sacré.
(2) Un discours mythopoïétique est un discours qui fabrique (poiesis) du mythe. En l’occurrence, du mythe révolutionnaire libéral. Le discours mythopoïétique produit par les médias occidentaux début 2011 a interprété et raconté plus ou moins consciemment les évènements du « printemps arabe » de manière à entretenir l’illusion euphorisante que c’était bel et bien la légende rêvée de la révolution revécue qui était en train de se dérouler en direct sous nos yeux ébahis. Est-il besoin de dire que l’étiquette « printemps arabe » est elle-même un produit de la mythopoïésis des médias occidentaux?
(3) Frédéric Pichon, Syrie. Pourquoi l’Occident s’est trompé, éditions du Rocher, Monaco, 2014, 132 p. L’édition originale date de mai 2014.
(4) Patrick Cockburn, Le retour des djihadistes. Aux racines de l’État islamique, Équateurs documents, 2014, 174 p. L’édition originale anglaise est parue en aout 2014.
(5) Minorité religieuse dont est issue la dynastie el-Assad, les alaouites sont perçus comme des hérétiques par les musulmans sunnites, mais conservent la sympathie des adeptes du chiisme. Les spécialistes jugent que les croyances alaouites rassemblent et amalgament des éléments de l’islam chiite, du christianisme, ainsi que « du paganisme phénicien, du mazdéisme et du manichéisme » (F. Pichon), pour former une sorte d’ésotérisme musulmanisant dont les secrets ne sont même pas divulgués à tous les alaouites.
(6) Patrick Cockburn, Le retour des djihadistes…, p. 103.
(7) C’est ce qu’affirmait Frédéric Pichon en 2013 dans une entrevue donnée au journal La Croix.
(8) Le salafisme est un courant théologique très ancien, qui plonge ses racines jusqu’au 9e siècle, et qui prône un retour à la pureté des origines de l’islam tel qu’il aurait été vécu par Mahomet et ses compagnons. C’est le courant théologique le plus fondamentaliste qui soit. Il s’incarne parfois politiquement dans l’intégrisme, voire militairement dans le djihadisme, mais pas toujours. Certains salafistes privilégient une approche « quiétiste » des questions sociales, donc non violente. Le wahhabisme en est la version contemporaine la plus répandue, grâce à l’influence de l’Arabie Saoudite dans le monde.
(9) Pour avoir une idée de ce qui attend les Occidentaux qui partent faire le djihad en Syrie, lire cet article d’Alain Rodier.
(10) Nous avons tous, depuis, acquis la certitude que la barbarie n’a pas d’âge, puisque c’est bel et bien durant notre âge, l’âge du plus frénétique progrès, que nous assistons, médusés, à l’irruption presque quotidienne du démoniaque.
(11) La transition à marche forcée de l’Irak vers la démocratie après la chute de Saddam Hussein a bénéficié à la majorité chiite, jusqu’alors soumise à la minorité sunnite. Du fait du nombre, les chiites se sont retrouvés aux commandes de l’État, mais le gouvernement de l’ex-président al-Maliki (chiite) a échoué à recréer ce qu’il pouvait y avoir d’unité nationale sous l’ancienne dictature. Aujourd’hui, « l’Irak se décompose entre régions chiites, sunnites et kurdes » (Cockburn).
(12) Le conflit entre sunnites et chiites polarise le monde musulman depuis des siècles. Frustrés d’avoir perdu l’influence qu’ils avaient sous Saddam Hussein, vexés d’être injustement traités par le nouveau régime dominé par les chiites, les élites et les populations sunnites irakiennes sont graduellement entrées dans l’orbite de l’EIIL, auquel elles restent actuellement « globalement favorables », selon Alain Rodier.
(13) On sait depuis quelques jours que le gouvernement Harper a choisi d’élargir et de prolonger l’engagement militaire du Canada dans la région, en bombardant aussi en zone syrienne.
(14) L’objectif kurde est la création d’un État national le long de la frontière turque. La Turquie, qui est officiellement du côté des Occidentaux dans l’opposition à Bachar, n’en veut évidemment pas, puisque cela fragiliserait sa domination sur les populations kurdes vivant sur son propre territoire.