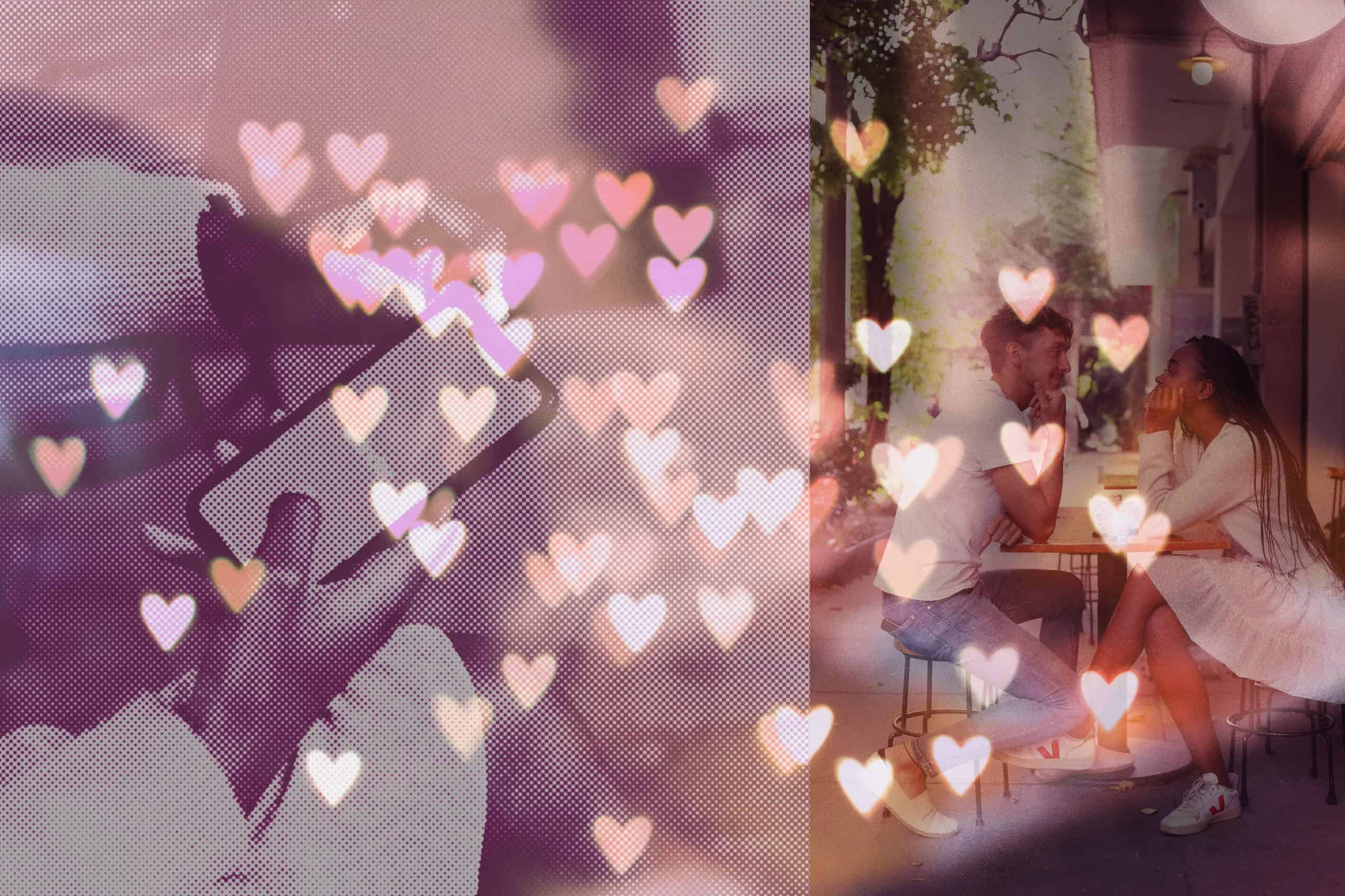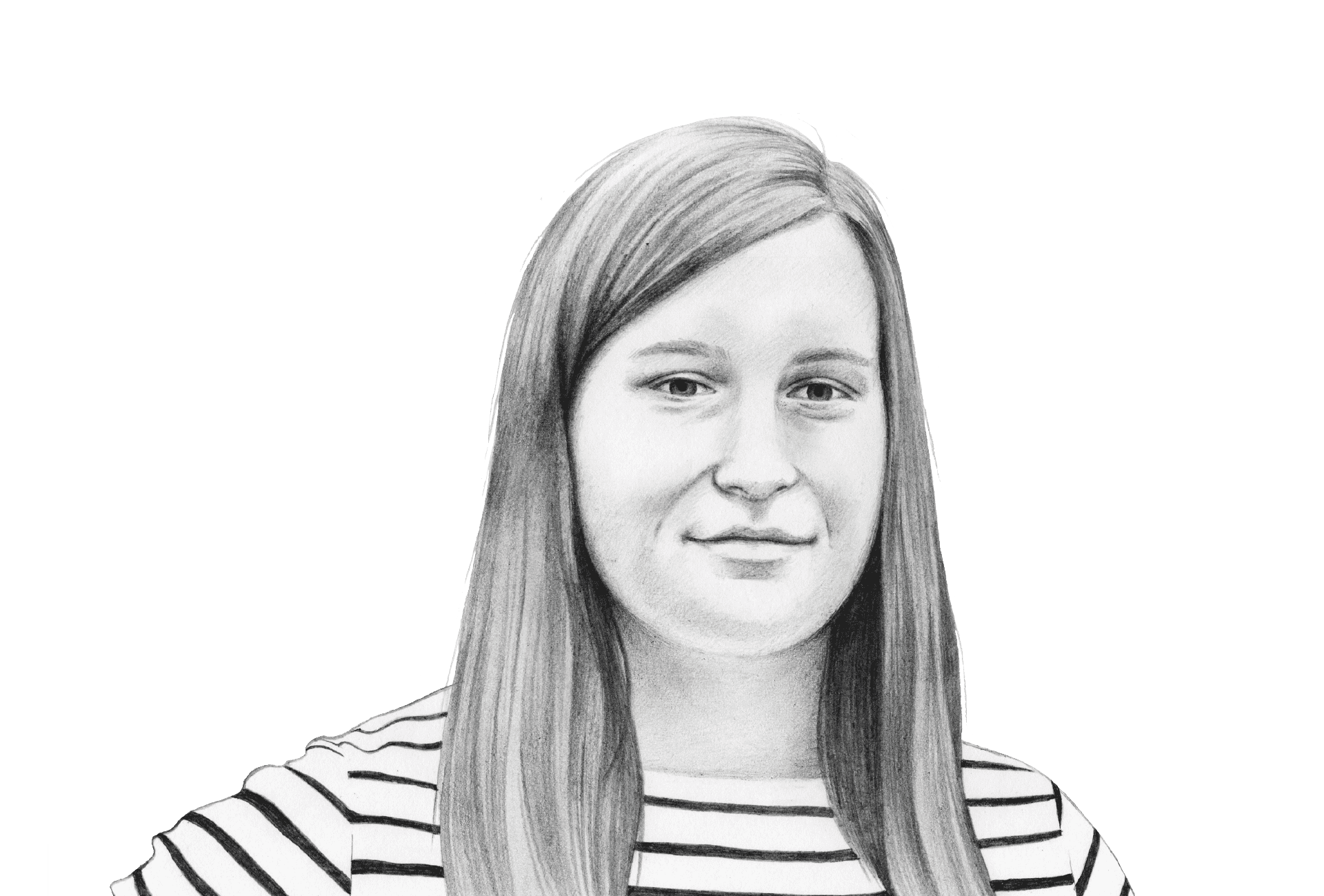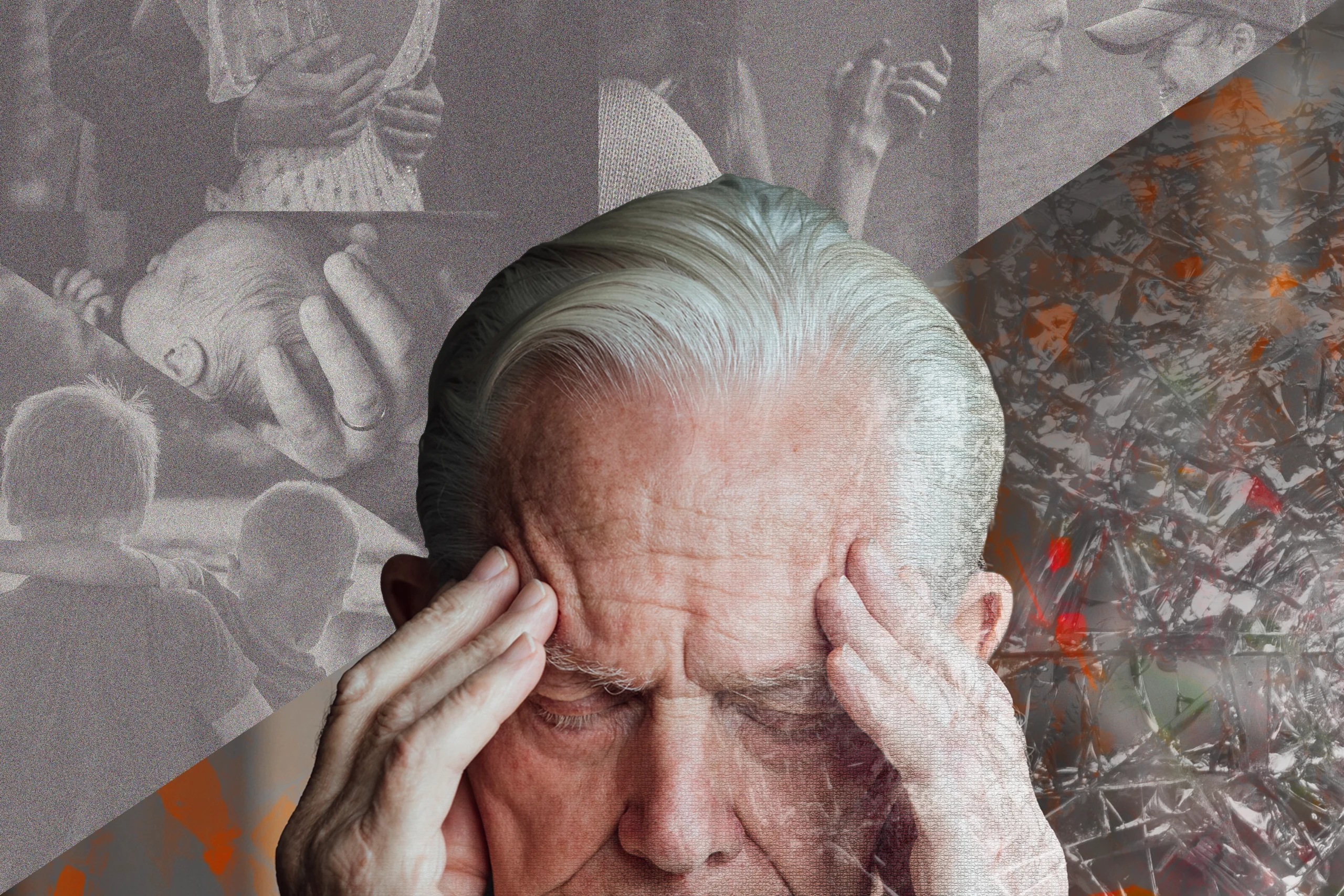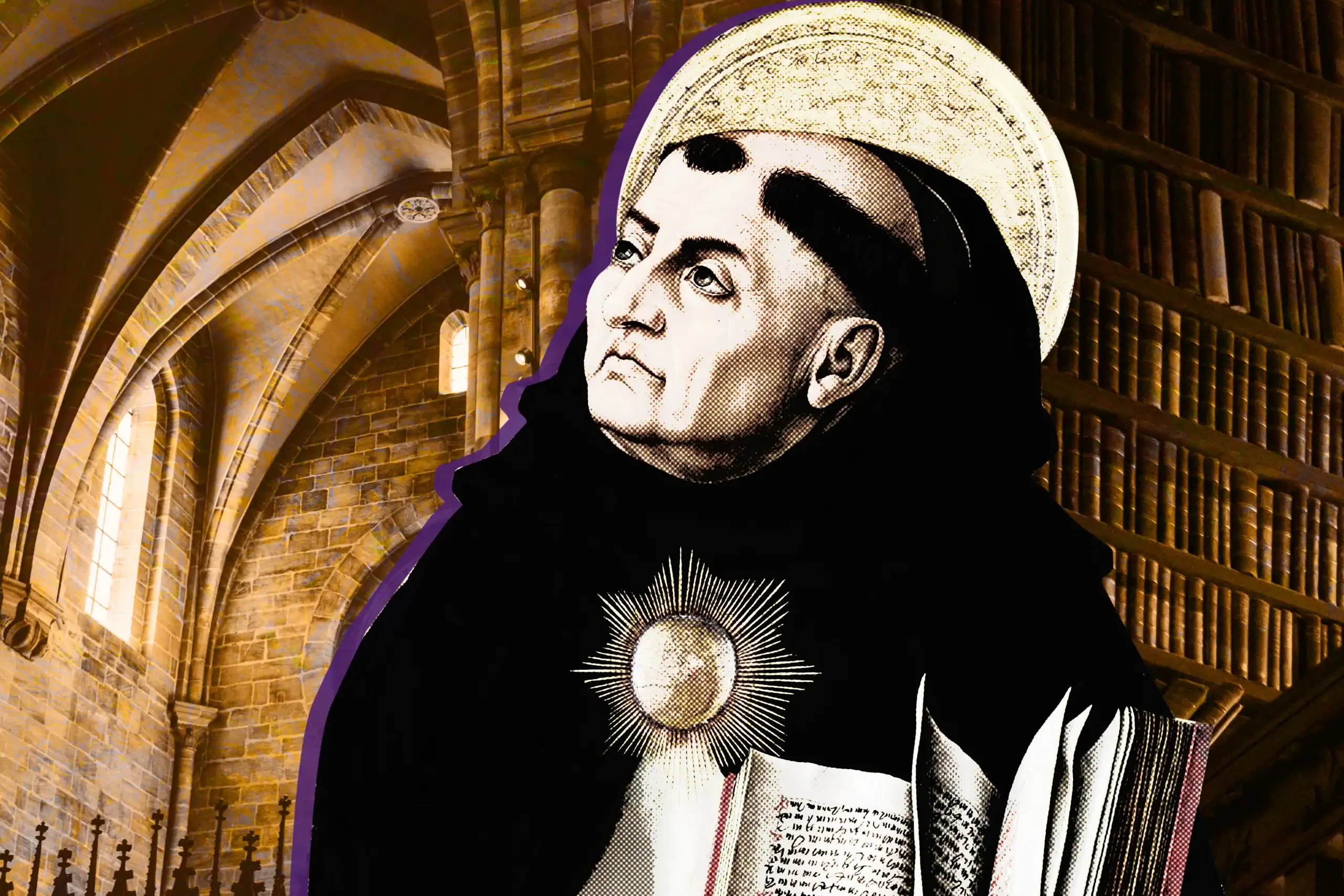Flannery O’Connor, la dame aux paons
On est en 1946, dans une résidence étudiante de l’Université d’Iowa. Une jeune femme de 21 ans, enfermée dans une chambre exigüe donnant sur l’unique toilette de l’étage, griffonne dans un calepin bon marché quelques « prières » d’un ton singulier.
« Cher Dieu, je suis incapable de vous aimer comme je le voudrais. Vous êtes le mince croissant d’une lune que j’aperçois, et mon moi est l’ombre projetée par la terre qui m’empêche de voir cette lune tout entière. Le croissant est très beau, et peut-être est-ce là tout ce qu’une personne comme moi devrait en voir ; mais ce dont j’ai peur, cher Dieu, c’est que l’ombre de mon moi s’agrandisse au point d’éclipser toute la lune, et qu’alors j’en vienne à me juger d’après cette ombre qui n’est rien.
« Je ne vous connais pas, Seigneur, parce que je suis en travers du chemin. S’il vous plait, aidez-moi à me mettre de côté1. »
Cette jeune femme s’appelle Flannery O’Connor et veut devenir écrivaine. Elle doute de sa vocation et passe ses journées à lire, à écrire et à noter ingénument ses prières : « Cher Dieu, je suis si découragée par mon travail. […] Je réalise que je ne sais pas ce que je réalise. S’il vous plait, mon Dieu, aidez-moi à devenir un bon écrivain et à publier quelque chose d’autre2. »
Écrivaine, elle le sera, et pas de n’importe quelle trempe : une quinzaine d’années plus tard, elle aura rejoint les grandes voix du Sud des États-Unis, comme William Faulkner, Walker Percy et Robert Penn Warren. Parmi les écrivains catholiques, Flannery O’Connor s’impose et se démarque par l’originalité de ses thèmes, par ses réflexions sur les rapports entre foi et littérature, et enfin par son exceptionnelle maitrise de l’art de la fiction.
« Faites de moi une mystique, immédiatement »
Flannery O’Connor nait à Savannah, en Géorgie, le 25 mars 1925. Elle grandit au sein d’une famille catholique dont les ancêtres, des Irlandais, furent contraints de quitter leur pays au début du 19e siècle pour échapper aux lois pénales du Parlement anglais qui visaient à affaiblir le catholicisme en Irlande. Dans sa jeunesse, elle montre une inclination pour l’écriture et le dessin. Elle se passionne par ailleurs pour l’élevage d’oiseaux domestiques et, à l’âge de six ans, elle apprend à une de ses poules à marcher à reculons – un exploit qui lui vaut d’être filmée par le journal « télévisé » Pathé News3.
Au début de la vingtaine, Flannery quitte la Géorgie pour étudier à l’Université d’État d’Iowa, où elle suit des ateliers d’écriture. Chaque jour, elle assiste à la messe et écrit à sa mère, dont elle est très proche depuis la mort de son père en 1941.
Elle entame à cette époque (1946-1947) un Journal de prière, qui est en fait une série de lettres à Dieu4. Ces lettres témoignent des préoccupations de l’écrivain en formation. Avec une humilité et une sincérité touchantes, la jeune Flannery y consigne ses réflexions, ses découragements, ses prières et ses doutes. C’est d’ailleurs sur une période de doute qu’il s’achève, alors que Flannery est écartelée entre ses désirs grandioses et le sentiment de sa propre turpitude : « Ce que je demande est vraiment très ridicule. Je dis : Seigneur, en ce moment, je suis un fromage, faites de moi une mystique immédiatement. Dieu peut faire cela – transformer des fromages en mystiques. Mais pourquoi devrait-il le faire pour une sale créature, ingrate et paresseuse comme moi ? Je ne peux même pas rester à l’église pour l’action de grâces, et la veille, en me préparant à la communion, mes pensées étaient partout ailleurs. Le rosaire est pour moi une simple rotation au cours de laquelle je songe à des choses autres et généralement impies. J’aimerais pourtant être une mystique, et tout de suite5. »
Quelques années après l’université, tandis qu’elle travaille à son premier roman, Flannery apprend qu’elle souffre du lupus érythémateux, la même maladie qui avait tué son père. Cette maladie auto-immune, qui se caractérise notamment par des lésions cutanées du visage et qui menace la peau, les articulations, les reins, le cœur et le cerveau, contraint Flannery à rentrer vivre auprès de sa mère à Milledgeville (Géorgie), à la ferme d’Andalusia qu’elle ne quittera presque plus.
Elle se force à travailler trois heures chaque matin, même quand l’inspiration ne vient pas. Ses après-midis, elle les passe auprès de ses oiseaux. Elle chérit tout particulièrement ses nombreux paons – elle en possède une trentaine –, comme on le constate à la lecture des lettres qu’elle envoie à ses amis, où elle donne régulièrement des nouvelles de ses bêtes. Sa mère Regina, bien qu’étrangère à la création artistique, s’occupe de la ferme et apporte un indéfectible soutien à sa fille, dont l’état de santé se dégrade peu à peu.
C’est dans ce contexte que Flannery O’Connor rédige son œuvre. Elle laisse derrière elle deux romans : La sagesse dans le sang (1952), Et ce sont les violents qui l’emportent (1960) ; trois recueils de nouvelles : Les braves gens ne courent pas les rues (1955), Mon mal vient de plus loin (1965), Pourquoi ces nations en tumulte ? (1971) ; un recueil d’essais : Mystère et manières (1969) ; et un recueil de lettres écrites entre 1948 et 1964 : L’habitude d’être (1979)6. Elle meurt âgée d’à peine 39 ans.
La sagesse dans le sang
Les deux romans de Flannery O’Connor se réunissent autour de thèmes communs : ils traitent du diable, du destin et du salut de l’âme dans une société rationaliste et matérialiste où des substituts de religions prolifèrent sur ce qui était autrefois le terreau de l’esprit religieux. La sagesse dans le sang met en scène un prédicateur nihiliste qui est, selon l’auteur, « une sorte de saint protestant7 ».
À bord d’une bagnole qui tombe en ruine, Hazel Motes vadrouille à travers les rues d’une petite ville industrielle où il dispute à des prédicateurs charlatans et à des vendeurs d’épluche-légumes l’attention des passants et des badauds, qu’il espère convertir à « l’Église sans le Christ ». Il consacre ses journées à nier activement le Christ et la Rédemption. Ses « prêches », trop sérieux et trop rigoureux pour être populaires, n’intéressent personne, et Hazel est rapidement supplanté par un escroc qui parvient, grâce à sa guitare et à ses paroles melliflues, à amasser de coquettes sommes au nom de la « Sainte Église du Christ sans Christ ». Hazel assassine son concurrent et finit par s’aveugler le jour où il comprend qu’il a passé sa vie à chercher son salut alors qu’il croyait tout faire pour y échapper.
Et ce sont les violents qui l’emportent
C’est toutefois dans son deuxième roman qu’éclate la maitrise de Flannery O’Connor. Cette œuvre puissante, fruit d’un travail de sept ans, est un véritable tour de force qui réussit à tenir le lecteur en haleine avec une intrigue aussi ténue et aussi éloignée des préoccupations contemporaines que le baptême d’un enfant idiot (on dirait aujourd’hui : handicapé mental).
Le jeune orphelin Tarwater est élevé au milieu de la forêt par son grand-oncle – le vieux Tarwater –, une sorte de prophète sauvage qui veut faire de son petit-neveu son successeur. Sa mission : baptiser le fils idiot de son oncle Rayber, un instituteur athée qui éprouve un ressentiment tenace à l’égard du vieux Tarwater à cause de l’éducation religieuse que celui-ci a tenté de lui inculquer dans sa jeunesse. Mais le garçon n’entend nullement suivre les traces de son grand-oncle. Sur les conseils d’une voix diabolique, omniprésente dans ce roman, il désobéit aux dernières volontés de ce dernier en refusant de l’enterrer et en incendiant sa propriété.
Sans domicile et sans famille, Tarwater se rend chez son oncle Rayber, lequel avait déjà tenté une fois de le sauver lors d’une visite chez le vieux Tarwater, d’où il était rentré avec une balle de fusil dans l’oreille. Rayber se montre déterminé à lui donner une éducation solide pour rattraper les « années perdues » et l’empêcher de « devenir un monstre », mais Tarwater n’en veut rien savoir. Son oncle ne représente pour lui qu’un individu tiède et impuissant qui compense son incapacité d’agir par des paroles creuses et des explications scientifiques. N’a-t-il pas échoué à noyer son fils Bishop, le jour où il a tenté d’abréger cette pauvre vie à ses yeux absurde et inutile ?
Tarwater, lui, parle peu mais agit. Auprès de l’instituteur et du petit Bishop, il ressent plus vivement que jamais une propension au mal, mais il doit lutter contre une inclination inexplicable pour la mission dont l’avait investi son grand-oncle…
Pas pour les tièdes
D’un côté, donc, l’histoire d’un homme qui œuvre à sa rédemption en cherchant à se damner ; d’un autre côté, celle d’un garçon qui s’achemine vers son destin de prophète alors même qu’il fait tout pour le fuir. Sans doute une des clés de l’œuvre de Flannery O’Connor se trouve-t-elle dans ce verset de l’Évangile selon saint Matthieu d’où le second roman tient son titre : le Royaume des cieux n’appartient pas aux tièdes et aux indifférents, mais aux âmes violentes. Et le diable est peut-être, à ses dépens, une ruse de Dieu pour en reconquérir quelques-unes.