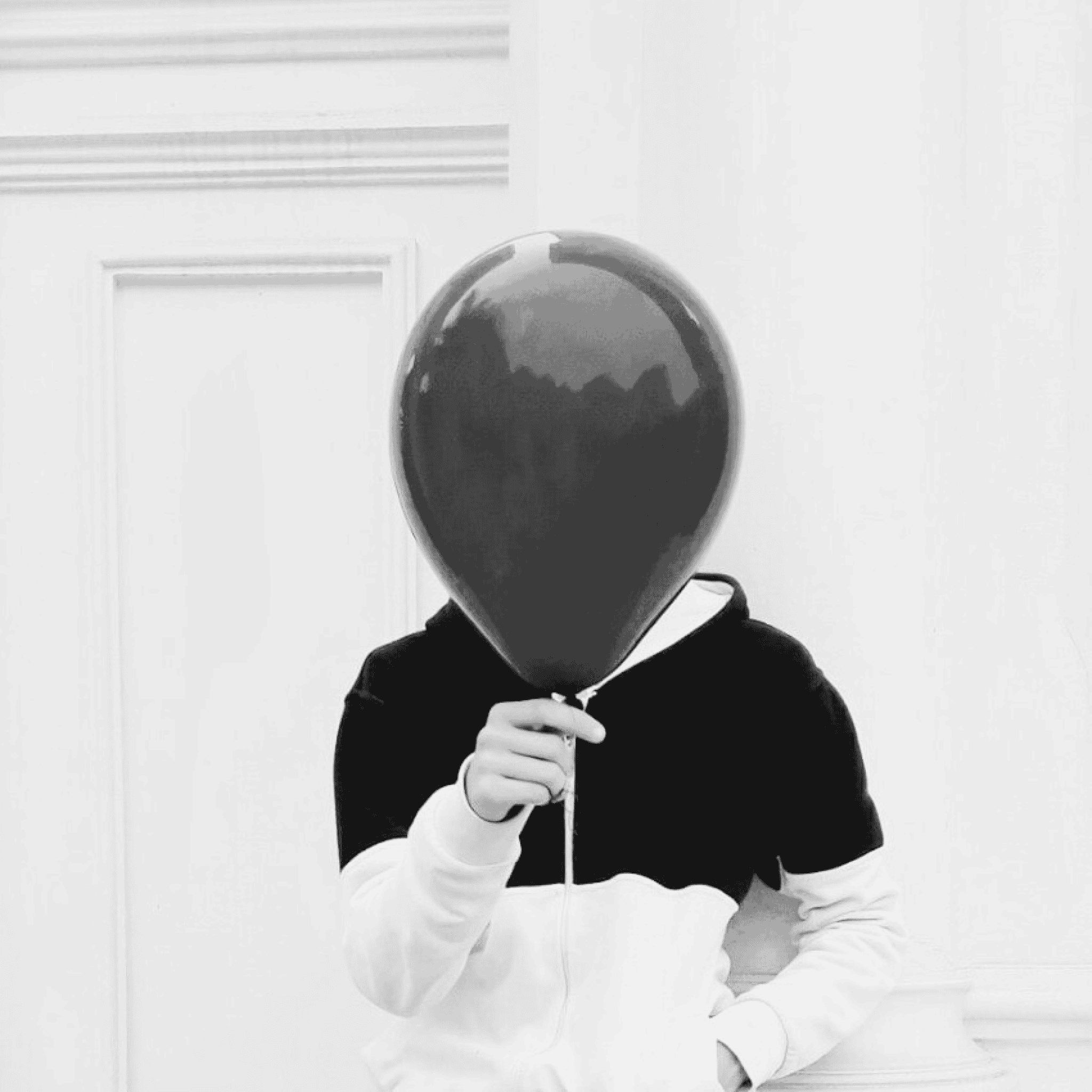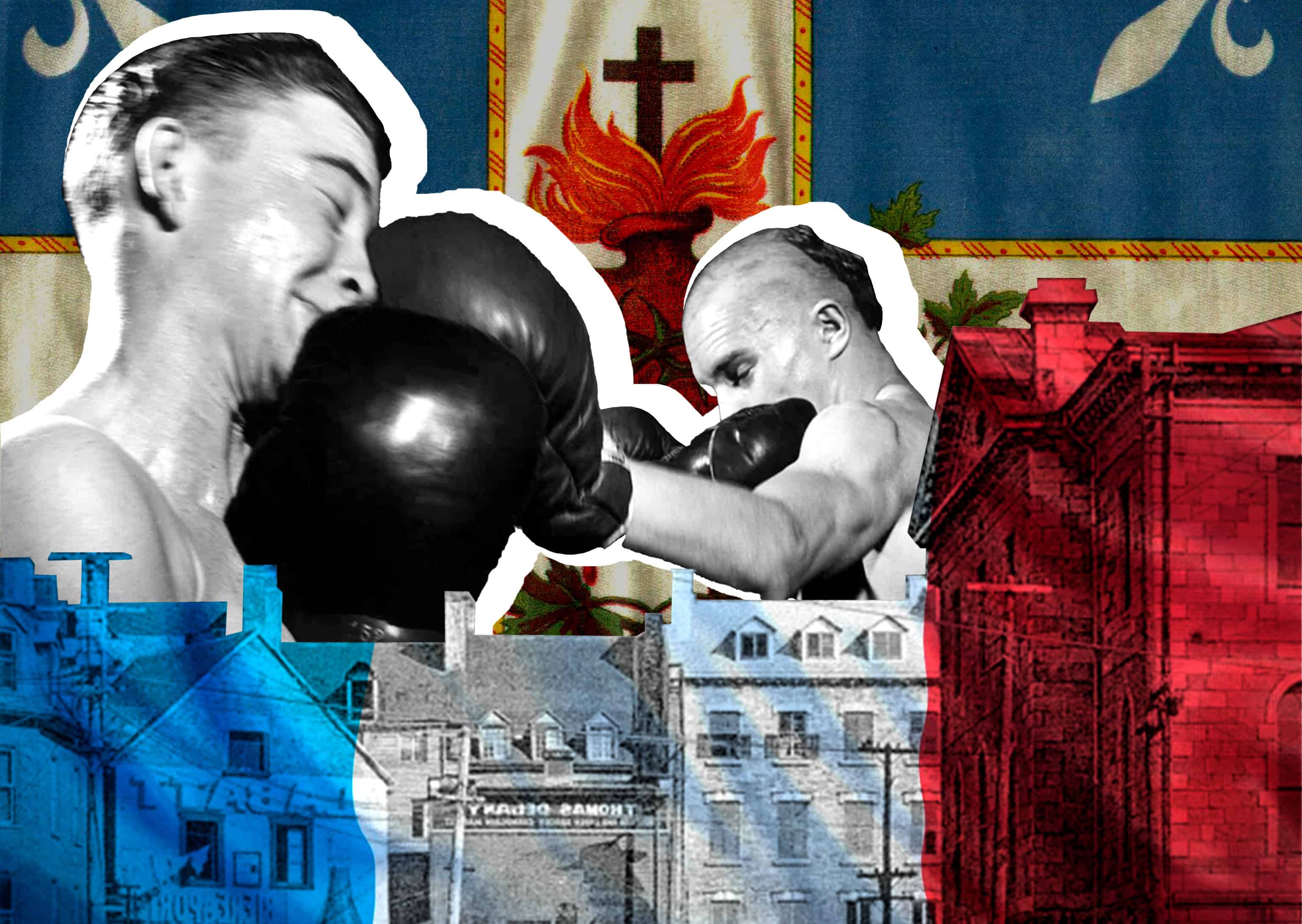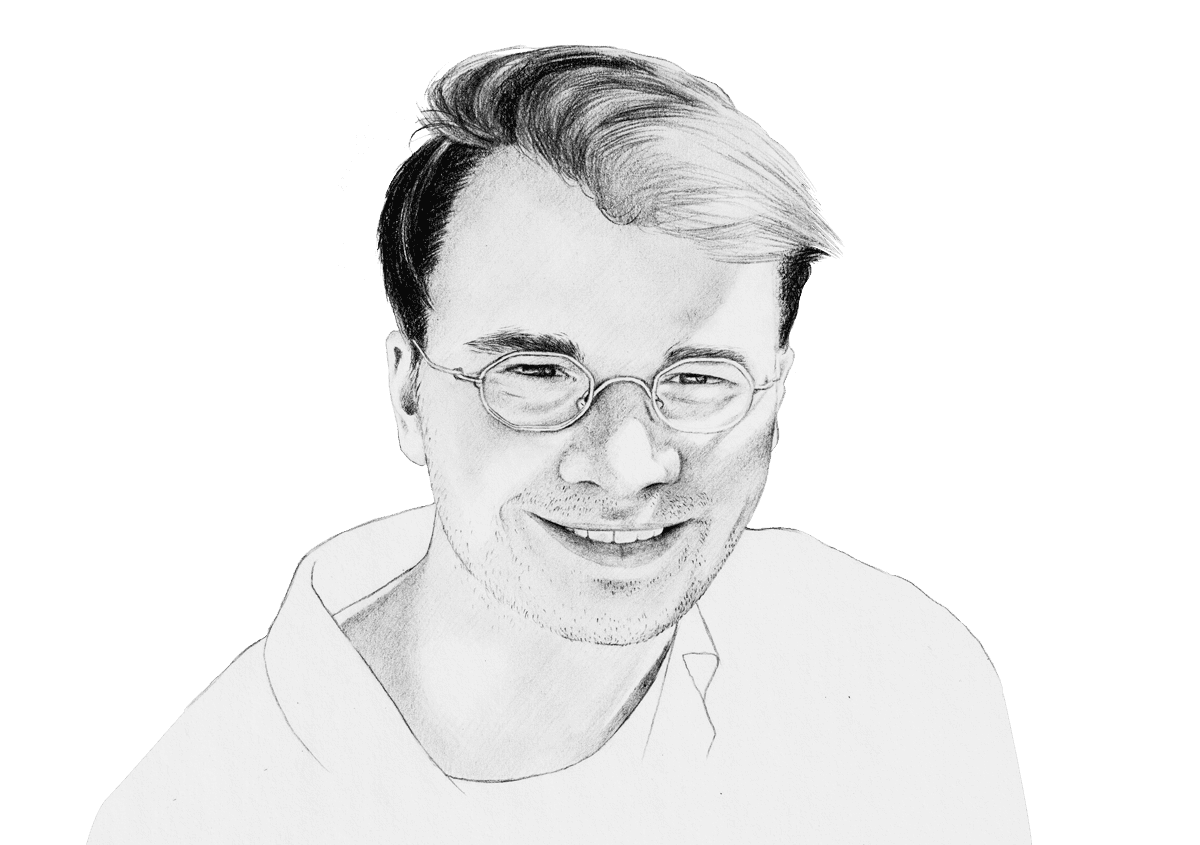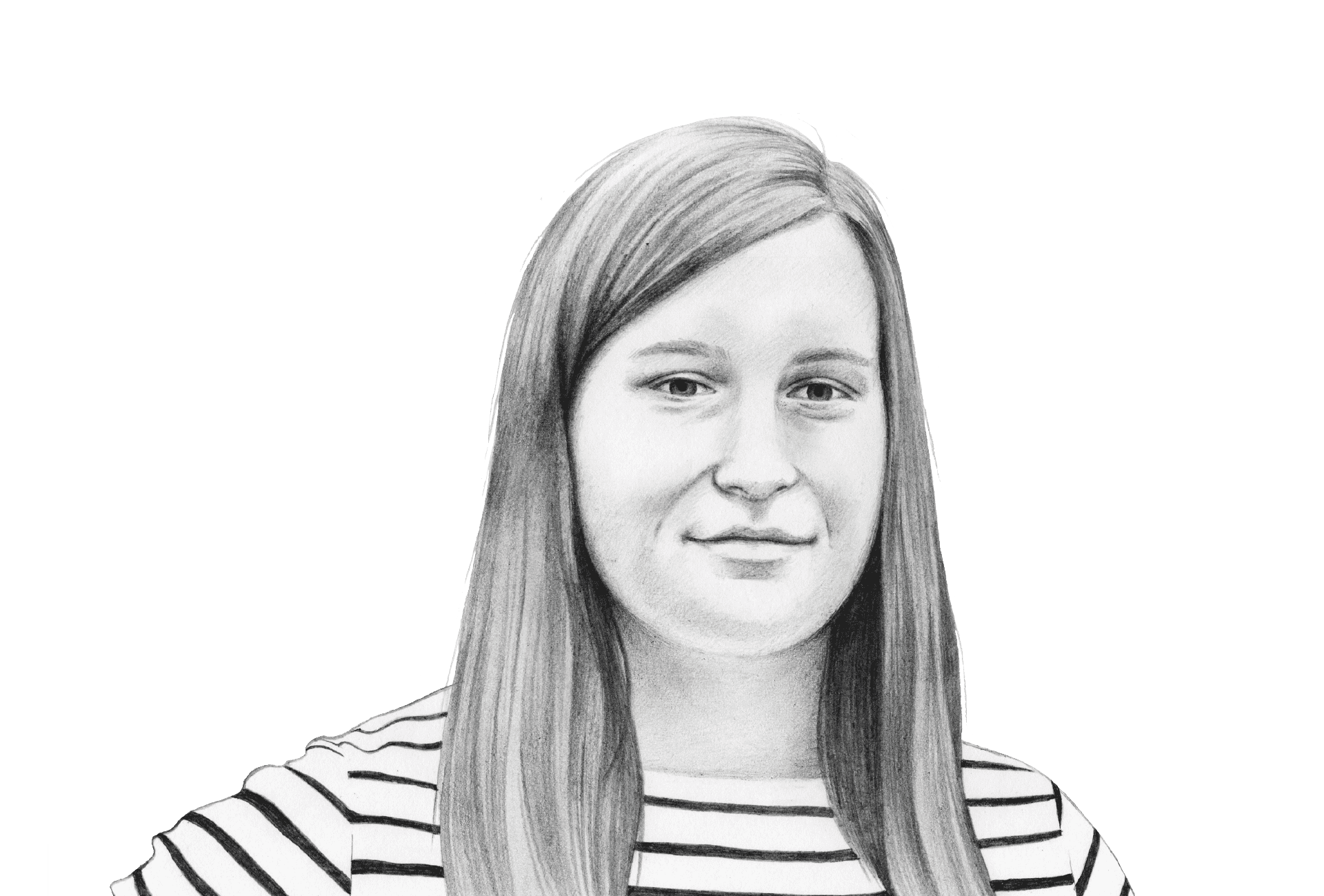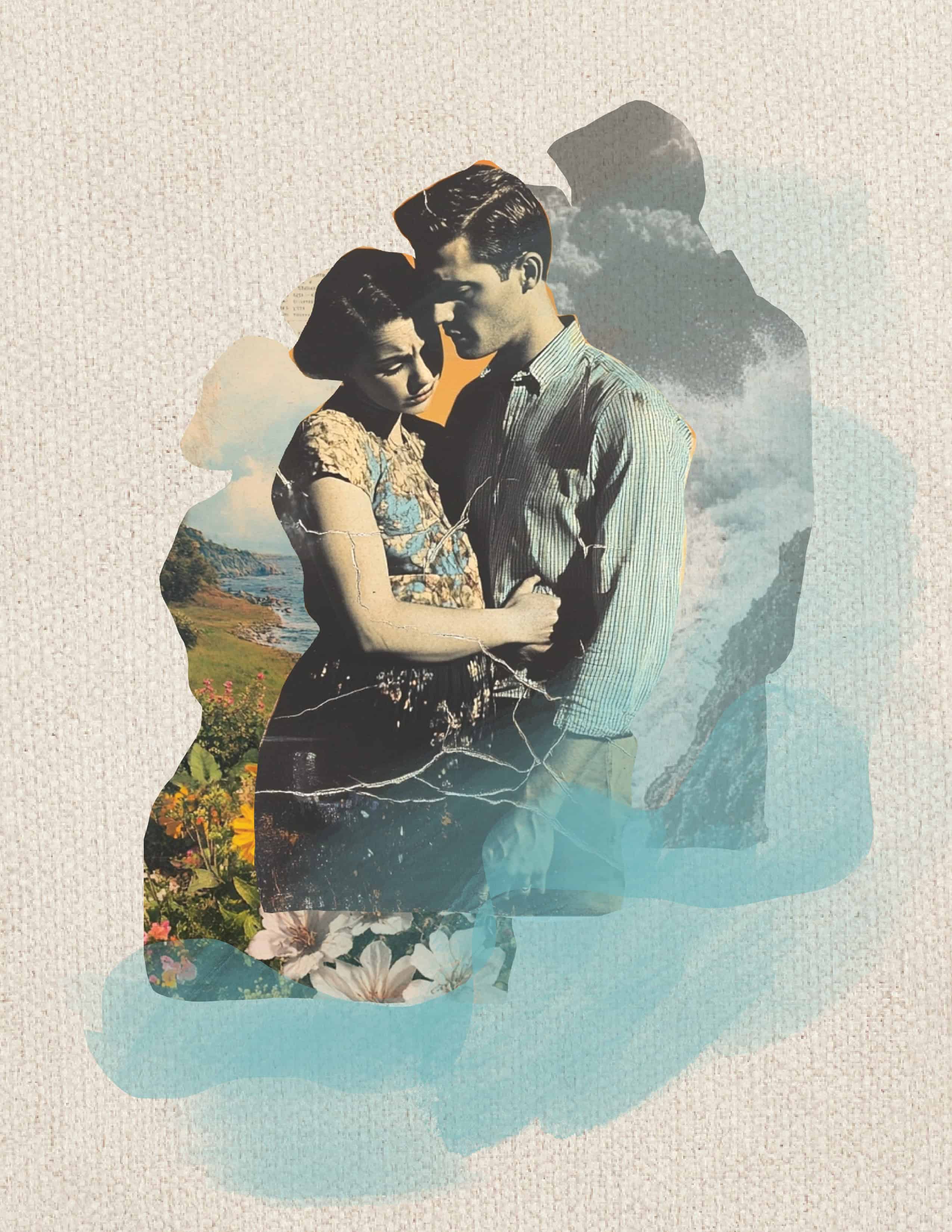« École religieuse » : une contradiction dans les termes ?
Texte écrit par Pierre-Luc Simard
Pénélope McQuade recevait récemment à son segment d’émission « Science et foi » Alain Crevier et Antony Bertrand-Grenier, physicien médical, pour discuter de la question des écoles religieuses. Pour ce dernier, une « école religieuse », c’est un oxymore, une contradiction dans les termes. Selon lui, la religion relève de la pure croyance et professe des dogmes impossibles à remettre en question, alors que l’école, au contraire, doit enseigner des savoirs. Retour aux sources pour tenter d’y voir plus clair.
La thèse de monsieur Bertrand-Grenier dépasse les enjeux de laïcité au Québec. C’est, insiste-t-il, fondamentalement une question de vérité : la religion n’éduque pas, elle conduit à l’erreur et à de mauvaises habitudes de penser. Sur quels arguments appuie-t-il sa thèse et, surtout, sont-ils valides ?
Ne me faites toutefois pas dire ce que je ne dis pas : les réponses ci-dessous ne prétendent pas être des preuves définitives et complètes, comme si on n’avait plus besoin d’y réfléchir. Plus humblement, le but est d’éveiller la curiosité, d’ouvrir la réflexion, car la question de Dieu et de la religion ne se laisse pas évacuer aussi facilement et superficiellement.
Créationnisme ou évolutionnisme ?
Tout d’abord, une école religieuse enseigne, affirme-t-il, le créationnisme, une doctrine pourtant réfutée par la théorie de l’évolution.
Il confond ici, malheureusement, la création et le créationnisme.
Le récit de la création dans la Genèse ne se lit pas au sens littéral. Nous ne sommes pas devant un traité cosmologique, mais plutôt devant un récit théologique : l’auteur utilise un langage imagé. Le Catéchisme de l’Église catholique (par. 337) explique : « L’Écriture présente l’œuvre du Créateur symboliquement comme une suite de six jours “de travail” divin qui s’achèvent sur le “repos” du septième jour. »
L’Église catholique soutient ainsi que la Bible ne contient aucun enseignement proprement scientifique au sujet de la nature de l’univers physique (Léon XIII, Providentissimus ; Pie XII, Humani Generis, 38). Saint Augustin, entre autres, donnait déjà une interprétation symbolique de la Genèse (De Genesi ad litteram I). Pour résumer à grands traits : Dieu, être éternel et immatériel, se trouve hors du temps et du changement. En créant l’univers, il crée le temps lui-même, et, avec lui, la matière et le mouvement. Ce n’est que de façon imagée qu’on peut ainsi en parler comme d’une activité répartie sur « six jours ». De même, Dieu ne se fatigue pas et ne se repose pas comme nous : il est parfait.
De plus, le mot « jour » ne renvoie pas à son sens habituel (un cycle jour/nuit), car ce n’est qu’au quatrième « jour », écrit la Genèse, que Dieu crée les astres et, avec eux, le début des cycles alternant le jour et la nuit. Saint Augustin l’a compris au Ve siècle après Jésus-Christ, bien avant de possibles objections de la science moderne.
Des milliers de religions
Antony Bertrand-Grenier avance aussi comme argument qu’il y a des milliers de religions et qu’elles se contredisent toutes entre elles. Dès lors, soit une seule est vraie, soit aucune ne l’est, raisonne-t-il. Il est ainsi beaucoup plus probable que la religion promue par l’école du coin soit fausse.
Comment, en effet, expliquer ce phénomène de la multiplicité des religions ? L’être humain, en observant le monde naturel, y perçoit l’ordre et la beauté, un peu comme une œuvre d’art créée par un artiste. En grec, d’ailleurs, cosmos signifie « ordre, bon ordre » et « ornement », d’où le terme « cosmétique ».
Si, de retour à la maison, je constate que la chambre de mes enfants est ordonnée, j’en conclus qu’un humain est passé par là, non pas qu’il y a eu un gros coup de vent. Il en va de même pour le monde créé : spontanément, on conclut que l’univers a été conçu par un être intelligent, un dieu. On n’est pas dans le domaine de la « pure croyance irrationnelle » ici, mais de la réflexion à partir de l’expérience.
Certes, ensuite l’imagination peut intervenir. On ne se contente pas de cette description encore floue du dieu, on essaie de le concrétiser davantage. C’est là que les erreurs et les hypothèses injustifiées surviennent parfois. On donne à ce dieu, par exemple, une forme humaine, ou on en imagine une multiplicité, plutôt qu’un seul, etc.
Il est donc faux de prétendre que toutes les religions se contredisent sur tous les aspects. Au contraire, elles s’accordent sur beaucoup d’éléments, ne serait-ce que l’existence d’une divinité à l’origine du cosmos.
Cette divinité aurait-elle décidé de se révéler d’une façon spéciale dans une religion ? Il semble que oui, et des arguments qui permettent de discerner laquelle existent. Mais, pour les découvrir, encore faut-il les chercher en évitant d’abord de placer toutes les religions sur le même pied. Le relativisme religieux n’est-il pas lui-même une croyance et un dogme non questionné ?
Un croyant n’est pas un connaissant
Antony poursuit : si on avait vraiment des preuves de l’existence de Dieu, alors on parlerait de « connaissants », non pas de « croyants ».
Ignore-t-il que de nombreux scientifiques et philosophes sérieux argumentent encore aujourd’hui pour l’existence de Dieu ? Des philosophes tels que Alvin Plantinga, Trent Horn ou Edward Feser, le mathématicien John Lennox, ou les physiciens Paul Davis et Freeman Dyson. Ce dernier écrit : « Plus j’examine l’univers et étudie les détails de son architecture, plus je trouve de preuves que l’univers, d’une quelconque manière, devait savoir que nous allions venir. » En résumé, c’est ce qu’on appelle l’argument du fin réglage de l’univers.
La fameuse théorie du bigbang, elle aussi, pointe assez directement vers Dieu. Son interprétation la plus naturelle suppose un début absolu du temps, de la matière, de l’énergie et de l’espace. L’astrophysicien Joseph Silk se prononce ainsi : « The beginning of time is unavoidable » (le début du temps est inévitable). Et, comme une cause est nécessaire à tout commencement, l’univers doit avoir une cause non matérielle, non temporelle et non spatiale… On s’approche drôlement d’un dieu !
Au 20e siècle, les scientifiques athées, dont Einstein, croyaient l’univers éternel. Il leur était alors plus facile d’imaginer un univers sans cause extérieure, divine. Mais c’est bien parce que le bigbang appelle spontanément un « créateur » qu’Einstein n’a pas voulu adhérer initialement à cette découverte. Devant l’évidence expérimentale, il s’est résolu à défendre l’existence d’une sorte de dieu responsable de l’univers et de ses lois.
Pourquoi alors parler de « croyants » plutôt que de « connaissants » ? Pour plusieurs raisons, sans doute. L’une d’elles est que la polysémie du terme « croire » rend mieux compte de l’expérience. Il signifie à la fois une opinion rationnellement fondée (croire aux changements climatiques, par exemple). Il désigne aussi l’acte ultime qui consiste à avoir confiance en la divinité, en sa parole (un peu comme la confiance que doivent avoir l’un envers l’autre les fiancés avant de se marier, par exemple).
*
Bien des facteurs aujourd’hui empêchent de se poser même la question de la foi. À commencer par le fait qu’on délègue toutes les questions sur le sens de la vie à la sphère privée et qu’on regarde tout phénomène « religieux » comme une supercherie. M. Bertrand-Grenier le dévoile bien dans l’entrevue : pour lui, la foi, c’est par définition « croire sans preuve », un pur saut dans le vide. Et, sincèrement, je peux comprendre son point de vue. J’avais exactement le même il n’y a pas si longtemps encore. J’ai toutefois expérimenté qu’il suffit d’ouvrir une petite brèche dans cette vision un peu réductrice pour tout changer : ce n’est qu’après m’être sérieusement informé sur le sujet que mes préjugés ont pu tomber.
Vous avez des questions concernant la validité de la foi ? Poursuivez votre lecture ici.