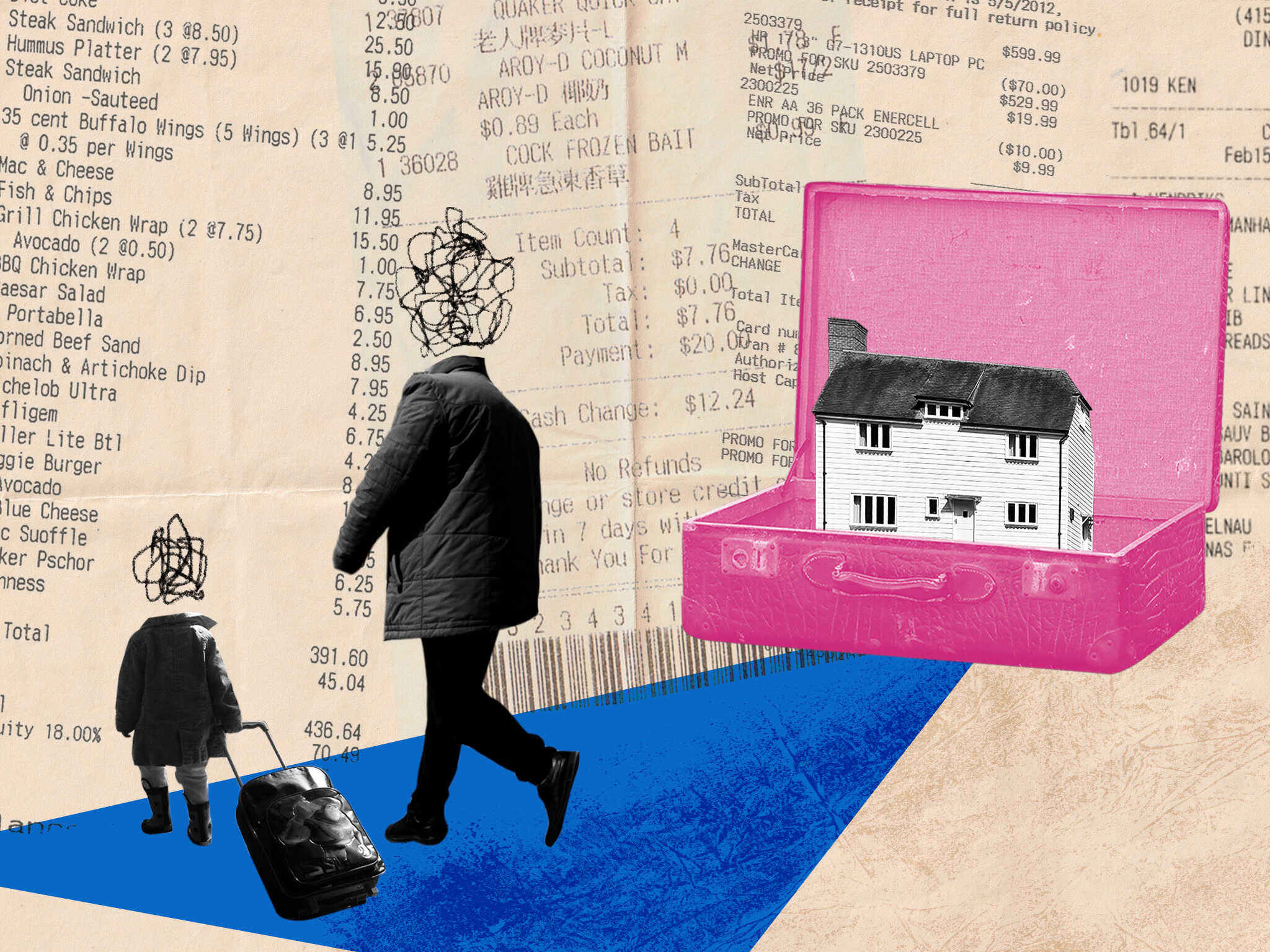Réhabiliter par le plein-air avec le Projet en Marche
Vous avez foulé les sentiers de la Vallée Bras-du-Nord ou dévalé ses pentes en vélo de montagne, mais vous n’en connaissez pas encore toute la beauté. Dans ce décor, des jeunes vivent une démarche d’insertion socioprofessionnelle par le travail en plein air. C’est la gang du Projet en Marche. Avec beaucoup de sueur et de soin, les participants donnent vie au parc. Le Verbe est allé à leur rencontre.
L’air est humide, mais le soleil qui perce entre les feuilles nous réchauffe. Escortés avidement par les moustiques et autres frappe-abords, nous suivons dans un sentier une dizaine de jeunes. Ils portent bêches, barres à mine et masses par-dessus leurs épaules. Après avoir roulé à travers les magnifiques paysages de la vallée du Bras-du-Nord, nous nous retrouvons au cœur du parc avec les participants du Projet en Marche.
L’initiative s’adresse à des jeunes de 16 à 35 ans qui éprouvent des difficultés en lien avec leur employabilité ou leur parcours scolaire. Plusieurs d’entre eux ont «commencé leur histoire en ce bas monde avec une roche dans le soulier», nous dit Étienne Beaumont, coordonnateur du projet que ce soit avec des problèmes de consommation ou encore des troubles de comportements. On leur propose alors de vivre une expérience de travail rémunéré de six mois pendant lesquels ils aménagent les sentiers qu’emprunteront les marcheurs et les adeptes de vélo de montagne.
Le taux de réussite a de quoi impressionner: plus de 75 % des participants intègrent ou réintègrent par la suite le marché du travail ou le milieu scolaire. Mais, pour le coordonnateur, c’est beaucoup plus qu’une question de réorientation professionnelle, c’est un «projet d’actualisation de soi».
«C’est un temps d’arrêt dans la vie des jeunes. Ils prennent un pas de recul, puis se posent vraiment des questions. Qu’est-ce qu’ils veulent faire dans la vie? C’est quoi leurs objectifs, leurs rêves? Ils apprennent à se connaitre.»
S’éprouver dans la nature
 Photo : Marie Laliberté/Le Verbe
Photo : Marie Laliberté/Le Verbe
Le contact avec la nature joue un rôle fondamental dans cette démarche de reconnexion à soi. Le simple fait d’être dans le bois, de supporter les aléas de la météo et de se concentrer sur des gestes concrets comme dégager des roches ou déplacer de la terre leur permet d’expérimenter une persévérance insoupçonnée. Il y a dans cette confrontation à l’adversité des éléments une véritable rencontre avec des dimensions jusque-là inconnues d’eux-mêmes. «Pour te reconnecter à ton environnement, tu n’as pas le choix de te reconnecter à toi. Tout ça est lié», explique Étienne.
Avec en bruit de fond le fracas des roches qu’on casse à coup de masse, Laurie nous parle de ce que cet effort physique et mental quotidien lui apporte comme sentiment d’accomplissement. «Si je suis capable [de faire ce qui est demandé], il n’y a rien que je ne suis pas capable de faire», nous dit-elle. C’est cette évolution constante, au fil des limites une à une dépassées, qui lui donne une nouvelle source de valorisation.
En plus du travail dans les sentiers, les jeunes sont appelés à vivre toutes sortes d’expériences significatives en nature, comme une nuit seuls en forêt, une expédition de plusieurs jours ou encore une activité de spéléologie dans les grottes de Saint-Casimir. Ces moments charnières servent éventuellement donner de la profondeur à d’autres exercices. Par exemple, explique Étienne, lorsqu’il sera question de «rentrer à l’intérieur de soi et d’aller explorer ses zones d’ombres», les jeunes auront un «référent hyper affectif» à partir duquel travailler grâce à leur aventure dans les grottes.
Se retrouver à partir des autres
Assise sur un tronc d’arbre, Laeticia nous confie ne pas être sortie du tout de chez elle l’année précédente à cause de son anxiété sociale. Pour elle, le simple fait de converser avec une journaliste aurait été impensable avant le Projet en Marche. Mais le travail d’équipe lui a appris à s’affirmer et à s’habituer au contact des autres: «ça change une vie!»
Cette sortie de soi pour aller vers l’autre est probablement l’aspect le plus transformant du projet pour les jeunes. Si plusieurs ont l’habitude de travailler avec de la musique dans les oreilles pour mieux se concentrer, ici c’est interdit. Cet espace est réservé aux bruits de la nature et, surtout, aux échanges. Certains pensent que c’est parfois aux dépens d’une plus grande efficacité, mais la plupart s’entendent pour dire que ces discussions spontanées nourrissent souvent des réflexions profondes et intimes.
Évidemment, tout n’est pas que gazouillis et ciel bleu lorsqu’il est question de relations humaines; les orages grondent aussi. Les conflits tendent à éclater surtout lorsque la faim et la fatigue se mettent de la partie. «On a tous des personnalités fortes », nous dit Laurie. L’impatience, les petites et grandes colères font elles aussi partie de l’aventure. «On s’ajuste: toi aux autres et les autres à toi».
 Photo : Marie Laliberté/Le Verbe
Photo : Marie Laliberté/Le Verbe
La relation avec les intervenants est elle aussi importante pour consolider les progrès que font les participants. Jasmine, la psychoéducatrice qui accompagne les groupes tout en travaillant le terrain avec eux, explique que les jeunes ont tous des histoires complexes et manifestent souvent une certaine méfiance au premier abord. Or, il faut comprendre qu’«ils ont besoin de gens significatifs avec qui parler, des modèles qui les valident dans leurs valeurs».
En tout, trois intervenants suivent le groupe en forêt. «C’est un gros ratio d’encadrement», convient Étienne. Les rôles sont multiples et parfois juxtaposés. Le casque blanc qui supervise et aide aux travaux en profite également pour assurer certains suivis individuels lorsque l’occasion s’y prête. Le but de la démarche est simple: repartir à la fin du projet avec un sac à dos rempli d’outils pour être autonome par la suite, même lors d’éventuelles rechutes.
Se connecter à ce qui nous dépasse
Pour Alexandre, qui a participé au projet il y a trois ans et fait maintenant partie de l’équipe permanente de la vallée, le fait d’évoluer dans des paysages qui «passent l’épreuve du temps» est très significatif. Contempler le décor d’une vallée glaciaire qui constituait la pointe nord de la mer de Champlain subjugue. Savoir que nos ancêtres s’y trouvaient bien avant nous et ont aussi travaillé dur pour s’acclimater enracine. Tout cela montre qu’on est «devant plus grand que nous». Pour Étienne, c’est «être dans quelque chose qui est un peu intemporel, qui reconnecte à une présence qui n’est pas simplement humaine».
«On a besoin de beau et d’émerveillement», nous dit Laurie, pour qui ce sentiment donne envie de créer à son tour, et d’«explorer les possibilités du monde». Les jeunes ont l’occasion de le faire dans le cadre d’activités comme les camps littéraires de brousse avec le poète Jean Désy, ou encore lors d’ateliers de création de bracelets à partir de racines de conifères. «L’espoir, curieusement, a besoin de créativité», affirme Étienne.
 Photo : Marie Laliberté/Le Verbe
Photo : Marie Laliberté/Le Verbe
Se mettre à la suite de saint François d’Assise
Aller vers l’autre, contempler les beautés de la nature et ce vers quoi elles pointent, veiller à protéger les plus démunis sont autant d’éléments caractéristiques de la vie d’un saint dont Étienne se sent particulièrement proche: François d’Assisse. Il ne cache pas son admiration pour celui dont les qualités lui ont inspiré sa «mission de vie».
«Pour moi, saint François d’Assise est une figure universellement inspirante. D’abord par sa communion fine avec la nature et le vivant. Il est une des premières figures à incarner l’écologisme et la défense de l’environnement, ainsi qu’une spiritualité où la contemplation mène directement à une vie spirituelle forte et une action bienveillante.»
Les valeurs qui animent les gens derrière le Projet en Marche, tout comme la nature dans laquelle les participants évoluent, transcendent les époques. Voilà ce vers quoi cheminent ceux qui se lancent dans l’aventure. C’est une mise en marche vers soi, vers l’autre, vers la contemplation de plus grand que soi et vers l’espoir que cela fait naitre.