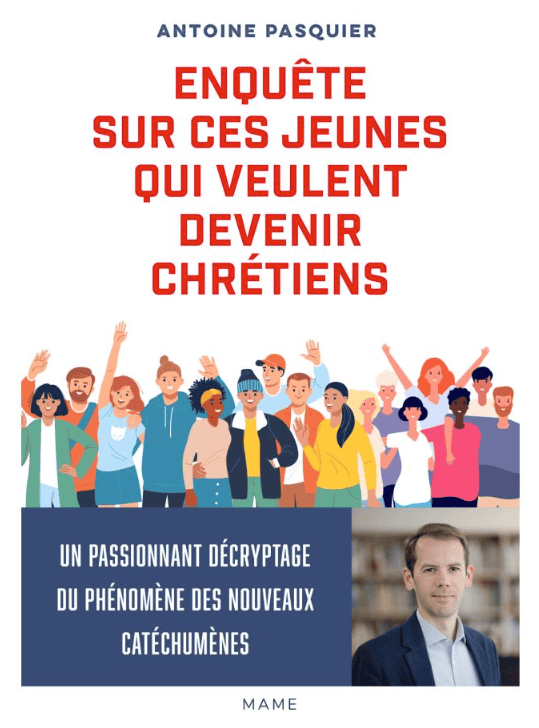Quand le numérique mène à Dieu
«J’aimerais ça aller dans une église, mais à cause de la Covid, elles sont toutes fermées.» C’est la bouteille lancée par William dans la mer numérique de Twitter (X) depuis sa chambre de Saint-Lambert-de-Lauzon. Depuis réouvertes, les églises sont visitées par de nombreux zoomers qui, dans bien des cas, demandent maintenant le baptême. Sans être un mouvement de masse, le phénomène n’en demeure pas moins palpable sur le Web et dans les milieux chrétiens partout en Occident.
Le cri du cœur de William ne retentit pas dans le désert. Il reçoit un message en privé de Milina, une jeune Montréalaise qui contredit son affirmation sur le statut des lieux de culte. C’est ainsi que débute la conversation entre deux jeunes adultes qui se suivent mutuellement jusqu’à se marier, en décembre 2024. Née dans une famille protestante, Milina l’invite à se joindre à un groupe d’études bibliques sur Zoom. William répond favorablement.
Dans les mois qui précèdent les faits, ce dernier renonce à des études en musique passablement altérées par le contexte pandémique. Alors que son travail aussi est rendu impraticable, il plonge à pieds joints dans le monde d’Internet. «La vie n’était pas très rose. J’avais beaucoup d’épisodes dépressifs qui se sont intensifiés parce que je n’avais plus rien à faire. J’avais alors cette échappatoire où j’avais des amis: on partageait, on débattait, on riait, on jouait, etc. Ça m’a vraiment fait du bien.»
Les canaux privés sur Twitter et les serveurs Discord deviennent ses principaux lieux de socialisation. William suit attentivement des pages catholiques et québécoises. Il avoue avoir flirté avec quelques théories extrêmes ou conspirationnistes, sans pour autant sombrer dans l’activisme. Derrière son vif intérêt pour des sujets comme l’argent, la religion ou la nutrition se trame le désir d’une sorte de «paternité virtuelle».
«Je pense que je cherchais la vérité à propos de la vie. Je voulais savoir quoi faire et comment le faire.»
Grandes amitiés
La rencontre de Milina est pour William «le départ de quelque chose de nouveau. C’était plein d’espoir», se rappelle-t-il. Les deux futurs époux se fixent plusieurs rendez-vous hivernaux dans la métropole malgré les aléas des mesures sanitaires. Des sentiments réciproques commencent à naitre.
À l’invitation du responsable du groupe d’étude biblique, William commence à intégrer une communauté protestante de Québec. Milina en profite pour le suivre dans la capitale nationale, question de faciliter le développement de leur relation.
Le chrétien en devenir connait toutefois des insatisfactions concernant certains points de vue exprimés dans cette communauté, notamment en ce qui concerne le rôle des saints et de Marie, la mère de Jésus. Après tout, il est d’abord entré en contact avec la foi chrétienne – avant sa rencontre avec Milina – par l’intermédiaire d’un catholique sur Discord, cette plateforme de messagerie instantanée spécialement populaire chez les joueurs de jeux vidéos. Ce dernier le dirige vers plusieurs ressources en ligne pour prier et lire la Bible.
À son église, les réponses que William reçoit aux objections qu’il pose ne le satisfont pas. Il décide finalement d’aller en chercher ailleurs. Milina n’adhère pas non plus à certaines doctrines de leur communauté. Ensemble, ils papillonnent d’une église à l’autre à Québec – toutes dénominations confondues –, cherchant un endroit qui leur convient à tous les deux.
Celui qui se définit comme «très rationnel dans sa recherche de vérité» intensifie son examen du catholicisme. Il finit par y tendre fortement, d’une manière délibérée. Milina reste plus passive devant les divergences de fond entre les différentes Églises chrétiennes, jusqu’à ce que la révérence d’une messe catholique vienne la bouleverser.
Avec William, elle peut discuter et réfléchir énormément. Les plateformes connues sur le Web sont également d’une grande aide: «J'avais un attrait pour l’Église catholique, mais mon intelligence me disait qu’elle n’avait pas de sens. J’ai dressé une liste de toutes les objections que j'avais contre elle. Une à une, elles sont tombées, surtout grâce à des ressources en ligne comme Catholic Answers, ou des balados comme Pints with Aquinas», explique Milina.
 Illustration: Marie Laliberté/Le Verbe
Illustration: Marie Laliberté/Le Verbe
Accélérateur numérique
Ces derniers temps, partout en Occident, de jeunes adultes comme William et Milina cognent aux portes de l’Église. Plusieurs indices laissent penser que ce n’est qu’un début. En France seulement, le nombre de jeunes adultes de 18 à 25 ans qui demandent le baptême a quadruplé dans les cinq dernières années – sans compter ceux qui ont reçu le baptême à la naissance et qui retournent à l’Église plus tard.
Dans ce contexte, un ouvrage parait cet automne: Enquête sur ces jeunes qui veulent devenir chrétiens. Sortie de pandémie, réseaux sociaux, influenceurs, société liquide: pour l’auteur Antoine Pasquier, on ne peut pas réduire le phénomène à une seule cause. Lui-même accompagnateur de jeunes qui se préparent au baptême dans sa paroisse, il est conscient que chaque parcours est unique. Il fait néanmoins ressortir certains points de convergence entre eux, comme l’omniprésence du numérique. «Il n’est pas à l’origine de leur conversion ou de leur questionnement», précise-t-il. «Les jeunes ont des questions déjà avant, et le numérique arrive vraiment au moment où ils ont besoin de réponses.»
Dans son enquête, Pasquier explique qu’il est très rare qu’une personne demande le baptême après avoir regardé une vidéo. «Ces médias viennent plutôt compléter une réflexion.» L’auteur parle même d’un «rôle d’accélérateur». Ce n’est un secret pour personne: la génération Z est née avec un téléphone intelligent à la main. Son premier réflexe est de se tourner vers Internet pour trouver des réponses à ses questions, même existentielles.
«Les influenceurs ont un rôle assez important. Tous les jeunes que j'ai pu interroger connaissaient ou suivaient plus ou moins des influenceurs chrétiens catholiques en France, et parfois même aux États-Unis pour ceux qui étaient un peu anglophones», ajoute le journaliste.
Connaitre son semblable
Parmi ces influenceurs, on compte Victor Dubois de Montreynaud, appelé «le catho de service» sur les réseaux. À 25 ans, il compte environ 480 000 abonnés, toutes plateformes confondues, dont environ 10 % du Québec selon son estimation. Ses vidéos suscitent entre deux et trois-millions de visionnements par mois. Sur Instagram, où il cumule 117 000 abonnés, la moyenne d’âge est de 25 ans. Elle est encore plus basse sur TikTok. Le semblable connait son semblable, dit-on.
Pour Victor aussi, l’aventure commence durant la pandémie. Consterné devant des églises ouvertes, mais où aucune messe n’est célébrée, il publie une vidéo sur YouTube.
Ce qui n’est au début qu’un passetemps pour évangéliser devient un travail à temps plein, soutenu par une équipe technique et des donateurs privés. À l’image de ceux à qui il s’adresse, Victor fait aussi un cheminement intellectuel et spirituel pour confirmer la foi qu’il a reçue de ses parents. Il se pose des questions existentielles et en discute avec d’autres. Chaque fois, «ce sont les réponses de l'Église catholique qui me semblaient les plus convaincantes», dit-il. «Je voulais des arguments. Si c'est la vérité, alors il faut des preuves que c'est la vérité.»
Quand on lui demande s’il perçoit cette vague virtuelle de jeunes qui s’intéressent à la foi, il répond sans ambages: «Je pense qu'on ne peut que le voir. Je reçois énormément de messages. Et ce sont des gens qui ont des questions spirituelles fortes. Ils veulent savoir si Dieu existe, comprendre ce qui leur arrive, ce qu’est la Trinité, comment lire la Bible ou aller à la messe pour la première fois.»
Du virtuel au réel
«Internet n’est pas un simple outil, c’est un nouvel espace de vie et de rencontres», explique Antoine Pasquier dans son livre, citant le jésuite Antonio Spadaro, qui a écrit sur la «cyberthéologie». C’est d’autant plus vrai en temps de pandémie, pour des jeunes comme William. Le «catho de service» partage aussi cette vision. Pour lui, Internet n’est pas un monde extérieur ou différent de la vie réelle, mais un prolongement de cette dernière: «Moi, je veux parler à de vraies personnes. Je sais que, quand ils écoutent des vidéos, ils sont dans leur canapé, les transports ou les toilettes.»
On peut penser que la tentation du zoomer est de rester dans le confort, satisfait par la flexibilité que le numérique lui donne. Au dire d’Antoine Pasquier, pourtant, il semble que non. Ces jeunes «comprennent que le virtuel à lui seul ne comblera pas leur quête. Ils ressentent alors le besoin de rencontrer des chrétiens sur le terrain», écrit-il.
Victor, abondant dans le même sens, précise que «la foi ne doit pas s'arrêter à Internet. Les réseaux sociaux ne sont qu’un pont. On doit encourager les gens à aller à l’église, à parler à un prêtre, à faire partie d’un groupe de prière, d’une paroisse, etc. La foi chrétienne, c'est la religion de l'incarnation. La foi doit elle aussi être incarnée».
C’est du moins l’expérience de Milina et de William, qui ont finalement établi leurs pénates dans une paroisse de la Haute-Ville de Québec avec plusieurs amis, «tous des convertis après la Covid». On y voit désormais ces jeunes adultes se faire baptiser, se mettre au chant grégorien ou à l’étude du catéchisme, des réalités pratiquement inexistantes au cours des dernières décennies.
Les jeunes de la génération Z n'ont jamais eu à se convertir au numérique; ils sont tombés dedans quand ils étaient petits. Mais pour plusieurs d'entre eux, il semble que leur parcours de conversion passe désormais par le numérique.
Et comme le dit l'adage évangélique: «Qui cherche trouve.»