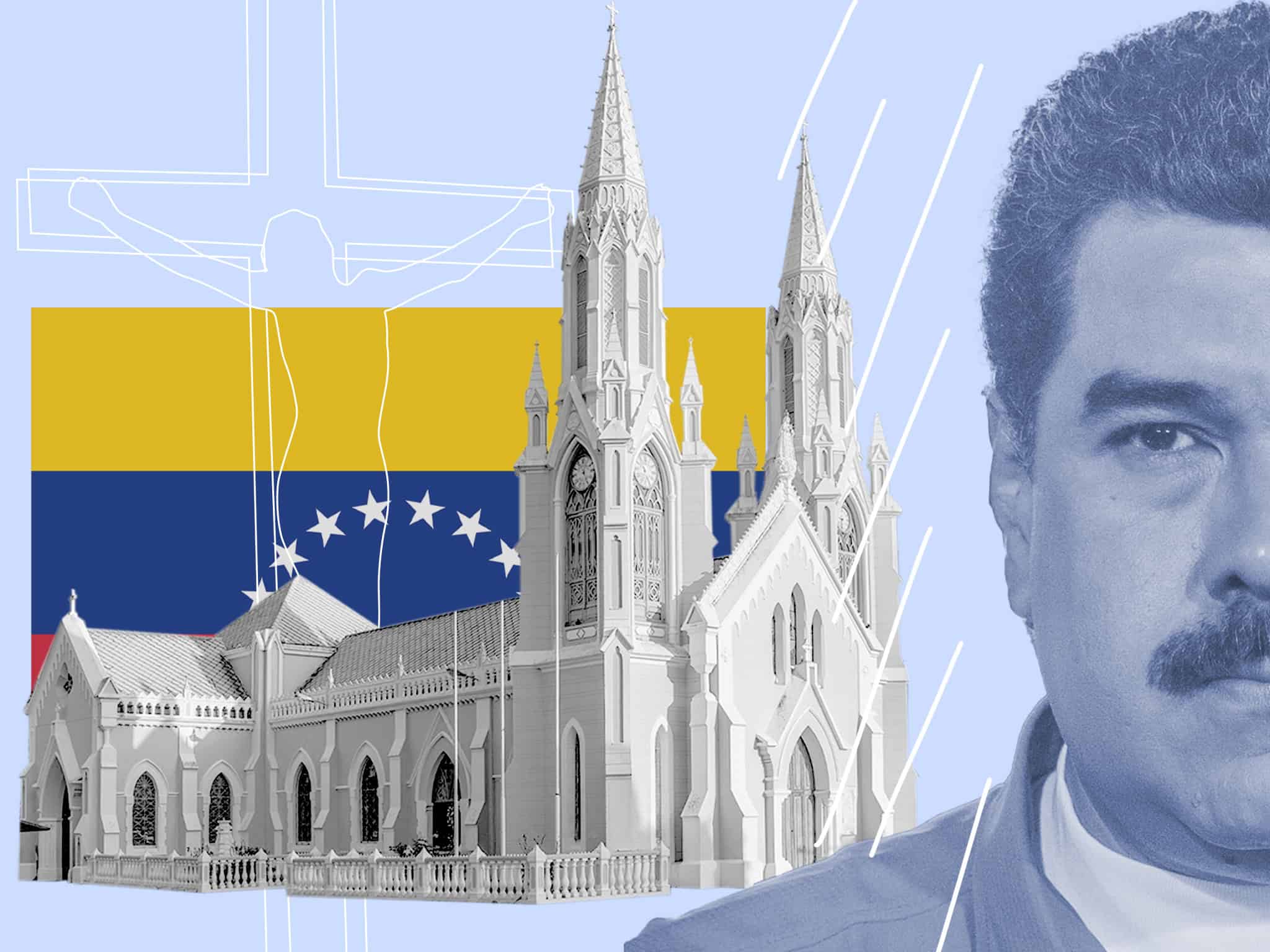Femme libérée?
La «question de la femme» m’a toujours habitée. J’en ai même déjà fait le thème d’un projet de mémoire de maitrise qui n’a jamais abouti. Une de mes motivations résidait dans l’impression d’être quelque peu prisonnière, contre mon gré, d’un récit collectif qu’il était impossible de remettre en question sans passer pour une «antiféministe». Le récit de notre histoire nationale est aujourd’hui de plus en plus revisité pour réévaluer la rupture totale qu’aurait représentée notre Révolution tranquille. Ne serait-ce pas aussi l’occasion de réfléchir à neuf sur celui, complexe, de la libération de la femme? J’ai voulu ici faire un petit tour de la question, avec des historiens et quelques autres «femmes d’aujourd’hui».
Si les récits permettent de raconter des histoires, ils racontent aussi l’histoire. Le processus implique un choix nécessaire, une certaine transformation du réel chaotique en une narration ordonnée des évènements qui viennent construire notre mémoire commune.
Cette expérience de mise en récit de la réalité passée permet l’élaboration de l’identité des personnes comme des collectivités. D’où la gravité de l’erreur possible, du mensonge involontaire, du manque de nuances ou de l’illusion simplificatrice. Il en résulte une représentation faussée de soi-même qui empêche de voir clairement aussi bien le présent que le futur.
Trouble dans le récit
La majorité des historiens du Québec semblent aujourd’hui s’être mis d’accord sur un point: le récit selon lequel notre «modernité» serait survenue tout d’un coup en 1960 avec l’élection du gouvernement de Jean Lesage se déconstruit peu à peu. Les années soixante représenteraient bien plutôt l’accélération d’un processus de modernisation déjà en branle depuis cette époque qu’on continue pourtant d’appeler la Grande Noirceur.
Malgré ce consensus, la pensée ambiante reste marquée par l’imaginaire qui entoure la Révolution tranquille. Selon Éric Bédard, historien et auteur de L’histoire du Québec pour les nuls, trois aspects sont directement associés à cette «période bénie» des années soixante: «La reconquête politique et économique de nous-mêmes (Caisse de dépôt, débuts du mouvement indépendantiste), l’État-providence, et une certaine révolution anthropologique des mœurs (sécularisation, émancipation des femmes), qui n’est toutefois pas propre au Québec.»
Cette dernière dimension du récit qui concerne l’avènement de la femme moderne semble s’être consolidée au fil des années. Qui oserait remettre en question l’équation entre, par exemple, la libération de la femme et le contrôle sur son propre corps qu’ont permis l’avortement et la pilule? Entre l’«amour libre» et le véritable épanouissement sexuel? Entre le clergé et l’oppression? Les voix qui vont à l’encontre de ce qui passe aujourd’hui pour des évidences sont pour le moins dissonantes.
Un «travail souterrain»
L’une de ces voix est celle de Michael Gauvreau, l’historien ontarien qui nous a donné l’ouvrage Les origines catholiques de la Révolution tranquille. Dans trois chapitres centraux du livre, il s’intéresse particulièrement aux questions de la famille, de la femme et de la sexualité. On y découvre un exemple de ce qu’Éric Bédard appelle le «travail souterrain [qui s’est opéré] au sein même de l’Église», bien avant la Révolution tranquille.
En effet, Gauvreau constate, en fouillant dans des centaines d’archives, que dès la fin des années 1930, des groupes issus de l’Action catholique, particulièrement celui de la Jeunesse ouvrière catholique (JOC) qui met en place un service de préparation au mariage (SPM), s’affairaient à transformer de l’intérieur l’institution de la famille. Ces mouvements laïcs partaient du constat qu’il existait un «fort mécontentement» indéniable chez les femmes catholiques. Le malaise se situait surtout autour de la question de la procréation et de la régulation des naissances.
Mais dans le service de préparation au mariage, on invitait les couples à s’efforcer de mieux comprendre le cycle menstruel de la femme, et on les initiait à des méthodes comme celle d’Ogino-Knaus (mieux connue sous le nom de «méthode du calendrier»). Il s’agissait d’ajuster les relations intimes en fonction des périodes de fertilité et d’infertilité du cycle menstruel de la femme, si le couple souhaitait espacer les naissances. Et tout cela bien avant qu’il soit question de contraception dans la société en général.
Ce qui frappe à la lecture de ces chapitres, c’est l’insistance qui est mise sur l’importance de l’épanouissement de la femme au sein du couple. Les cours de préparation au mariage – offerts dans le cadre ecclésial, faut-il le souligner – sont l’occasion d’éduquer non seulement sur l’anatomie féminine, mais aussi sur la dimension psychologique de celle qui est appelée à devenir mère. On va même jusqu’à mettre de l’avant le plaisir sexuel féminin comme étant la condition d’un équilibre nécessaire à l’harmonie du couple, et donc de la famille.
Une divine sexualité
Il y avait ainsi à l’époque un véritable effort de valorisation du mariage et de la famille, qui devait prendre acte des écueils que vivaient les femmes en particulier. En fait, c’est tout le rapport à la sexualité qui était amené à être réévalué dans le cadre de la préparation au mariage. En effet, la vision qui associait l’acte sexuel à quelque chose de purement charnel, voire animal, fait place à une perspective qui laisse entrevoir la possibilité d’une expérience hautement spirituelle de la sexualité. Le message était qu’«on pouvait atteindre une spiritualité et la rencontre de Dieu à travers les relations du mariage», nous dit Michael Gauvreau. «Le mariage était vraiment le fondement de la spiritualité laïque dans la société moderne.»
Denyse Baillargeon, historienne québécoise spécialiste de l’histoire des femmes, va dans le même sens: «On présente la sexualité comme étant un cadeau de Dieu, en quelque sorte. Donc, on a le droit de jouir de sa sexualité parce que ça fait partie du grand plan divin.» Cette vision des choses est vécue comme une grande libération pour de nombreuses femmes de l’époque.
La liberté dans l’abandon
Trois générations plus tard, qu’en pensent les jeunes croyantes d’aujourd’hui? Comment vivent-elles, en 2025, leur rapport au récit de la femme moderne? Un des regrets qui revient le plus souvent lorsqu’on interroge celles qui ont choisi de vivre dans la foi catholique, c’est l’idée qu’un certain féminisme ait accaparé la notion de liberté. En effet, il semble aller de soi, dans le discours dominant, que les nouveautés comme le libre accès à la pilule contraceptive et le droit à l’avortement sont les conditions de possibilité de ce qu’on a appelé la «libération sexuelle». Or, pour Valérie, 30 ans, c’est l’arrêt de la prise de contraceptifs qu’elle a vécu comme une véritable libération. «C’est une réappropriation de son corps», dit-elle.
Fanny (nom fictif), 27 ans, parle aussi de ce contrôle excessif de la nature que représente la prise d’anovulants, dont on mesure mal les impacts sur la santé, selon elle. Elle croit que cela entraine également une sorte de «distorsion dans les relations amoureuses»: être «tout le temps disponible» pour son partenaire provoque à son avis une certaine «objectification du corps», comme si la femme est toujours à la disposition de son conjoint.
Pour Valérie, la véritable égalité entre hommes et femmes ne doit pas passer par une tentative de rendre la femme semblable à l’homme en «aplatissant son cycle», autrement dit en niant les variations hormonales proprement féminines. «Égal, ça ne veut pas dire pareil», selon elle.
Pauline, infirmière de 32 ans et mère de trois enfants, nous explique quant à elle que vivre selon des principes qui contrastent avec le discours ambiant peut être exigeant. «Les gens te regardent.» Elle sent parfois que sa voix n’est pas «audible par tout le monde», entre autres parce que «les gens ne comprennent pas ça, l’abandon» par rapport à ce qui peut arriver lorsqu’on reste «ouvert à la vie». Mais il faut voir que cela n’écarte en rien le discernement propre à chaque femme: «Si Dieu nous a créées avec notre intelligence, c’est pour qu’on l’utilise, et aussi pour qu’on puisse utiliser notre liberté.» Fanny abonde dans le même sens. Pour elle, l’alignement avec l’enseignement catholique est une véritable expression de son autonomie. «C’est dans ma liberté que j’adhère à ces choses-là.»
Un récit à renouveler
Il n’y a pas que dans les milieux catholiques que le récit de la femme moderne est remis en question. On entend de plus en plus de voix, issues des milieux alterféministes ou écoféministes, s’élever contre la banalisation de l’avortement et la prise en continu de la pilule contraceptive, par exemple. Certains, comme la sexologue belge Thérèse Hargot, feront aussi le lien entre ces pratiques et l’hypersexualisation dénoncée, à juste titre, chez les adolescents. Des propos qui peinent cependant à se faire entendre à travers le discours ambiant qui promeut une vision de la sexualité qu’il est difficile et courageux de remettre en question. Une jeune femme qui choisit, en toute liberté, la chasteté continue d’être perçue comme rétrograde et antiféministe.
Pourtant, lorsqu’on approfondit les enseignements de l’Église relatifs à la sexualité et à l’épanouissement des deux partenaires, on perçoit tout le potentiel émancipatoire que recèle une vie dans la foi pour les femmes. Tout du moins, ils offrent une perspective autre que celle qui réduit l’activité sexuelle à un simple besoin physiologique qu’il est impératif d’assouvir.
Et lorsqu’on y regarde de plus près, c’est véritablement l’aménagement d’un nouvel espace de liberté pour les femmes que les mouvements de l’Action catholique des années 1930 et 1940 proposaient déjà, en concordance avec les principes qui devaient guider les familles catholiques. Selon Gauvreau, «ces mouvements ont contribué à faire émerger, puis à imposer, une image plus libre et plus égalitaire de la femme, où le déterminisme biologique faisait place au libre choix, et donc à la capacité particulière de la femme d’affirmer et de perfectionner la nature spirituelle de sa personne». Il nous invite donc à revoir le récit selon lequel «les exigences féminines de plus de liberté sexuelle et d’égalité politique sont le produit de la révolution culturelle des années 1960, survenue après des années de répression et de silence», et reconnaitre qu’il y avait au sein de l’Église un courant de fond qui offrait les bases d’une autre émancipation.