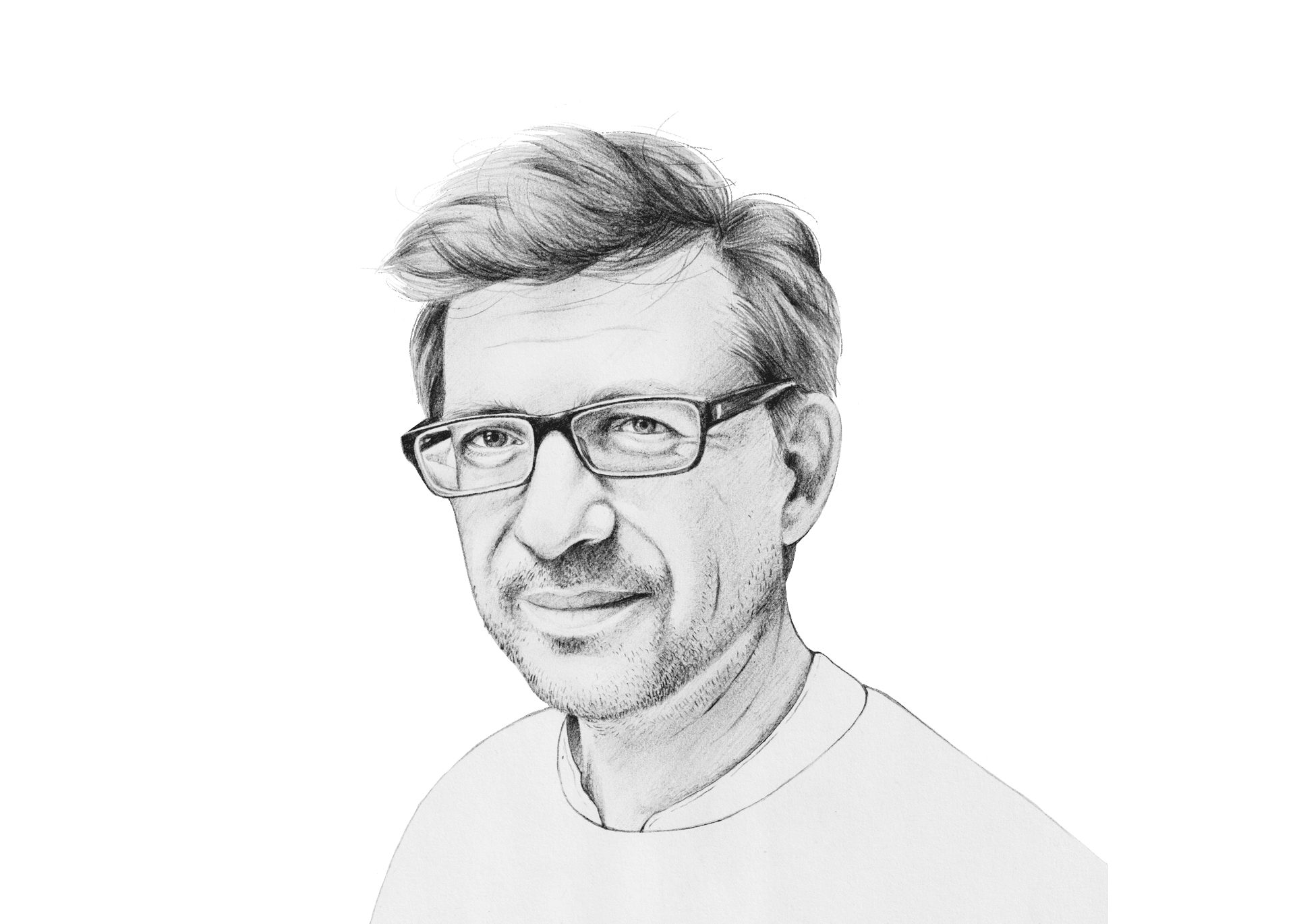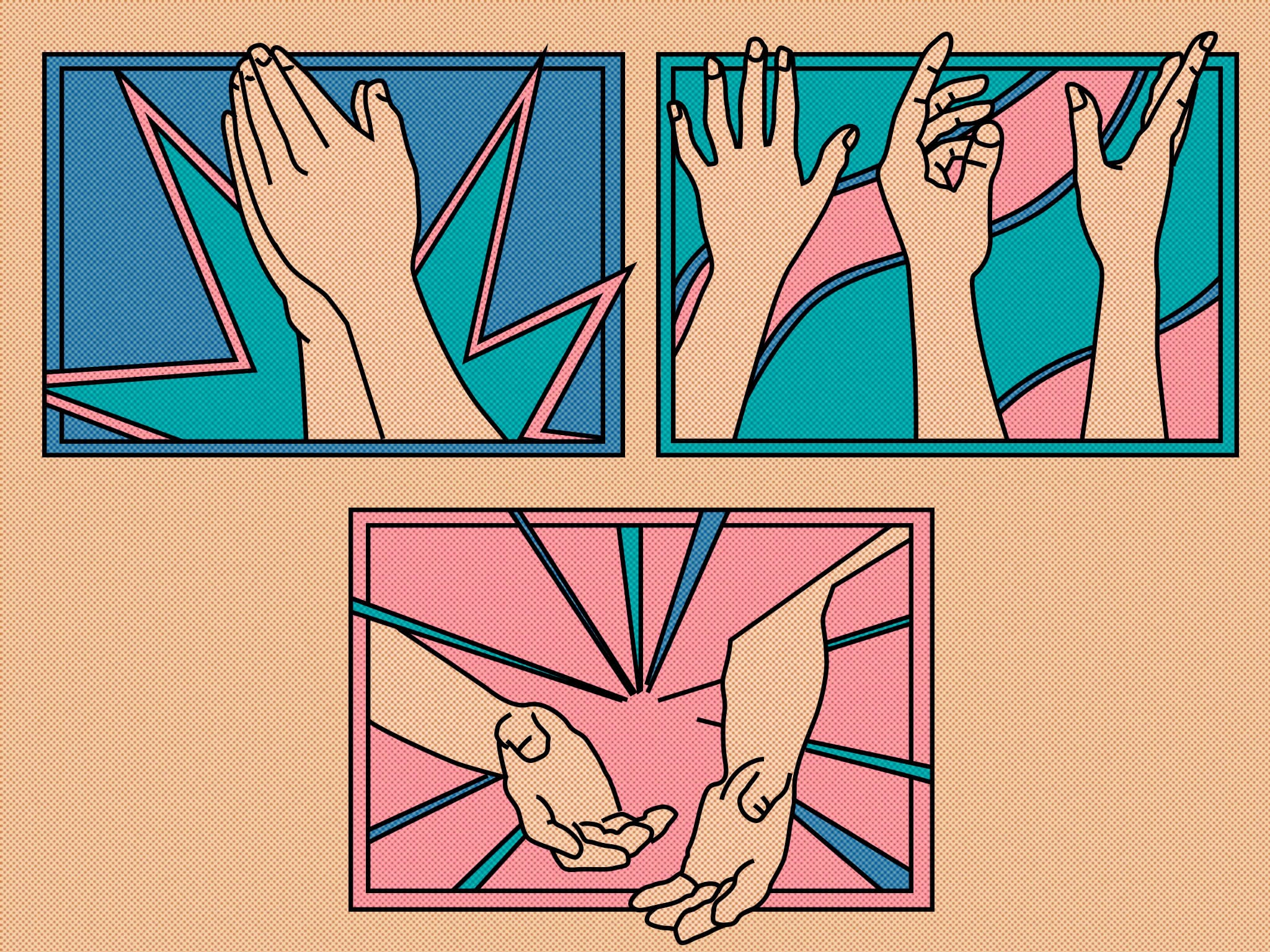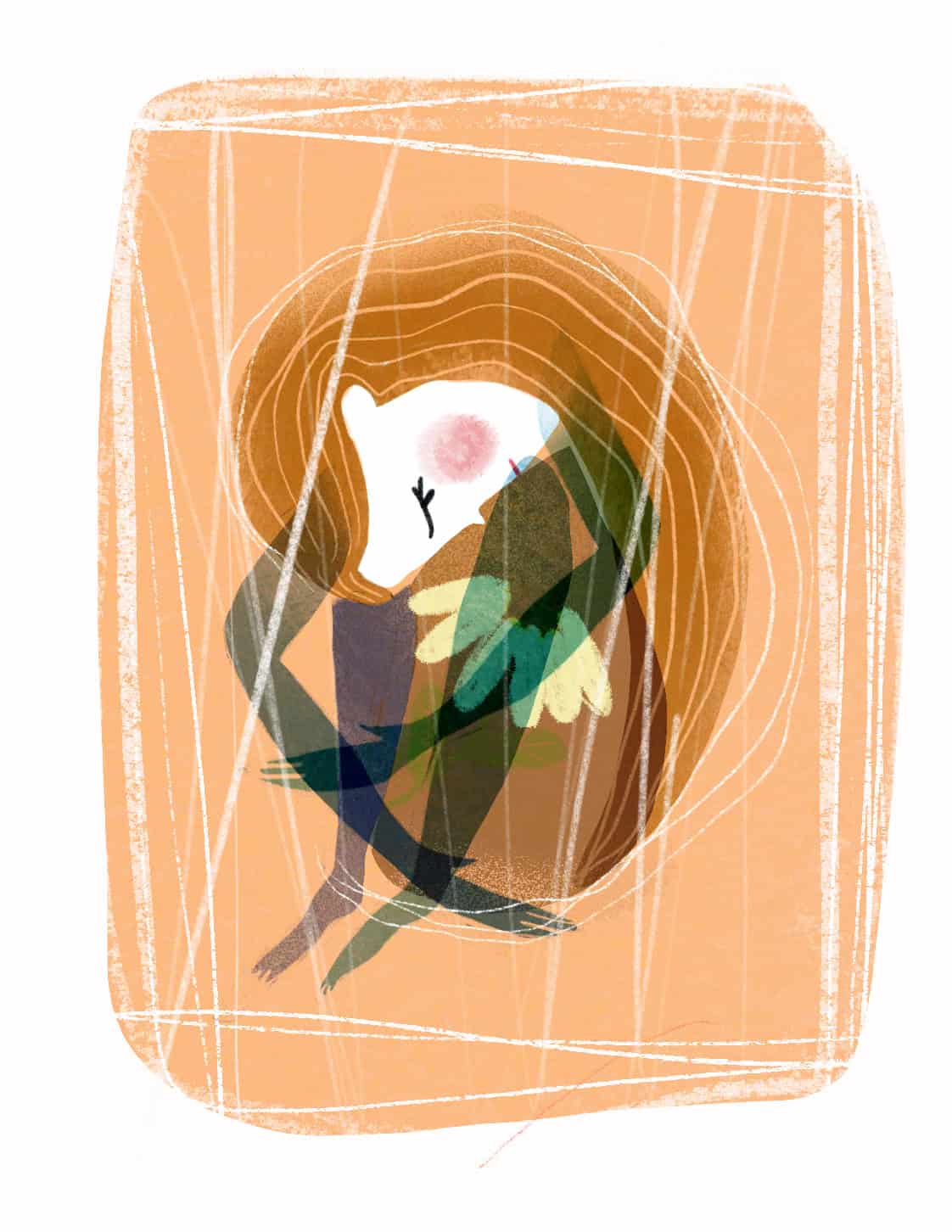Enquête sur la cyberdépendance
S’endetter de plusieurs milliers de dollars pour acheter des boucliers virtuels dans un jeu en ligne. Occuper son temps libre de la semaine en passant une soixantaine d’heures sur Internet. Consacrer des années à tenter de battre d’une demi-seconde le record du jeu Mario Bros. Comme l’accro aux lignes de coke, le consommateur compulsif des technologies subit des conséquences tout aussi dommageables pour sa vie. Regard sur les racines d’un malêtre exacerbé par le pouvoir d’attraction des plateformes numériques.
Au centre de traitement et de prévention des dépendances Casa, à Saint-Augustin-de-Desmaures, des bagages attendent dans le hall d’entrée. Ils appartiennent à un nouvel arrivant qui s’apprête à vivre 28 jours loin des tentations dans l’espoir d’un second départ. Quelle que soit la dépendance, le centre accueille qui veut s’en sortir.
Dès l’arrivée, le cellulaire est placé sous clé. Une fois par semaine, le résident pourra contacter ses proches avec un téléphone fixe. Une déconnexion contrôlée essentielle pour reconnecter avec sa liberté intérieure, particulièrement salutaire au gamer ou à l’accroc aux réseaux sociaux.
Maxime Verreault, intervenant psychosocial au centre Casa, m’explique que le pas le plus difficile à franchir pour un cyberdépendant est celui qui le sort de chez lui. «Souvent, les cyberdépendants sont introvertis. Arriver avec des gens qu'ils ne connaissent pas en thérapie, c'est tout un défi.»
Les nouveaux parcs
C’est pour rencontrer ceux qui se terrent dans leur sous-sol et peinent à en sortir que Jean-Christophe Filosa œuvre, quant à lui, à la Fondation des Gardiens virtuels en tant que travailleur de rue numérique. Pour rejoindre les jeunes de 14 à 25 ans, il faut aller là où ils se retrouvent: sur Internet. L’an dernier, l’organisme a fait 1500 interventions en ligne.
«On a remplacé les parcs par les diffuseurs. On sait que les jeunes naviguent sur le Net. Soixante pour cent du temps, c'est pour aller voir des streamers», m’explique l’ancien travailleur de rue. Pour rejoindre une nouvelle clientèle, il est lui-même passé du réel au virtuel. Son métier n’existe pas encore ailleurs.
Une entente avec 60 diffuseurs du Québec permet aux travailleurs numériques d’assurer une présence anonyme dans le clavardage des plateformes Twitch et Discord. Participer à une discussion en utilisant un pseudonyme, tout en écoutant une diffuseuse en direct présenter ses hamsters, est un processus moins exigeant que de téléphoner dans un centre d’aide. «Du clavardage, c'est beaucoup moins émotionnel à la base, et les jeunes se sentent plus en contrôle.»
En filigrane, la cyberdépendance et les autres enjeux «cyber», comme le cyberharcèlement, ressortent souvent des échanges. Jean-Christophe Filosa me donne en exemple un jeune dont la performance sportive en milieu scolaire est médiocre. L’intimidation se fait en ligne plutôt que sur le jeu, quand on lui suggère de se retirer de l’équipe. «La frontière entre la vie réelle et le numérique est beaucoup plus fine qu'avant», observe-t-il.
Frontières floues
«Les seuls vrais natifs de la technologie sont nés en 2010, en même temps que la tablette», constate Magali Dufour, professeure et chercheuse au département de psychologie de l’UQAM.
«Le jeu vidéo a été reconnu par l’Organisation mondiale de la santé comme étant un problème de la famille des dépendances, mais en ce qui a trait aux autres applications d’Internet, il faut bien situer le débat dans le temps. Une fenêtre de 14 ans, c’est très peu pour documenter l’ampleur d’une problématique», commente la chercheuse.
Au centre Casa, Maxime Verreault reçoit régulièrement des appels de parents inquiets de la consommation de leur enfant. Où tracer la ligne entre cyberdépendance et usage normal, alors que les normes d’utilisation ne sont pas bien définies?
«Des parents me disent que leur fils a un problème de cyberdépendance, qu’il joue beaucoup à Fortnite. Mais il a une blonde, joue au hockey, réussit bien à l’école. D’autres pourraient jouer moins et dépenser des sommes importantes. Ce n'est pas toujours une question de temps alloué, c’est plus une question de conséquences et de détresse», m’explique M. Verreault.
Lorsque la vie virtuelle empiète sur la vie réelle au détriment des responsabilités, il y a un signal d’alarme à ne pas négliger. «Quand on parle de perte de contrôle, on parle d'une utilisation plus grande que ce qu'on voudrait. On va souvent voir des sept heures consécutives sur Internet sans manger, par exemple. On va négliger ses tâches. Et il faut que ce soit répété», soutient madame Dufour.
Shot de dopamine
Enchainant les dépendances les unes après les autres, Guillaume développe un attrait irrésistible pour son téléphone cellulaire pendant le confinement. Il ne le quitte plus.
«Tu cherches le plaisir, mais tu ne sais plus où l’obtenir quand tu n’es pas heureux. Je suis devenu multimillionnaire, je faisais de gros soupers, six voyages par année. Et la COVID tombe. Plus de restos, plus de voyages, plus personne à épater, c’était une grosse claque dans la face.»
Il se met à passer en moyenne huit heures par jour sur son téléphone, essentiellement pour lire et commenter des posts sur les réseaux sociaux. Sa copine lui répète sans arrêt de lâcher son gadget.
«Je savais que j'avais un problème, je n'étais plus bien. Quand tu scrolles, tu cherches la shot de dopamine, le mini instant de bonheur. Tu scrolles sans fin. C'était devenu un automatisme. Même quand je regardais un film, j’étais sur mon téléphone», en rit aujourd’hui Guillaume.
Maxime Verreault observe bien que, pour le cyberdépendant, habitué à la stimulation, les activités «normales» perdent leur saveur. Écouter un professeur de français, aussi passionnant soit-il, quand on a gamé toute la nuit, n’excite pas autant les neurones. «Nous sommes des êtres qui recherchent des activités qui nous font du bien. Tout ce qui nous amène du plaisir instantané est susceptible de nous conduire à une compulsion.»
D’ailleurs, n’est-ce pas sur ce principe que tablent les compagnies pour rendre leurs plateformes numériques toujours plus attrayantes et rentables? Elles vont même jusqu’à utiliser des mécanismes empruntés aux jeux de hasard et d’argent pour engranger davantage de profits. «Il y a le même système dans les jeux vidéos, dans les missions où il y a des prix aléatoires, avec des gradations de rareté. Tu éprouves un thrill quand tu récoltes quelque chose de plus rare. Ça touche au mécanisme du gambling», se désole l’intervenant.
«Quand tu scrolles, tu cherches la shot de dopamine , le mini instant de bonheur.»
Pas qu’un problème individuel
Dans une étude menée par Magali Dufour, 40% des jeunes pensent avoir un problème avec Internet. Dans les faits, selon la chercheuse, on parlerait plutôt de 3 à 5% de dépendance clinique et de 10 à 15% d’usage à risque. «Comment ça se fait qu’autant de gens pensent avoir un problème? En fait, on ne sait pas trop où se situer par rapport à notre propre utilisation», analyse-t-elle.
Lutter contre le vortex numérique ne devrait pas reposer entièrement sur nos seules forces individuelles. «En tant que société, on est en train de se mettre des normes, de se demander quand utiliser [les technologies] ou pas. C'est clair qu'il devrait y avoir une régulation de ce domaine-là, et ce n'est pas nécessairement l'industrie qui va s'autoréguler. Au contraire, elle tente surtout de vendre des données. Ce serait intéressant que les gouvernements leur demandent des comptes pour protéger les plus vulnérables. Et même si l’on ne l’est pas, on peut vouloir ne pas être assailli de cette façon-là. Ce n'est pas seulement à l'individu de se contrôler, ça va au-delà de ça», pense madame Dufour.
Reconnexion
Quand Maxime voit les résidents du centre Casa repartir avec leur valise et leur téléphone, il sait que la lutte n’est pas gagnée. L’approche à privilégier n’est pas nécessairement une austère abstinence, mais plutôt une relation plus saine aux technologies pour viser un nouvel équilibre.
«En thérapie, ils réussissent à éprouver du plaisir autrement, réapprennent à se faire confiance et à connecter avec d’autres. Ça donne un élan pour la suite. Ne plus avoir son téléphone, au départ, c'est particulier. Après un certain temps, ça leur fait du bien et ils ne sont quasiment plus stressés de le récupérer après. Il faut comprendre les besoins derrière les excès. Qu'est-ce qui fait que j'ai une relation malsaine aux technos? C'est possible de rétablir une relation saine», conclut M. Verreault.
Pour d’autres, le chemin du salut semble relever du mystère, de la grâce. C’est le cas de Guillaume, qui a fini par se libérer de son téléphone, ou plutôt de son vide intérieur, en vivant une expérience spirituelle.
Apprenant que son père est atteint d’une maladie dégénérative, il tente le tout pour le tout: l’amener à Lourdes, lieu de pèlerinage reconnu pour ses miracles. Si son père n’a pas été guéri, lui l’a été.
«Au retour, ma blonde me demande ce qu’il se passe. Pas de téléphone dans les mains, je regardais les oiseaux, les arbres dehors. Je sentais une présence, quelque chose qui m'apaisait. Depuis, ma vie s'est recentrée et je ne ressens plus le genre de vide intérieur qui fait que tu es toujours à la recherche de quelque chose.»
Embrasser le réel, tout simplement. Quand le virtuel empêche de le faire, n’est-ce pas que la ligne est sur le point d’être franchie?
Ce contenu n'a pas été chargé automatiquement puisqu'il provient d'un fournisseur externe qui pourrait ne pas respecter vos préférences en matière de témoins.