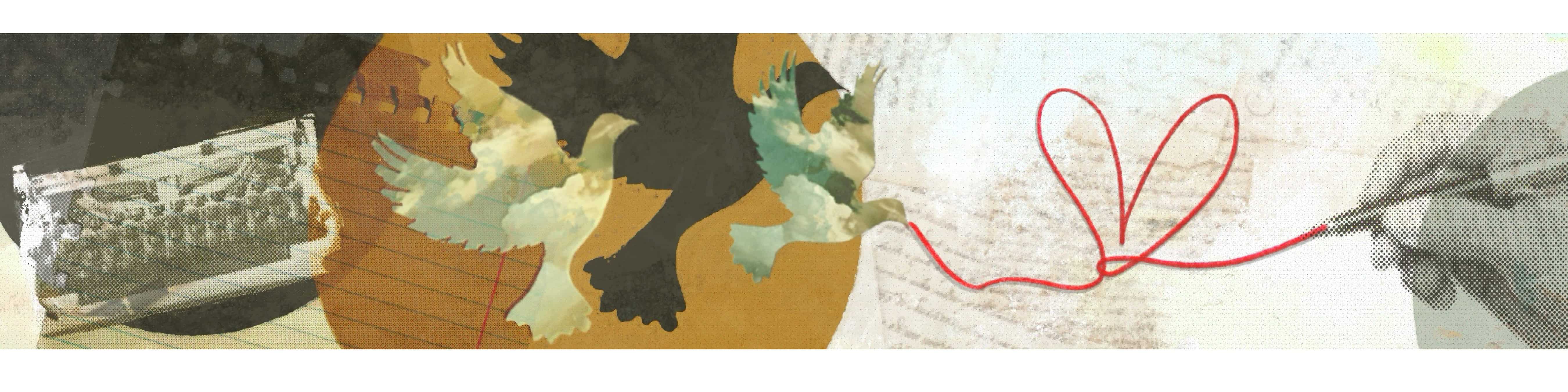
Des mots pour guérir
Huor cherche à traverser son deuil, Christine à briser l’isolement des utilisateurs de drogues et Diane à défaire les stéréotypes entourant les problèmes de santé mentale. Ils sont d’origines et de conditions sociales différentes et vivent des problématiques tout à fait éloignées les unes des autres. Ils ont pourtant fait l’expérience, chacun à leur manière, du pouvoir de la parole dans leur vie et celle des autres. Zoom sur trois œuvres qui utilisent la communication comme moyen de rétablissement.
Christine Généreux se décrit d’emblée comme une consommatrice de drogues. L’an dernier seulement, elle perdait trois amis, victimes de surdoses. La drogue, la pauvreté, elle connait, bien qu’elle soit sortie de la rue il y a six ans maintenant. Depuis 2023, elle collabore avec L’Injecteur, une revue gratuite produite par L’Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogues (AQPSUD). La revue est écrite par et pour des personnes comme elle.
«Je suis allée me faire sevrer d’alcool récemment, j’ai donc écrit sur ma thérapie. Je peux donner des recommandations ou des conseils pour ceux qui voudraient vivre la même chose», explique-t-elle. Pair-aidante pour les femmes itinérantes à Sherbrooke et militante pour la défense des droits et l’inclusion des personnes qui consomment des drogues, Christine cherche par-dessus tout à participer à la réduction des méfaits dans sa communauté ou, comme elle le dit, à «allumer des lumières pour les gens».
«Quand on est lu, approuvé, et qu’on découvre qu’on est moins seul qu’on le pensait, c’est motivant et mobilisant.» – Michaël Dumouchel
Son confrère Michaël Dumouchel, chargé de projet pour L’Injecteur, soutient que le principal effet de la revue est de «créer un effet rassembleur, un véritable effet brise-glace sur l’isolement des personnes utilisatrices de drogues à travers la province». Il affirme du même souffle qu’elle permet de légitimer des expériences et des vécus qui sont parfois stigmatisés et rejetés dans la société.
«Quand on est lu, approuvé, et qu’on découvre qu’on est moins seul qu’on le pensait, c’est motivant et mobilisant, explique-t-il. On se convainc plus aisément que ça vaut la peine de se battre pour un avenir meilleur, que tout n’est pas perdu d’avance.»
L’analyse de Dumouchel est partagée par Annie Gusew, professeure à l’École de travail social de l’Université du Québec à Montréal, qui s’est penchée sur le rôle des approches narratives et biographiques en intervention. Elle explique que «le fait de donner du sens à l’expérience de vie change les perspectives, que le regard de l’autre est important». C’est ce qu’en retire Christine lorsqu’elle écrit dans la revue. Elle sait qu’elle est lue et qu’elle aide probablement un lecteur qui vit une réalité semblable à la sienne.
Rencontrer la santé mentale en personne
La stigmatisation n’est pas réservée aux conditions de vie les plus marginales. En effet, malgré certains progrès, les problèmes de santé mentale continuent de représenter une pauvreté sociale pour bien des gens.
«Chaque fois qu’on entend parler de santé mentale dans les médias, c’est relié à des meurtres ou à des histoires sordides. On pense toujours que les gens qui ont des problèmes de santé mentale sont violents. Mais la plupart du temps, ce sont les gens qui sont violents avec nous. Nos parcours le montrent», raconte Diane Lee, que l’on peut entendre sur la chaine YouTube de l’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP).
Dans le cadre de la 47e édition du Salon du livre de Montréal en 2024, cette association a mis sur pied la plus grande bibliothèque dite humaine ou vivante au Québec, avec près de 40 participants. Mme Lee est de la partie. L’idée somme toute simple demeure subversive: plutôt que d’emprunter un livre papier, on y «emprunte» une personne – un livre vivant ou humain – pour qu’elle nous parle de sa vie.
Les bibliothèques vivantes
C’est au Danemark, dans un festival rock au printemps 2000, que le concept est lancé afin d’atténuer la violence entre les participants. L’idée fait mouche et voyage un peu partout dans le monde. En 2007, la bibliothèque Gabrielle-Roy de Québec institue l’une des premières bibliothèques vivantes au Canada. Plusieurs autres emboitent le pas dans les années subséquentes. Les «livres» présentés dans ce contexte sont tous reliés à un même enjeu social et permettent de développer une connaissance de la réalité de l’autre en brisant l’inimitié.
Véronica Vivanco, anthropologue de formation, travaille comme chargée de projet pour le Groupe provincial sur la stigmatisation et la discrimination en santé mentale (GPS-SM) chapeauté par l’AQRP. Les bibliothèques vivantes sont l’un des principaux moyens qu’elle met en œuvre avec ses collègues pour lutter contre la stigmatisation.
«C’est une action qui est très porteuse. La recherche démontre que la stratégie de contact – plus que l’information et le militantisme – est la mieux reconnue pour changer les comportements et les attitudes», explique Mme Vivanco, qui souhaite voir cette initiative mieux connue, appuyée, étudiée et financée au Québec.
Vivanco rapporte que les bienfaits engendrés par l’activité sont multiples et touchent autant les «livres» humains que leurs lecteurs. Pour les premiers, c’est une expérience d’affirmation, de prise de confiance et de rétablissement. Pour les seconds, il s’agit d’être sensibilisés, informés et remués. Les réactions des lecteurs donnent aux «livres» le sentiment de faire œuvre utile, ce qui agit comme une validation de leur vécu. «C’est une étape importante pour ces gens dans leur rétablissement que d’être capables de participer à la sensibilisation», ajoute la chargée de projet.
On trouve un écho de cette affirmation dans les propos de Geoffroy Beauchemin, toujours sur la chaine YouTube de l’AQRP. Persuadé que les leçons qu’il tire de son expérience de vie peuvent aider, Beauchemin soutient que «c’est le sentiment de don de soi et d’aide aux autres qui me permet d’en parler aujourd’hui».
Dans les bibliothèques vivantes, c’est la libération de la parole qui permet tout ce travail de rétablissement. Isabelle Lenoir, une autre participante que l’on peut entendre dans les vidéos de l’association, témoigne du changement qu’elle constate le jour où elle ouvre la bouche: «Dans des groupes de soutien, j’ai été observatrice au début, puis quand j’ai commencé à parler de mon histoire, j’ai vu que ça me délivrait et que ça résonnait chez les autres aussi. C’est quelque chose de très libérateur qui peut vraiment nous donner accès à des émotions que l’on cache et qui peut faire réaliser aux autres que l’on peut traverser des épreuves en les partageant.»
Un deuil à traverser
Jean Fortin, ancien enseignant, lançait les ateliers du Récit de vie il y a neuf ans. Pour souligner l’anniversaire de sa mère, il lui offre un album pour revisiter les 80 années de sa vie. L’exercice est pour le moins positif. Désormais à la retraite, Jean souhaite permettre à d’autres ainés de bénéficier de son expérience. Il décide de cogner à la porte de la Fédération de l'Âge d'Or du Québec (FADOQ) dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches afin d’offrir ses services.
«Je ne pouvais pas écrire à la place des participants, puisque j’aurais dénaturé leur propos, explique-t-il. J’ai vite réalisé que tous vivaient à peu près les mêmes problématiques, les mêmes questions au moment d’écrire. J’ai donc conçu un matériel pédagogique qui les accompagne, en plus d’avoir quelqu’un qui anime les ateliers.»
Au-delà du projet d’écriture, Jean comprend très vite qu’il y a plus. Ses ateliers se remplissent de personnes aux récits de vie tragiques: abus sexuels, mariages ratés, deuils, solitude. L’autobiographie leur permet de revisiter ces pans douloureux de leur histoire, d’y faire face, et parfois même de tourner la page. Le mot se passe rapidement. Depuis neuf ans, le Récit de vie a rejoint des centaines de personnes de partout au Québec.
 Illustration: Mélanie Grenier
Illustration: Mélanie Grenier
Chhun Huor Ung est un de ceux-là. Encouragé par son épouse Sinboi, il commence à écrire leur histoire d’immigrants cambodgiens pour la transmettre à leurs enfants. Malheureusement, elle décède avant de voir le projet se concrétiser. La discipline et la motivation viennent à manquer à Huor, même s’il souhaite aller jusqu’au bout de l’idée que son épouse a semée en lui. C’est à cette époque qu’il entend parler des ateliers Récit de vie pour la première fois. Il décide alors de s’y inscrire.
Huor se remémore l’animatrice mettant la table, dès le début: «Vous devrez être sincères et ouverts. Chaque séance en est une de partage. Exprimez-vous. Toutes les deux semaines, vous devrez présenter un bout de votre récit aux autres. Ils devront vous donner des commentaires. Racontez les évènements, ce n’est pas si compliqué, mais exprimer votre ressenti, c’est votre défi.»
Ce cadre est parfait pour le projet d’Huor, car le partage bihebdomadaire lui donne la motivation nécessaire pour aller de l’avant. Il ne veut pas communiquer de simples faits à ses enfants, mais bien leur faire sentir tout ce que sa femme Sinboi et lui ont vécu comme joies et comme peines.
Sans qu’il s’en rende tout à fait compte, le processus d’écriture devient thérapeutique pour l’homme endeuillé. «Le deuil, c’est la perte de confiance, avance-t-il. Et cette perte de confiance, elle n’est pas banale, elle est physique, elle vous brise le cœur. Chaque fois que je commençais à écrire, les larmes coulaient. C’était horrible, je trouvais cela difficile.
«Pouvoir partager et me sentir écouté pleinement par mes camarades et l’animatrice m’a fait beaucoup de bien.»













