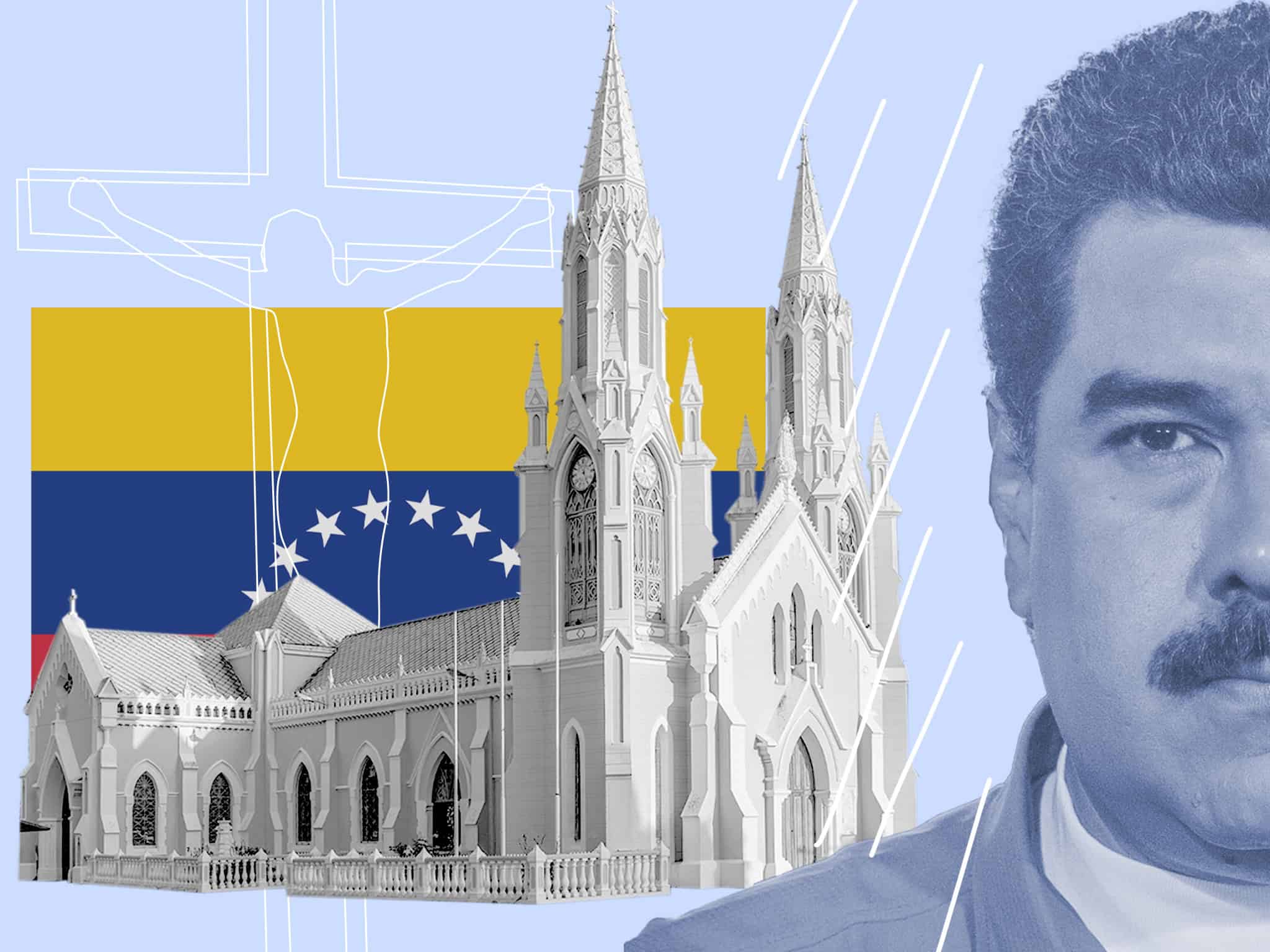Le conte, aussi éducatif que ludique
Blanche-Neige, Cendrillon, La petite sirène: ces contes de fées façonnent l’imaginaire de plusieurs générations. D’abord transmises oralement, certaines de ces histoires fantastiques aux origines mystérieuses sont fixées à l’écrit par Charles Perreault au 17e siècle, puis par les frères Grimm au 19e siècle. Elles sont depuis des incontournables de la littérature jeunesse et continuent d’influencer diverses productions artistiques contemporaines. Au-delà de leur intérêt culturel, possèdent-elles des vertus éducatives insoupçonnées?
Bien des parents ne lisent pas en compagnie de leurs enfants avec une intention éducative explicite en tête. C’est une pratique, un rituel communément admis pour un temps de qualité avec eux. «On fait cela sans se demander, c’est culturel», affirme sans ambages Marie Gagnon, mère de neuf enfants. Et pourtant, ce pourrait être tentant de vouloir tout rendre éducatif quand, comme elle, on fait l’école à la maison.
Son mari et elle lisent des histoires à leurs enfants depuis toujours. Les contes ont une place de choix parce qu’«ils sont déjà tous bien montés. La séquence de l’histoire est déjà très bonne. Dans les livres d’école européens que nous utilisons, les références aux contes sont très présentes», affirme-t-elle.
Professeur à la faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal, François Bowen passe le dernier quart de siècle à travailler à l’élaboration de deux programmes éducatifs qui montrent le rôle prépondérant que joue la littérature dans le développement socioaffectif des enfants. Le premier, d’ailleurs, utilise surtout des contes classiques. Sa collègue Isabelle Montésinos-Gelet collabore au deuxième, afin de sélectionner des albums plus modernes. Leur constat est sans équivoque: «Leur valeur se retrouve décuplée dans une démarche éducative avec la médiation d’un adulte», explique M. Bowen.
Pour eux, la forme – c’est-à-dire les images – a une puissance évocatrice aussi importante que le fond – c’est-à-dire le texte. Artiste-iconographe, Jonathan Pageau en sait quelque chose. Dans le sillage de son organisme The Symbolic World, il entreprend de rééditer certains des plus beaux contes de fées. Il collabore pour ce faire avec des illustratrices de renom, comme Éloïse Scherrer et Heather Pollington. Les illustrations contribuent d’une manière éminente à révéler au lecteur les clés symboliques de ces œuvres. Pour Pageau, c’est une évidence.
Apprendre par cœur
À travers son expérience, Marie Gagnon observe que les livres illustrés attirent rapidement les enfants parce qu’ils aiment les images. Or, elle remarque que l’oralité les captive encore davantage. C’est la raison pour laquelle son mari et elle introduisent leurs enfants aux contes classiques d’abord en narrant, en mimant et en interprétant «Aussi, quand on part en vacances, pas besoin d’apporter de livres! Même en voiture, c’est plus facile», ajoute-t-elle.
Ce mode de transmission, Jonathan Pageau l’a aussi pratiqué auprès de ses trois enfants. Il va même jusqu’à encourager les parents à apprendre les contes par cœur et à les raconter de mémoire.
«Je suis tombé en amour avec ces histoires. Par le fait de les avoir dans ma mémoire, j’ai vu qu’il y a des thèmes qui se croisent entre elles et avec celles de la Bible.»
D’abord comme père d’une famille chrétienne, et aussi comme conférencier et comme vidéaste Web, Pageau souhaite transmettre une vision unifiée et cohérente du monde. Il considère qu’à cette fin les contes de fées arrivent tout juste après la Bible. Ce sont dans les deux cas des corpus transmis oralement avant d’être écrits, se trouvant aux fondements de la culture occidentale.
Pour lui, «le fait que ces histoires soient préservées, transmises, racontées de génération en génération montre qu’elles sont une représentation de la nature humaine. Elles sont une sorte de concentré de sagesse qui se développe depuis des milliers d’années».
Formé en anthropologie et en psychologie, le professeur Bowen reconnait aussi la valeur fondamentale de la transmission orale:
«Les contes, ce sont des outils d'apprentissage, de socialisation, d'acculturation. Et la tradition orale a une fonction de transmission des valeurs, de la culture et des règles de la société. Le fait que les contes aient un côté bien découpé facilite la réflexion et le passage de certaines informations», soutient-il.
«Le fait que ces histoires soient préservées, transmises, racontées de génération en génération montre qu’elles sont une représentation de la nature humaine» – Jonathan Pageau
Entrainement au traumatisme
Les contes ne représentent pas seulement une richesse collective. Ils portent également des bienfaits pour l’esprit de ceux qui les côtoient, individuellement. Les deux professeurs de l’Université de Montréal évoquent au passage Psychanalyse des contes de fées (1976), un ouvrage classique sur le sujet. Son auteur, Bruno Bettelheim, l’a écrit «pour aider les adultes, et plus spécialement ceux qui ont charge d’enfants, à comprendre l’importance des contes de fées», peut-on lire dans les premières pages.
François Bowen résume en ces mots les propos du psychanalyste: «Il a expliqué comment les conditions d'adversité, les dangers que rencontrent les personnages, et leur résolution peuvent non seulement affecter l'inconscient de l'enfant, mais aussi forger sa personnalité, l'amener à apprivoiser des peurs et développer des attitudes transférables dans la vie réelle.»
Quand on demande à Jonathan Pageau quelles forces il attribue à la lecture des contes, il abonde dans le même sens. Il parle même d’«un entrainement au traumatisme». «La vie, c’est difficile, et on a l’impression qu’on doit protéger les enfants. Mais la vérité, c’est que, si on les protège trop, le jour où ils vont faire face au mal – en eux ou à l’extérieur – ils ne seront pas prêts à le gérer», avance-t-il.
Bien des parents pourraient se questionner aujourd’hui sur la pertinence d’édulcorer ou d’occulter les passages plus tragiques, voire violents, de certains contes. D’ailleurs, nombreuses sont les adaptations cinématographiques ou littéraires qui adoucissent plusieurs de ces éléments.
Marie Gagnon, de son côté, pense que les enfants sont résilients, qu’ils ne sont pas facilement traumatisés. Pour elle et son mari, les textes ont été écrits de cette manière et c’est normal de les lire ainsi. «À la limite, parfois, c’est drôlement écrit et on peut le reprendre avec eux d’une manière moins intense», propose-t-elle. Dans un même ordre d’idées, son mari et elle lisent des passages de l’Ancien Testament dans le texte original, sans voir de réactions négatives chez les enfants.
Une expérience différente pour les jeunes Pageau, chez qui la lecture biblique sème plutôt le trouble, à l’époque: «C’est plus facile pour eux de digérer le conte que les histoires bibliques. Dans les contes, tu as les mêmes thèmes, mais parce que ce sont des animaux, c’est fantastique, ça passe mieux. Le fantastique crée des intuitions prérationnelles», soutient Pageau.
Les pédagogues n’ont d’ailleurs pas tous le même rapport à la fantaisie. La célèbre éducatrice Maria Montessori, par exemple, proposait d’introduire la fantaisie seulement vers six ou sept ans, quand le rapport de l’enfant au réel est bien établi. Isabelle Montésinos-Gelet se souvient d’une discussion qu’elle a eue avec un collègue didacticien des sciences qui s’inquiétait de la fantaisie en littérature jeunesse, la jugeant susceptible de confondre les enfants dans leurs apprentissages. Il évoquait l’exemple d’un personnage allant sur la Lune sans scaphandre. «Oui, il y a de la fantaisie en littérature, mais c'est précisément le moment où l’on peut discuter de ce qui est réaliste, de ce qui ne l'est pas et qu'on peut introduire ces éléments-là», lui avait-elle rétorqué.
Par-delà le bien et le mal
L’enjeu des stéréotypes représente un autre aspect du conte qui suscite parfois la controverse dans l’espace public aujourd’hui. Et comme pour la fantaisie, les professeurs Bowen et Montésinos-Gelet croient que ce sont d’excellentes occasions pour discuter avec les enfants:
«Ce n’est pas parce qu'il y a un stéréotype dans un conte qu’il n’est pas intéressant, parce que justement on peut en parler, puis on peut éventuellement le dénoncer, ce stéréotype, le cas échéant. En fait, le conte et ses personnages sont très typés. Les personnages sont définis soit par des vices, soit par des vertus. C’est parfois un peu trop manichéen, parce que le but, c'est de faire réfléchir à une morale», explique Isabelle.
«Il y a aussi les stéréotypes de genre, une vision plus traditionnelle de l’homme et de la femme. On peut parler également de la valeur de certains comportements qu’ont les personnages», ajoute François.
La mère de famille avoue pour sa part aimer les stéréotypes: «J’aime que les filles soient des filles et que les gars soient des gars. Je ne vois pas de problème avec cela. Je pense que les petites filles peuvent aussi s’intéresser à des personnages masculins.»
En tant qu’analyste et critique culturel, Pageau déplore que ces œuvres de l’imaginaire collectif soient aujourd’hui victimes du cynisme et de la déconstruction. Les institutions qui, selon lui, étaient en quelque sorte les gardiennes de ces histoires sont en train de les échapper. Il prend notamment à partie Disney qui, en proie à l’idéologie, les réinvente en les vidant de leur sens originel. «Mais en fait, l’idée que ce sont de simples histoires de morale est une simplification. C’est quoi, la morale de Jack et le haricot magique?», lance-t-il en riant. «Ce sont des histoires beaucoup plus profondes. Beaucoup sont des histoires de transformation – d'entrée dans la vie adulte – qui nous proposent un mode d’être au monde.»
Quand elle regarde la littérature jeunesse d’aujourd’hui – qu’elle aime aussi et consomme avec ses enfants –, Marie Gagnon avance toutefois que la morale serait beaucoup trop évidente dans plusieurs œuvres. «C’est comme s’ils ont pensé la morale avant d’écrire le livre. L’enfant n’est pas dupe. S’il n’y a pas un récit, l’enfant n’est pas vraiment intéressé. Avec une bonne histoire, il va rester accroché.»