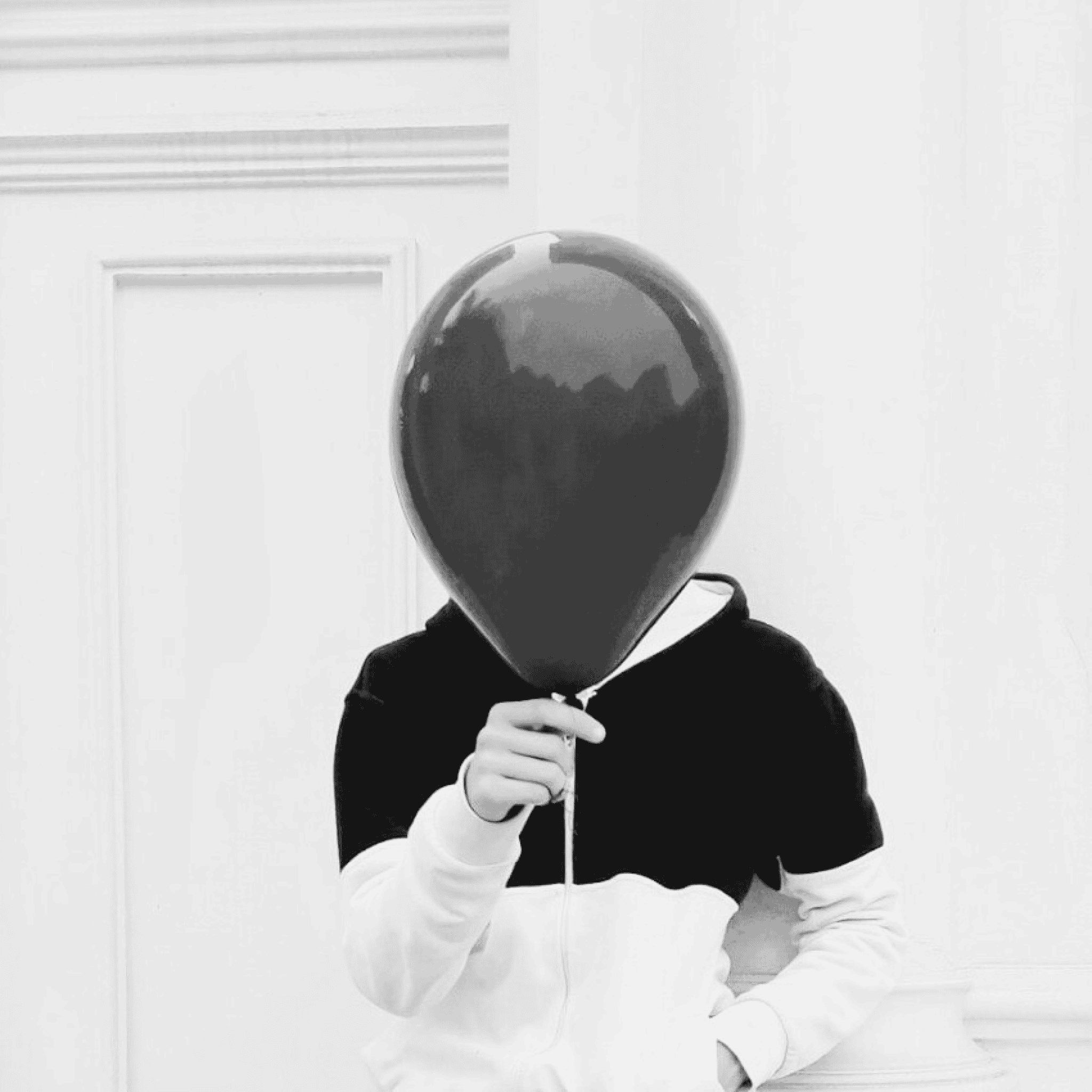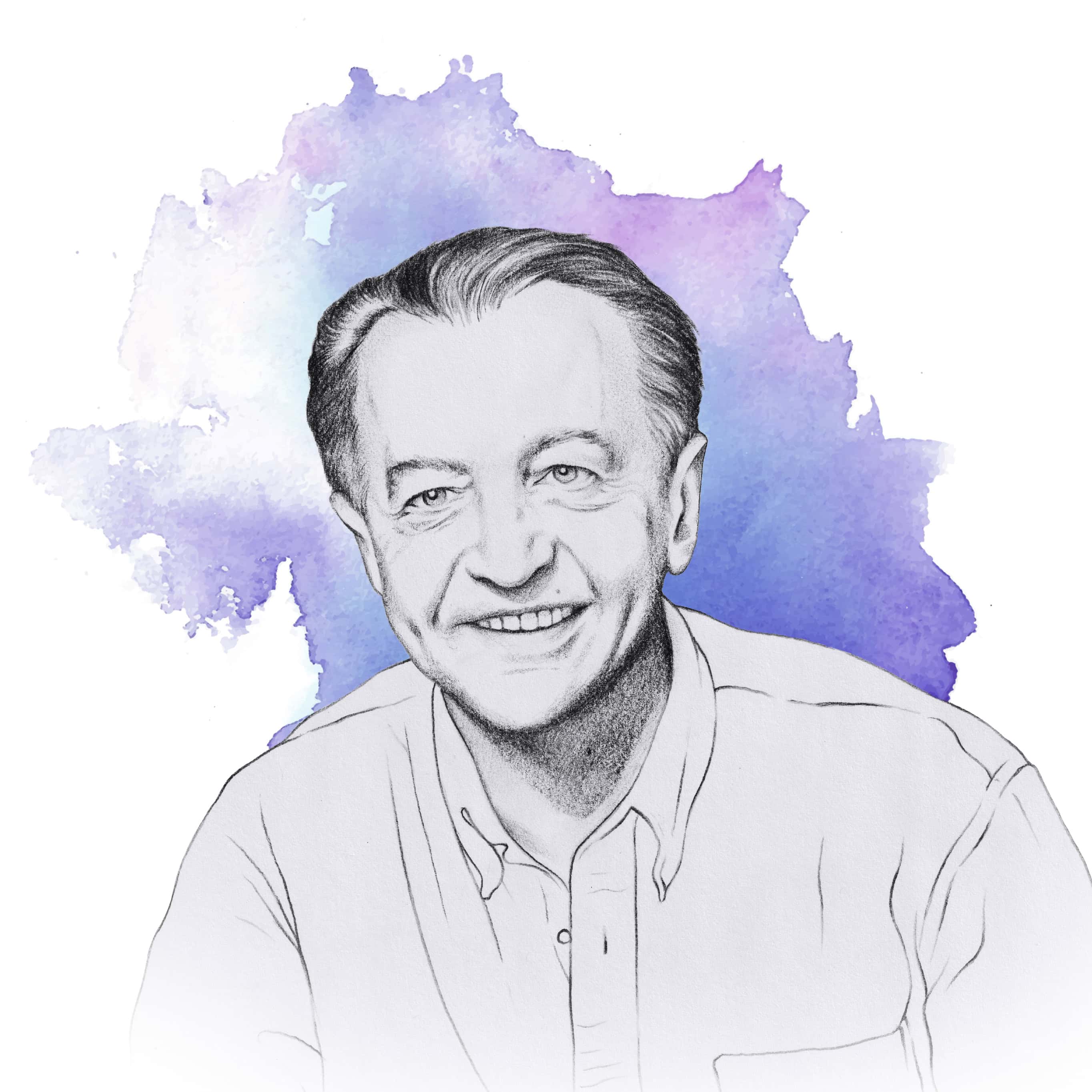
Mal-penser avec Philippe Muray
Un texte de Marc Chrevrier
La pensée est généralement associée à un exercice grave et sérieux, sans éclat ni esbroufe. La qualité d’une réflexion se jugerait ainsi au ton posé et monotone dont un philosophe en chaire débite sa conférence devant un parterre silencieux et transi par la solennité du propos. À l’inverse, il existe des penseurs dont les écrits déclenchent, page après page, le rire. L’écrivain britannique Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) entre dans cette catégorie spéciale: il est difficile de lire les essais foisonnants de paradoxes et d’images du romancier polémiste sans s’esclaffer. S’impose aussi une figure issue de l’autre côté de la Manche, soit l’inclassable Philippe Muray, né en 1945 d’un père écrivain et d’une mère férue de littérature.
Après des études en lettres à la Sorbonne, Muray, parallèlement à ses activités «alimentaires» (comme la rédaction sous commande de romans policiers), publie quelques romans et une pièce de théâtre. Mais c’est la parution en 1981 d’un essai sur Louis-Ferdinand Céline qui lui attire un début de notoriété. Muray multiplie ensuite essais et articles publiés dans plusieurs revues littéraires françaises, où il déploie son talent pour la critique caustique de son époque et son art du calembour et du néologisme burlesque. De ces écrits, il tire des recueils d’essais, qui le confirment en polémiste aguerri, comme Exorcismes spirituels et Après l’Histoire, par exemple. Il s’essaie même à la poésie (Minimum respect), genre qu’il abhorre pourtant et qu’il considère néanmoins comme une arme supplémentaire pour se moquer de ses contemporains.
Un pamphlétaire retourné contre sa génération
Muray reçoit sans tarder les étiquettes de «nouveau réactionnaire» ou d’anti-moderne, des qualificatifs qu’il est loin de désavouer. Plus un libre penseur – un «vieux libéral» classique, d’après sa complice intellectuelle Élisabeth Lévy – qu’un bourgeois attaché à la propriété et à la famille, Muray se revendique aussi bien de Joseph de Maistre, de Balzac que de Baudelaire, qui se définissaient tous, comme l’a souligné Eugénie Bastié en 2024 dans Le Figaro, «par la croyance irréversible dans le péché originel, par le rejet de la religion du Progrès, par la sexualité comme mystère, par l’amour du Réel et par l’idée que le “négatif” ne sera jamais expurgé du monde et de la nature humaine».
Fumeur invétéré, Muray meurt en 2006 à 60 ans. La renommée du pamphlétaire va grandissant: le comédien Fabrice Luchini lit d’ailleurs des extraits de son œuvre dans un spectacle monté en 2010. Par sa trajectoire de vie, Muray appartient à la génération lyrique qui survient après la Seconde Guerre mondiale. Des boumeurs, il décrit les lubies, les extravagances et l’ascension dans toutes les sphères – arts, politique, société –, auxquelles cette génération a imprimé une vision du monde faussement libératrice aux yeux de ce témoin intempestif que fut l’irréductible Muray.
La comparaison de Muray avec Chesterton ne doit pas cependant occulter certaines dissemblances entre les deux. Au contraire du catholique britannique, Muray se dit sans foi, ne reconnaissant comme absolus que la littérature et l’amour charnel. Toutefois, dans un monde homogène et lisse, aplati par une rectitude morale allergique à la dissidence, où tout élément d’étrangeté, de mystère, de profondeur et de hauteur qui dépasse est laminé, où les «résidus d’altérité» sont rasés, il estime que la pensée libre clame une forme de transcendance qui importune une humano-sphère immanente, persuadée de son autosuffisance, quoique devenue d’une «adipeuse platitude».
Or, Muray l’incroyant se révèle – c’est là l’un des nombreux paradoxes de l’écrivain – avoir un faible pour le catholicisme, l’auteur étant prompt à pourfendre les «papophobes» et les «cathophobes» qui injurient et malmènent sans façon l’Église. À son avis exclue de l’histoire par les idéologies révolutionnaires, elle «est une espèce d’œil de cyclone avec la ronde des puissances autour d’elle et des visions échevelées du monde» (Muray, 1999). Il loue dans le baroque euphorique de son peintre pré- féré, Pierre Paul Rubens, un art qui sait «mettre en équivalence, sans ridicule, la beauté des femmes et celle de la foi» (Muray, 1991).
Parmi les références favorites de Muray, on compte Léon Bloy, Georges Bernanos, Blaise Pascal, saint Augustin et même le jésuite espagnol du 17e siècle Baltasar Gracián, dont l’auteur cite cette maxime: «On ne saurait bien voir les choses du monde qu’en les regardant à rebours.» Voilà qui exprime, selon Muray, «la formule de base de la grande esthétique, de la grande pensée catholique et de ses grandes œuvres baroques» (Muray, 2000). Dans une entrevue, Muray évoque ces écrivains catholiques dont la foi les transforme en «grands vitupérateurs» de leur époque. Mais quelles sont les choses que l’esthétique de Muray cherche à croquer «à rebours»?
Chronique de l'empire du bien
On connait le mot célèbre de Chesterton: «Le monde moderne est plein d’anciennes vertus chrétiennes devenues folles.» D’une certaine façon, le projet littéraire de Muray consiste à faire la chronique acharnée, par l’humour jubilatoire et la raillerie insolente, de l’étendue de cette folie dont le monde contemporain est agité, bien qu’il soit inconscient de tout ce qu’il charrie d’incongru, de présomptueux, d’inconséquent, de grotesque et de loufoque dans ses inventions, ses mœurs et son discours qui les porte aux nues, souvent avec un esprit de sérieux lénifiant. Muray soutient que ce monde continue d’être travaillé par des inclinations religieuses inavouées, recyclées et méconnaissables dans leurs nouveaux habits, alors qu’il prétend avoir relégué la religion dans les oubliettes de quelque musée de cire.
Une nouvelle religion prend ainsi forme. Muray la voit poindre lors d’un séjour à l’université Stanford en Californie, à l’hiver 1983. Il écrit: «Dans ce pays qui ne s’embarrassait ni de dialectique ni de souvenirs, l’union redoutable de l’optimisme progressiste et des spiritualismes déchainés était en train de se réaliser pour le bien de l’humanité. […] Une sorte de religion voulait naitre, plus irréfutable que les anciennes, sous les auspices de l’Harmonie, et pourvue de moyens définitifs pour se faire accepter partout» (Muray, 1999).
«Muray soutient que ce monde continue d’être travaillé par des inclinations religieuses inavouées, recyclées et méconnaissables dans leurs nouveaux habits, alors qu’il prétend avoir relégué la religion dans les oubliettes de quelque musée de cire.»
Muray relate à satiété comment cette religion galopante se nourrit de simulacres empruntés aux anciennes qu’elle prétend remplacer. Elle débouche sur ce que Muray appelle l’Empire du Bien, un bien d’un type inédit, intégral, immersif, tentaculaire, repu de lui-même, sans faille ou presque, dans lequel l’homme prétendument évolué baignerait comme Obélix tombé dans sa marmite, au point de lui procurer une satisfaction intarissable, puisque les anges du progrès et de la science portent cette merveille. Cet Empire du Bien se figure pouvoir chasser le mal de son cercle et enfanter des hommes sortis de son moule vertueux, chantant en chœur l’hymne «à la démocratie, au couple, aux droits de l’homme, à la famille, à la tendresse, à la communication, aux prélèvements obligatoires, à la patrie, à la solidarité, à la paix» (Muray, 2019).
Ce Bien triomphant ne laisse guère de place à l’inquiétude existentielle, au doute, à l’errance, aux passions sombres, à la «part maudite» ou obscure, à ce que Muray appelle le «négatif», qui persiste à hanter les hommes et menace de perturber l’ordre radieux établi. Du reste, ce Bien, remarque Muray, qui croit mélanger harmoniquement toutes les nuances d’humanité, la «diversité», se construit sur la négation des différences fondamentales, en particulier entre les sexes, entre les âges, entre l’humain et l’animal ou le végétal, ainsi qu’entre le sacré et le profane.
Or, cette grande bonté qui érige la Positivité et l’Indifférencié en système a beau vouloir faire son deuil du mal, celui-ci finit toujours par montrer son museau. D’où la chasse continuelle aux éléments négatifs encore indomptés qui se traduit, dans les termes de Muray, dans «l’envie du pénal», une espèce de pulsion punitive qui pousse l’Empire du Bien à édicter une profusion de lois, de codes, de règlements pour extirper à leurs racines les pensées et les comportements déviants.
Ce «despotisme légalitaire» promeut une transparence absolue, qui suppose qu’en toutes choses, les actions humaines répondent aux intentions déclarées, et que celles-ci correspondent aux sentiments intimes, comme si l’être humain était un livre grand ouvert aux caractères en surbrillance. La transparence punitive instaure ainsi au sein de la société un tribunal permanent où le ressentiment «justiciaire» porte, par médias interposés, ses accusations et croit réaliser, fort de ses condamnations tapageuses, la «purification éthique» des trouble-fêtes malfaisants. Et même, l’Empire du Bien ira jusqu’à faire la guerre, en bénissant les milliers de bombes jetées sur l’ennemi, comme la Serbie démonisée lors de la guerre du Kosovo en 1998-1999.
Portrait de l'Homo festivus
Cependant, l’Empire du Bien ne table pas que sur le pénal pour se maintenir. C’est le génie de Muray que d’illustrer, par des pages drôlissimes, qu’il prospère par l’institution de la fête, d’une fête devenue incessante, industrielle, obsédante, fusionnelle, une fête à l’organisation et à l’animation de laquelle s’affaire une armée de journalistes laudateurs, de technocrates du loisir, de bienpensants du vivre-ensemble, de «rebellocrates» et «mutins de Panurge» salariés, d’artistes transgressifs subventionnés qui cherchent, à grand renfort de musique techno, d’art d’avant-garde déjanté, de chars allégoriques hurlants, de sautillements citoyens, à faire «évènement».
Ainsi l’humanité marche-t-elle en cadence, en un seul corps compact, grâce aux défilés de la fierté, aux «love parades», aux raves et aux concerts en plein air mugissants, aux festivals en tous genres, aux Disneyland poussant comme des champignons au milieu des champs. Cette fête omniprésente sert, selon Muray, à embrigader, à réduire au silence toute dissidence ou à camoufler tout accroc à l’unanimisme bienfaisant.
Nait alors l’Homo festivus, cet adulte-enfant materné par la fête hors mesure, qui poursuit le travail d’indifférenciation de l’Empire du Bien sur trois plans. Tout d’abord, celui de l’espace, puisque la fête peut métamorphoser n’importe quel lieu ou édifice en scène festive – ce qu’a donné à voir l’été dernier la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris.
Ensuite, le plan du temps, car la fête ne connait pas de terme, un évènement, un festival remplaçant l’autre. On est loin de l’esprit des fêtes anciennes, qui joignait la célébration d’un noble mystère, dans un lieu et un temps précis, à des réjouissances populaires. Et finalement, la fête techno-inclusive, en brouillant les frontières entre le réel et le virtuel, entre le fantastique et la finitude humaine, achève de diluer tout principe de réalité.
L’Homo festivus, souligne Muray, évolue dans un carcan mental peuplé d’abstractions qui le rendent insensible aux aspects concrets de son milieu, recomposé en zone récréative standardisée rythmée par la World Music. Cette musique de fond qui étourdit Homo festivus chante son appartenance à un monde «moral, désinvolte, léger, festivisé, innocent, puisque enfin nettoyé des derniers souvenirs du passé honni». Ce monde produit «cet individu très spécial qui exige des roses sans épines, le génie sans la cruauté, le soleil sans les coups de soleil, le marxisme mais sans dogmatisme, les tigres sans leurs griffes et la vie sans la mort» (Muray, 2002).
L’ère hyperfestive coïncide ainsi avec ce que Muray nomme la «post-histoire», soit l’idée, attribuable au philosophe allemand Georg W. F. Hegel, selon laquelle l’aventure humaine, après une longue lutte entre maitres et esclaves pour la reconnaissance, finirait par connaitre une synthèse finale. Or, l’Homo festivus croit être l’incarnation de cette synthèse qui le justifie de tourner le dos aux antiquités du mal, au monde ancien rétrograde aujourd’hui prestement congédié.
Il va droit devant, en roller blades, en trottinette ou en montgolfière – tel un surfeur sur sa vague, porté en triomphe sur la crête du progrès.
En somme, Muray réactualise la critique pascalienne du divertissement, qui détourne l’homme de la saisie de sa condition misérable. Car la fête enveloppante recouvre chez l’Homo festivus une bonne couche de malêtre refoulée. Outre le Pascal des Pensées, Muray perpétue aussi celui des Provinciales, un recueil de lettres par où le mathématicien mystique engage une querelle avec les jésuites de son temps. Pascal défend, dans la onzième lettre que Muray cite avec admiration, son droit d’user du rire pour réfuter des erreurs théologiques. La raillerie est même une action de justice que Dieu lui-même et les prophètes ont entreprise contre les folies des hommes. Traiter des idées pernicieuses avec sérieux plutôt qu’avec la moquerie reviendrait à autoriser leurs propagandistes. Comme le dit saint Augustin rapporté par Pascal, pourquoi «les catholiques ne doivent écrire qu’avec une froideur de style qui endorme les lecteurs?» Bref, insomniaques de tout horizon, évitez Muray!