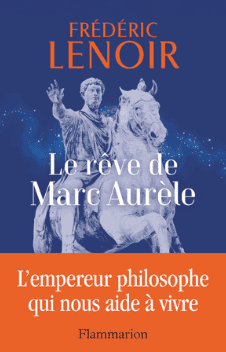Frédéric Lenoir et le grand retour des stoïciens
C’est tout à fait serein, malgré l’heure de retard de son train, que Frédéric Lenoir apparait dans la gare du Palais, sourire chaleureux aux lèvres. De passage à Québec, il présente une conférence en lien avec son plus récent livre, Le rêve de Marc Aurèle. Alors que le stoïcisme du célèbre empereur romain connait un regain de popularité dans certains milieux, l’écrivain français accepte de nous parler, impassible malgré les travaux qui encombrent les lieux.
La réputation de Lenoir n’est plus à faire. Auteur prolifique, il se veut pédagogue alors qu’il introduit son lecteur à la vie et à la pensée de grandes figures de l’histoire intellectuelle et spirituelle. On peut penser à son célèbre Socrate, Jésus, Bouddha – Trois maîtres de vie (2009) ou encore à des ouvrages consacrés à Spinoza et à Jung. À partir de l’œuvre de ces grands personnages, Lenoir propose une réflexion sur des questions comme le bonheur et le sens de la vie.
Par ses conférences, Lenoir attire les foules. Ses livres deviennent souvent des succès de librairie. Et son talent de vulgarisateur est indéniable. C’est maintenant à travers une étude détaillée de la vie et de l’œuvre de l’empereur romain Marc Aurèle, dont le règne a lieu au IIe siècle, que Lenoir revisite ces questions pérennes.
Espace de liberté
Une vision par trop simpliste du stoïcisme donnerait à penser qu’il s’agit d’accepter passivement les choses telles qu’elles sont et d’adopter cette attitude du renoncement si souvent proposée de nos jours comme la recette du bonheur. Le secret d’une vie sereine serait donc d’accepter les évènements comme ils se présentent et se succèdent, de manière déterminée et inexorable. Or, pour l’auteur, cette vision reste caricaturale et cache une réalité plus complexe.
En effet, le stoïcisme donne toute sa place à la liberté, dès lors qu’on la comprend autrement que la simple possibilité de faire ce que l’on veut.
«On a un destin, un certain nombre d’évènements qui vont nous arriver. On n’a pas choisi notre corps, notre famille, le pays dans lequel on va vivre, un certain nombre de rencontres qu’on va faire. Il y a des évènements collectifs qu’on n’a pas choisis. Tout ça, on n’a pas de maitrise là-dessus. Mais on a une grande maitrise intérieure. Pour le stoïcisme, la grande liberté, c’est la vie morale: bien agir ou mal agir. Et ça, ce n’est pas déterminé du tout.
«On n’est pas déterminé à faire le bien ou à faire le mal. Il y a des gens qui vont essayer de bien agir, d’être altruistes, de tenir compte des autres. Ils vont avoir une vie beaucoup plus réussie que ceux qui ne cherchent que leur intérêt. Et puis, d’ailleurs, le bien et le mal n’existent que dans la vie morale, que dans l’intention morale. C’est la seule liberté.»
Pour mieux comprendre cette liberté des stoïciens, Frédéric Lenoir rappelle la distinction essentielle faite par Épictète entre ce qui ne dépend pas de nous — et qu’il faut accepter — et ce qui dépend de nous.
«Ce qui dépend de nous, il faut tout faire pour le changer. C’est là qu’il faut agir. Et qu’est-ce qui dépend de nous? Vous êtes face à une injustice? Agissez! Vous pouvez bien faire votre travail, ou mal le faire. Et ce qui ne dépend pas de nous, c’est un certain nombre d’évènements du destin qu’on ne peut pas maitriser.»
«Pour le stoïcisme, la grande liberté, c’est la vie morale: bien agir ou mal agir. Et ça, ce n’est pas déterminé du tout.»
Rapprochements
Lorsqu’on le questionne sur les liens entre le stoïcisme et le christianisme, Frédéric Lenoir s’enthousiasme. Pour lui, les parallèles sont nombreux. «J’ai relevé chez Marc Aurèle, dans les Pensées pour moi-même, une vingtaine de maximes qui ressemblent à des passages des Évangiles: l’amour du prochain, pardonne à tes ennemis, etc. Pourtant, il ne connaissait pas du tout l’Évangile. Ça montre qu’il y a une universalité de la sagesse.»
De même, on perçoit chez l’empereur romain l’idée d’une volonté de ressembler aux dieux. On la retrouve aussi, en un certain sens, chez le chrétien, appelé à suivre l’exemple de Jésus. «Pour les stoïciens, la vie contemplative, c’est être divinisé. C’est devenir Dieu, en fait. Il faut être semblables aux dieux, leur ressembler, les imiter. Et puis se laisser traverser par eux, se laisser guider.»
Lenoir, qui se considère comme un chrétien, va jusqu’à qualifier le stoïcisme de «pensée religieuse très proche du christianisme, qui croit dans un Dieu bon qui gouverne le monde, en la providence et la grâce divines».
La personne de Jésus
Le rapport de Frédéric Lenoir à la foi évolue beaucoup au fil du temps. «J’ai eu une période de ma vie, à 20 ans, où j’étais dans un monastère. J’étais à fond catho. Puis il y a eu des périodes où je n’étais pas loin de l’athéisme. Finalement, je suis revenu à une forme de spiritualité. On évolue tout le temps.»
Mais une constante demeure: c’est sa relation à la personne de Jésus et à sa parole. Lenoir dit se nourrir des écrits de l’Évangile, qu’il essaie de mettre en acte. «Je suis bouleversé par la personne du Christ, dont je sais qu’il est toujours vivant, qu’il continue d’être présent, et que l’on peut ressentir une relation avec lui, un contact, une grâce, une présence.»
D’ailleurs, l’eucharistie — cette commémoration du dernier repas de Jésus où, par la consécration, le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ — est de tous les sacrements celui qui touche le plus Frédéric Lenoir. «À travers ce geste du rituel eucharistique, il y a une présence particulière de Jésus, parce qu’il l’a vraiment demandé.»
Se laisser enchanter
Frédéric Lenoir est président et cofondateur de l’Association SEVE (Savoir Être et Vivre Ensemble), qui œuvre un peu partout dans le monde pour offrir des séances de formation aux animateurs d’ateliers de philosophie pour enfants. Ce qui le fascine le plus chez les petits, c’est leur capacité à se laisser éblouir.
«C’est Platon qui nous dit que la philosophie commence avec l’émerveillement et l’étonnement. C’est-à-dire qu’on s’émerveille, on s’étonne et on questionne. Tous les philosophes de l’Antiquité ont cherché à questionner le monde à partir d’une admiration fondamentale. Et les enfants, ils ont cette capacité extraordinaire, parce qu’ils s’émerveillent beaucoup plus que les adultes.»
L’émerveillement est aussi essentiel dans la connaissance de Dieu, que l’on découvre selon Lenoir «par la beauté et l’harmonie du monde». Il croit, avec les stoïciens, que cela «ne peut pas être le fruit du hasard, [qu’il y a] nécessairement une intelligence qui a ordonné parfaitement le monde.
«Et en même temps, le monde est beau, c’est-à-dire qu’il est bon, parce qu’il y a une conversion du beau et du bon. Et donc, la beauté du monde nous révèle la bonté de Dieu, c’est-à-dire celui qui l’a créé.»
L’accès à la connaissance du divin passerait autant par le cœur que par la raison. «C’est à la fois le fruit d’un raisonnement et d’une expérience affective, à la fois un sentiment et une découverte rationnelle.»