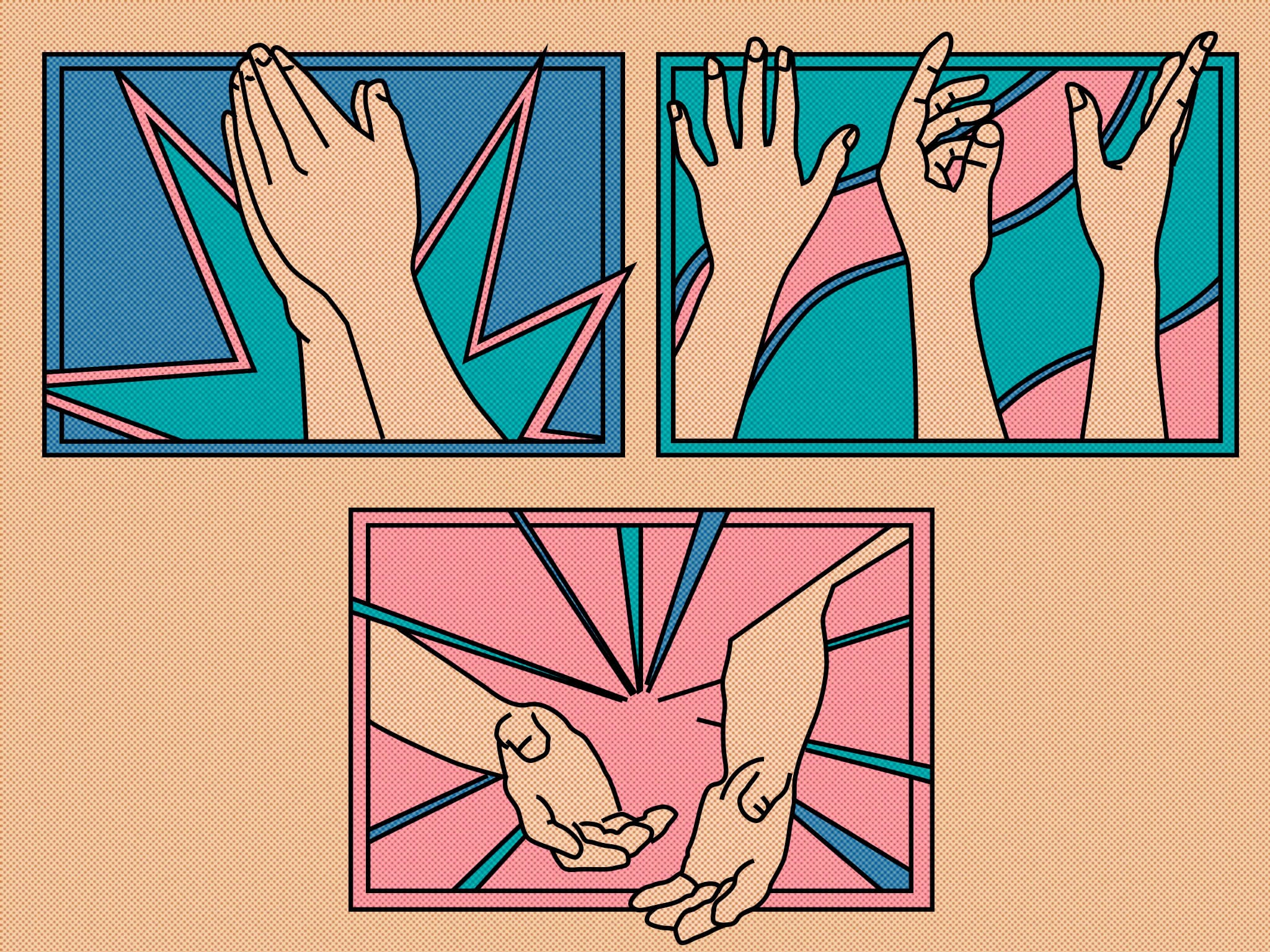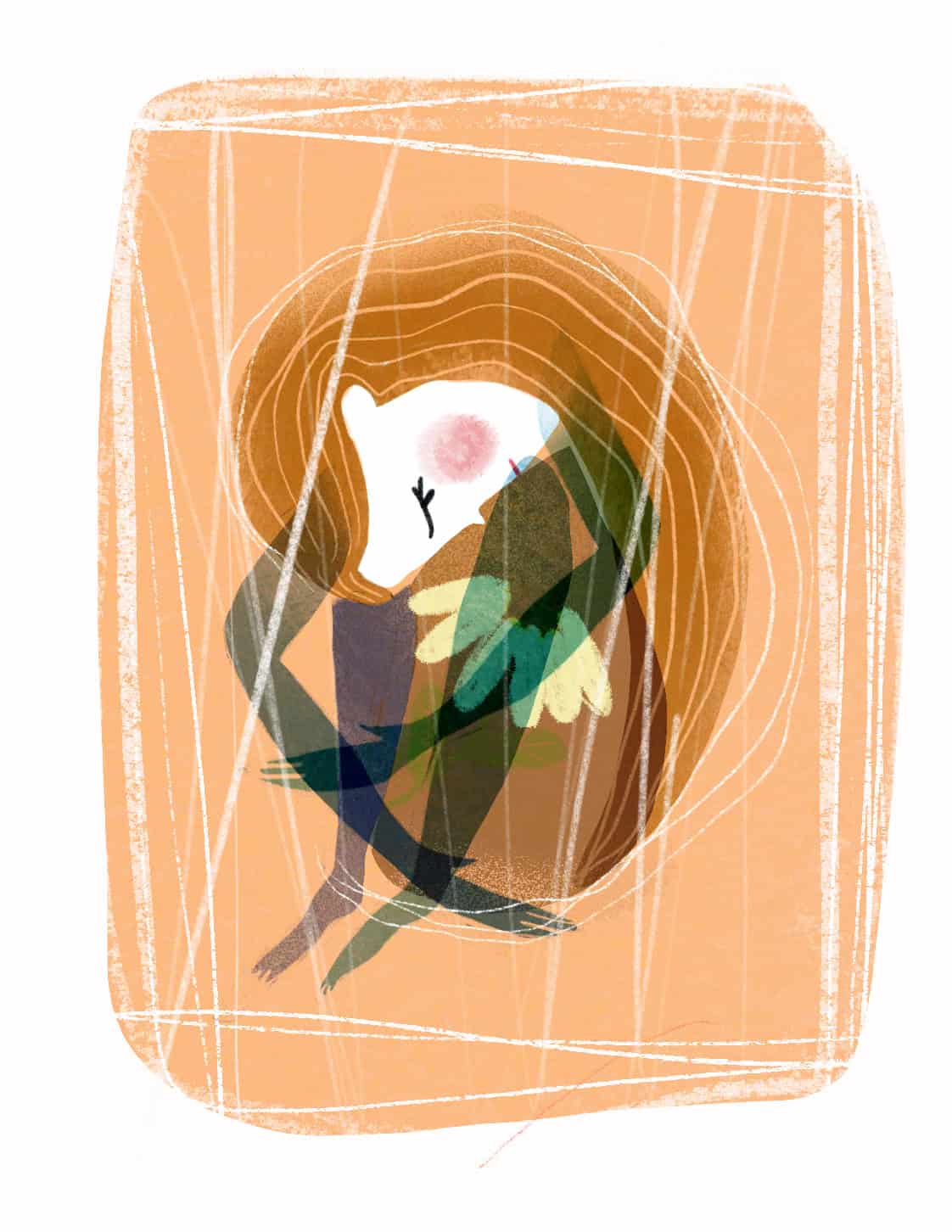Charles De Koninck, le diamant oublié
Texte écrit par Marc Chevrier
En novembre 2025, les médias révèlent que l’impératrice déchue Zita de Bourbon-Parme, exilée depuis 1918, a dissimulé de précieux bijoux, dont un diamant phénoménal, lors de son séjour à Québec à partir de 1940. Cette nouvelle ne mentionne toutefois pas un autre bijou d’exception: Charles De Koninck. C’est la réputation du philosophe qui a attiré Zita dans la capitale. Il sera même le tuteur des enfants exilés! Le Verbe vous propose de découvrir ce grand oublié qui a donné au Québec beaucoup plus que son nom à un pavillon universitaire.
Charles De Koninck n’est pas un obscur professeur de l’université Laval. Il incarne l’une des figures intellectuelles les plus marquantes du 20e siècle au Québec. Connu, lu, étudié, discuté aussi bien aux États-Unis et en Europe qu’en Amérique latine, où il enseigne et diffuse plusieurs de ses travaux, le philosophe tombe pourtant presque dans l’oubli au Québec après sa mort, en 1965.
En 2009, enfin, on lui rend un juste hommage par la publication aux presses universitaires Laval de ses œuvres complètes en six volumes, en français. Et, en octobre 2025, un important colloque à Québec explore la pensée politique et sociale du philosophe, que les jeunes générations de chercheurs découvrent avec étonnement. Mais qui était cet homme dont l’œuvre suscite un engouement post-mortem si décalé?
L’aventure philosophique d’un Flamand en terres québécoises
Charles De Koninck nait en 1906, en Belgique flamande, au sein d’une famille qui émigre ensuite au Michigan pour fuir la guerre. Celle-ci terminée, le jeune Charles retourne dans son pays pour poursuivre ses études, couronnées par une thèse de philosophie consacrée aux travaux de l’astrophysicien anglais Arthur Eddington. Après son mariage avec Zoe Decruydt en 1933, avec laquelle il a douze enfants, le couple s’installe à Québec, où Charles décroche un poste de professeur de philosophie à l’Université Laval. Il exerce également, pendant 17 ans, la responsabilité de doyen de la Faculté de philosophie de l’université.
Malgré un emploi du temps fort chargé, avec des conférences et des enseignements à l’étranger et la direction d’une cinquantaine de docteurs, en majorité américains, il obtient en 1962 un doctorat en théologie pour une thèse portant sur La «mort glorieuse» de la très sainte Vierge. Ce rare mariage entre la science, la philosophie et la théologie prédestine De Koninck à participer aux travaux du concile Vatican II. Une crise cardiaque le terrasse à Rome, en février 1965, où il espérait une audience avec le pape Paul VI. Plusieurs enfants de Charles De Koninck suivent leur père dans la carrière professorale, en philosophie, en mathématique, en géographie, en santé communautaire, en psychologie et en pédagogie.
Le marxisme veut «rectifier l’homme intérieur comme une chose extérieure, en agissant sur lui tout comme l’artisan travaille une matière et transforme un arbre en armoire.» - Charles De Koninck
Philosophe des sciences et de la nature
Certains contemporains de Charles De Koninck et des historiens lui accolent l’étiquette de traditionaliste intransigeant, préservant la citadelle de l’orthodoxie thomiste en Amérique des extravagances modernistes importées d’Europe. Or, De Koninck ne se considère guère lui-même comme un thomiste. Loin de lui l’ambition d’extraire de l’œuvre de saint Thomas, érigée en encyclopédie close, les réponses à toutes les questions. Il possède néanmoins à fond cette œuvre, car il reconnait dans le docteur angélique un grand interprète d’Aristote. De Koninck discute avec aisance des thèses d’Albert Einstein, de Max Planck, de Bertrand Russell, de Henri Poincaré; il interroge la cosmologie, la relativité, la géométrie, la génétique et l’évolution des espèces en s’appuyant sur Aristote et saint Thomas d’Aquin pour dégager la signification de l’activité scientifique.
Cependant, la science moderne, si elle fait l’économie d’une réflexion sur ses fondements, peut vite aboutir au réductionnisme, c’est-à-dire croire que l’univers se confond avec les abstractions mathématiques au travers desquelles la science appréhende et manipule les phénomènes. Comme le souligne De Koninck dans ses ouvrages, la science construit des «fictions instrumentales» (tels les atomes et les gènes) pour se figurer des interactions, des flux, des forces, qui ont peu à voir avec le monde réel concret que les êtres humains expérimentent, et dont ils rendent compte par le langage ordinaire. Ce que calculent les mathématiques consiste en des entités vides, des collections d’évènements, que l’abstraction transforme en opérations uniformes et logiques qui peuvent être confiées, d’ailleurs, à des machines, comme l’ordinateur.
En ce sens, l’univers saisi par la science est vide, il ne renferme ni sens, ni intelligence, ni vie, comme le note le physicien Yves Larochelle. La science se construit grâce à des outils de mesures produisant des données, avec lesquelles elle élabore des modèles, sans égard aux réalités concrètes auxquelles ces entités abstraites se rapportent. Le scientifique verrait les choses telles qu’un aveugle tenterait de comprendre la couleur rouge: on aura beau lui expliquer qu’il s’agit d’un rayonnement électromagnétique définissable par sa longueur d’onde, sa fréquence et d’autres propriétés, l’aveugle ne saura toujours pas ce qu’est l’expérience et la notion du rouge.
La philosophie comme la science ne peuvent donc ignorer ces réalités premières accessibles à l’expérience et à la conscience des êtres humains et traduisibles dans la langue ordinaire. De Koninck est persuadé qu’une philosophie authentique doit s’écarter le moins possible de cette langue et éviter les distinctions inutiles. Il recommande ainsi de cultiver la connaissance de la langue ordinaire, notamment par les voies de la poésie, à laquelle il fait un clin d’œil dans son ouvrage The Hollow Universe (L’Univers creux), qui évoque le poème The Hollow Men de l’Américain T.S. Eliot, mort lui aussi en 1965.
Engagé dans la cité
Le souci qu’a De Koninck d’échapper aux écueils du réductionnisme en science s’est reflété également dans la partie sociale et politique de son œuvre. De ses réflexions sur la politique, l’éthique et les idéologies sociales se dégage la volonté de ne pas ligoter le gouvernement des hommes par des abstractions qui font fi des données naturelles de la vie sociale. D’où sa ferme critique du marxisme, et, plus généralement, de ce qu’on appelle les philosophies de l’histoire, doctrines suivant lesquelles l’histoire humaine suivrait une trajectoire déduite par la raison et aboutirait à une résolution finale, où l’oppression, tout écart entre le désir et le réel, seraient abolis.
Pour De Koninck, les contradictions et les oppositions irréductibles que l’esprit humain conçoit peuvent peut-être se réconcilier dans une œuvre d’art, comme celle de Marcel Proust, mais pas dans la réalité sociale à coups de révolutions devant faire advenir une «universelle rédemption». Le marxiste, dit-il, veut «rectifier l’homme intérieur comme une chose extérieure, en agissant sur lui tout comme l’artisan travaille une matière et transforme un arbre en armoire». Pour lui, le marxisme exprime une révolte de «l’irascible» prêchant un «nihilisme absolu, sans retour». Il y voit aussi à l’œuvre une confusion, très nette chez Spinoza, entre l’idée du bien et la puissance d’être.
Les dangers d’une raison qui se croit omnipotente et réduit l’être humain à une variable se manifestaient également, pense De Koninck, dans les sociétés libérales. La tentation du Grand État, qui rationalise, au nom d’une providence universelle, tous les aspects de la vie sociale et communautaire, conduit, comme au Canada, à la centralisation des pouvoirs en faveur de l’État fédéral au détriment des sociétés constitutives de l’union fédérale. C’est lors des travaux de la Commission royale d’enquête sur les problèmes constitutionnels, ou Commission Tremblay, créée à l’instigation de Duplessis en 1953, que le philosophe fait entendre cette critique.
La vision que De Koninck a du fédéralisme emprunte à la fois à Aristote et à Montesquieu. Selon De Koninck, la fédération forme une société de sociétés, chacune étant assimilable à une cité au sens d’Aristote, soit une communauté politique à part entière, qui poursuit sa finalité par sa délibération pratique propre. Le Grand État centralisateur passe outre à l’autonomie de ces sociétés premières pour imposer des normes générales supposant un homme générique «malléable», et donc modelable selon les réquisits de la planification. En ce sens, De Koninck renvoit dos à dos communistes et sociaux-démocrates, croyant pouvoir maitriser le capitalisme par l’interventionnisme étatique.
La grande dispute autour du bien commun
C’est au chapitre de la notion du bien commun, omniprésente dans la pensée de saint Thomas d’Aquin, que De Koninck formule des critiques retentissantes à l’égard d’une doctrine qui lui semble saper la richesse de cette notion. En pleine Seconde Guerre mondiale, il publie l’essai De la primauté du bien commun contre les personnalistes. Ce faisant, il engage, par une interprétation serrée des textes du docteur angélique, la polémique avec les chefs de file d’une nouvelle école de pensée: le personnalisme. Née dans certains cercles catholiques européens, cette école veut sanctuariser la personne pour parer aux impasses de l’individualisme libéral et du collectivisme socialisant. Parmi les personnalistes figurent Emmanuel Mounier, Jacques Maritain, Étienne Gilson, etc. Plusieurs ont enseigné aux États-Unis, comme Maritain, ou même immigré, comme Yves Simon.
Que leur reproche De Koninck? En substance, les personnalistes ont tendance à rabattre le bien commun, c’est-à-dire le bien supérieur qui devrait guider en tout le corps politique, sur le bien des personnes, qui, elles, indépendantes, toucheraient à l’absolu par leur relation directe avec Dieu. La personne-individu devient alors la mesure du bien commun, qui n’existe et ne se diffuse dans la société que grâce à la générosité, à la bonté et à la transcendance imputées à la personne. Un bien apparait commun dès lors qu’il sert l’addition de tous les biens particuliers. Loin d’avoir à concilier les biens personnels entre eux, il suffit de dégager, par calcul utilitaire, le bien du plus grand nombre.
Or, pour De Koninck, le bien commun est à la fois autre et pas étranger. Autre, parce que différent des biens personnels additionnés; il touche à la communauté politique, qui réalise des biens qui échappent à la portée des individus isolés. Mais pas étranger, parce que le bien commun, qui parle au citoyen en chacun, réalise la nature humaine et permet aux uns et aux autres de s’accomplir à l’intérieur de la cité.
Le bien commun rend compossibles tous les autres biens que les personnes, depuis la famille jusqu’à l’État, tâchent de poursuivre à leur niveau.
De Koninck défend une vision résolument non totalitaire du bien commun. Celui-ci ne constitue guère une espèce de bien abstrait rigide, celui «d’un tyran anonyme» qui s’assujettit des sujets-automates. Il s’agit plutôt d’un bien «opérable», que chacun peut donc comprendre, désirer et mettre en œuvre par ses moyens propres, en agent autonome qui, par sa propre activité, répercute et actualise ce bien dans son entourage. Le bien commun rend compossibles tous les autres biens que les personnes, depuis la famille jusqu’à l’État, tâchent de poursuivre à leur niveau. Mais si le bien commun disparait, alors «la société dégénère en État figé et refermé sur soi», note De Koninck.
Il reste que le bien commun, qui concerne le citoyen dans la cité, n’absorbe pas tout l’individu. Il conserve son domaine à lui, où il a la liberté de rechercher des biens plus parfaits, que les croyants trouvent en Dieu. Cette défense non totalitaire du bien commun conserve son actualité, quand on songe que le recours systématique au juge pour garantir des droits individuels, souvent conçus dans une perspective personnaliste, présente fréquemment le bien collectif et les libertés comme des réalités antagonistes, alors que, selon De Koninck, celui-là et ceux-ci s’impliquent mutuellement.
La liberté spirituelle au temps des algorithmes
Un droit revêt d’ailleurs une importance fondamentale pour le philosophe: la liberté de conscience, qui participe de la personne et pose des limites à l’action de l’État. Une laïcité qui s’accorde à cette primauté ne peut se borner à une tolérance à l’égard des religions minoritaires ou de l’irréligion. Elle suppose que l’État, qui a la charge légitime de fournir l’éducation aux futurs citoyens, mette sur le même pied, sans préférence aucune, le droit des parents croyants d’éduquer leurs enfants conformément à leur religion et celui de parents non croyants d’éduquer les leurs dans un milieu déconfessionnalisé. Une laïcité tempérée, qui ne verse pas dans l’indifférentisme, voit donc l’État soutenir aussi bien les écoles confessionnelles que les écoles sans religion.
Le sociologue Michel Freitag écrit: «la théologie, la philosophie et la science […] ont en commun d’avoir pour fin la connaissance de la réalité, c’est-à-dire la vérité.» Dans l’histoire de l’université québécoise, Charles De Koninck est l’un des rares professeurs à avoir porté, avec élégance et brio, ces trois chapeaux. À une époque où, comme le dirait le juriste Alain Supiot, la «gouvernance par les nombres» soumet nos existences à l’emprise réductionniste des géants américains du numérique (GAFAM) et de l’intelligence artificielle, l’œuvre de Charles De Koninck mérite, plus que jamais, notre attention reconnaissante.