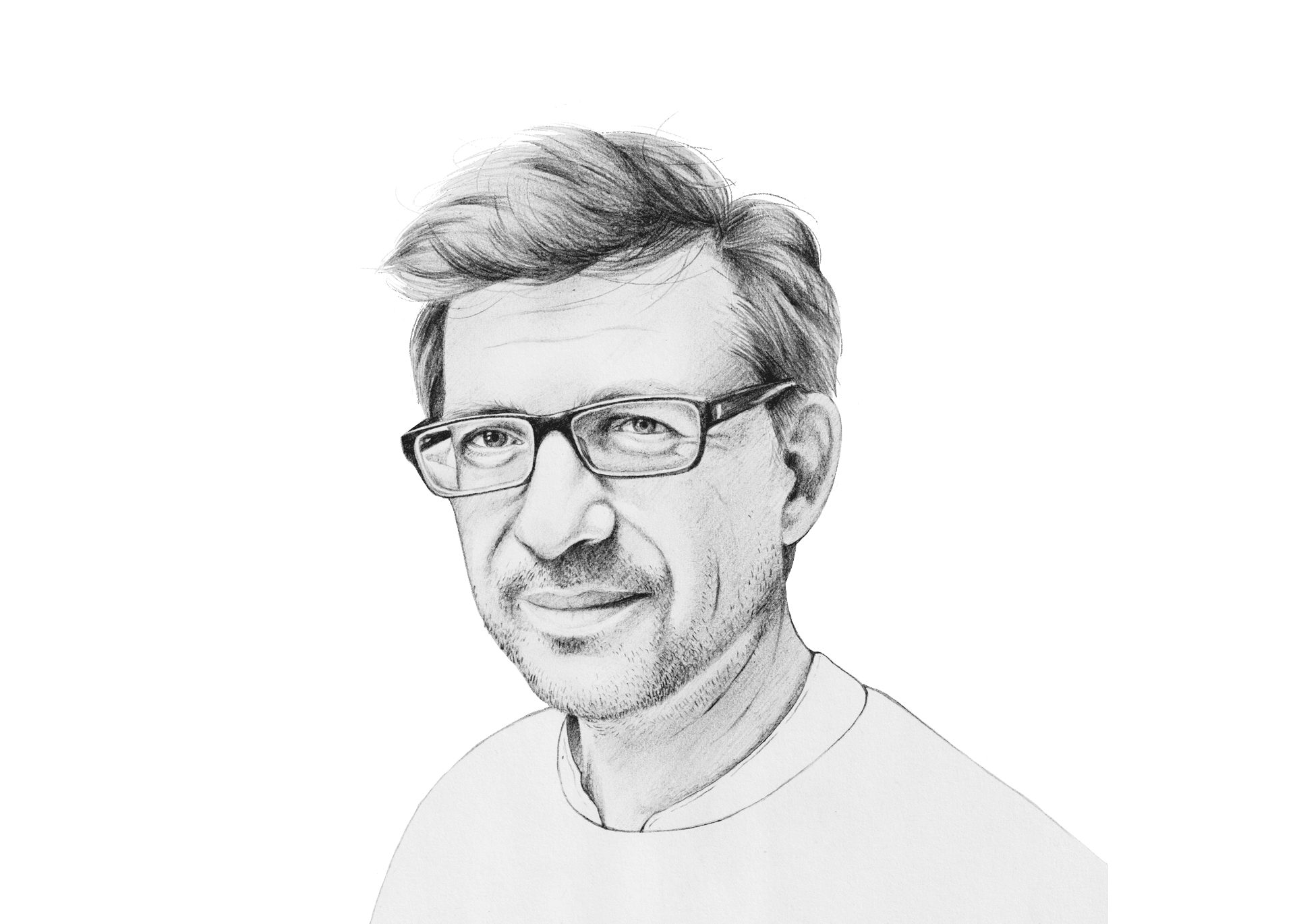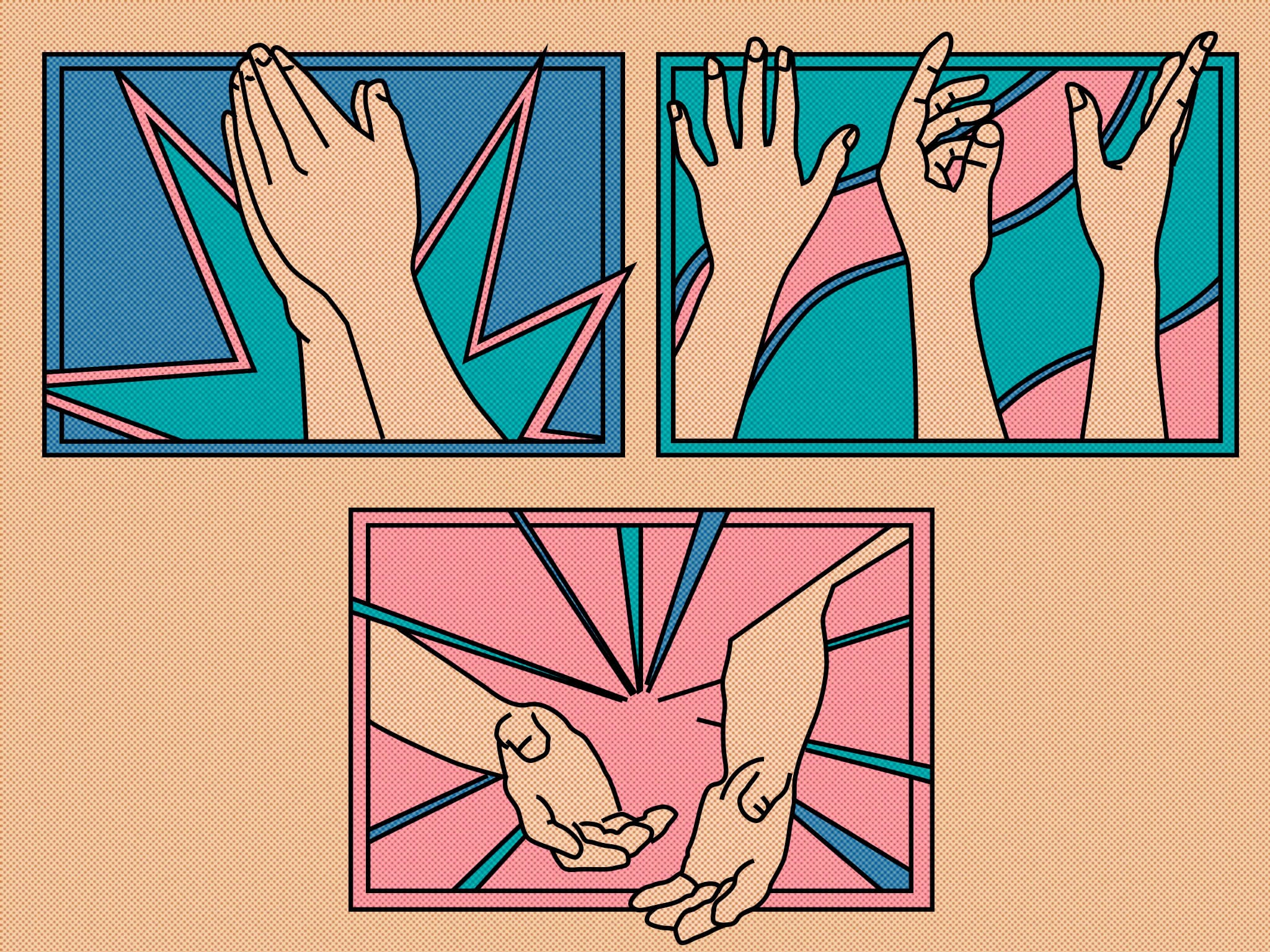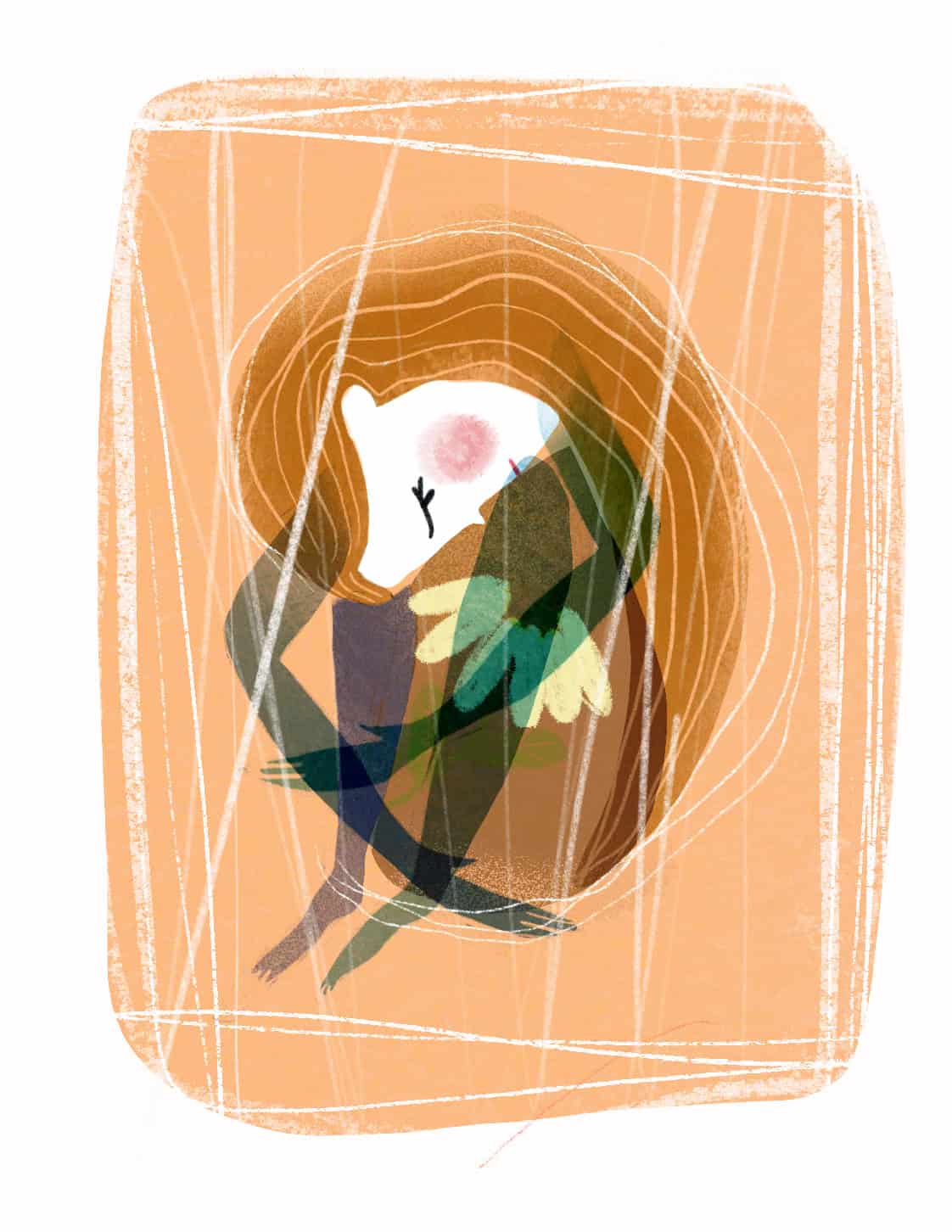C.S. Lewis, fantastique et autre monde
Texte écrit par Pierre-Luc Simard
Depuis sa publication dans les années 1950, Les chroniques de Narnia, écrites par le philosophe et poète anglais C. S. Lewis, connaissent un succès planétaire. Elles captivent des millions de jeunes et de moins jeunes. Mis à l’écran au début des années 2000, Narnia fera prochainement l’objet d’une nouvelle mouture sur la plateforme Netflix. Comment expliquer cette fascination? Pourquoi l’être humain aime-t-il autant les histoires fantastiques comme celles de Narnia? Allons voir ce qu’en dit C. S. Lewis lui-même.
Né en 1898, Clive Staples Lewis meurt en 1963. Durant sa carrière, il enseigne la littérature à l’Université d’Oxford et à l’Université de Cambridge. D’abord fervent athée, il se convertit au christianisme à l’âge adulte. On se souvient de lui comme l’un des plus grands défenseurs de la foi chrétienne au 20e siècle. Bon nombre de ses œuvres apologétiques l’attestent: The Problem of Pain, Miracles et Mere Christianity figurent parmi les meilleurs exemples. Créer des histoires fantastiques, avoue-t-il cependant, a toujours été sa vocation première.
Lewis place sur le spectre du fantastique – ou encore du mythologique, qu’il prend ici comme synonymes – tant les mythes anciens, comme ceux des Grecs et des Nordiques, que les contes de fées de son époque, comme Phantastes de George MacDonald. Toutes ces créations, à son avis, proviennent du même amour naturel à l’homme pour ce genre de récits.
Lewis réfléchit longuement sur ce que cet amour peut bien révéler au sujet de l’être humain. Il est accompagné dans cette démarche par son ami J. R. R. Tolkien, auteur du Seigneur des anneaux, autre œuvre du même genre encore éminemment populaire aujourd’hui. Lewis et lui arrivent à la conclusion que le fantastique fascine l’être humain parce qu’il lui offre un lieu idéal pour expérimenter et gouter les vérités les plus fondamentales de son existence, et de cette manière découvrir sa vraie place dans l’univers.
Plus précisément, le fantastique, selon Lewis, réveille les désirs spirituels les plus profonds de l’homme, en réactivant en lui l’intuition vague et confuse, présente en chacun, qu’il est fait pour un autre monde.
La beauté de la nature
Ce sont d’abord des observations philosophiques sur l’humain et ses aspirations spirituelles indéracinables qui conduisent Lewis vers cette conclusion. Ces observations valent que l’on soit croyant, athée ou agnostique. Il est impossible, pour Lewis, de comprendre l’amour pour le fantastique, ou en particulier le succès de Narnia et du Seigneur des anneaux, sans reconnaitre la présence de pareilles aspirations spirituelles cachées en chacun.
Dans «The Weight of Glory», Lewis compte sur ce fait: tous expérimentent la beauté, la grandeur et la majesté de la nature. Parfois, l’espace de quelques instants où il n’est plus distrait par son téléphone ou ses soucis quotidiens, l’homme est transporté par cette beauté. Elle semble s’adresser spécialement à lui telle une messagère: le caractère sublime d’une immense chute d’eau, l’aspect infini de l’horizon ou de la mer, la puissance silencieuse des montagnes, l’éclat lointain des étoiles. Toute cette beauté fait ressentir fugacement, pour Lewis, la présence de quelque chose de plus grand, de plus pur, avec lequel l’homme a l’impression d’être en communion.
Ce rendez-vous ne dure pourtant que quelques instants. En fin de compte, la magie s’estompe et l’on retourne à sa vie ordinaire. «Vous savez ce que je veux dire, écrit Lewis. Pendant quelques minutes, nous avons eu l’illusion d’appartenir à ce monde. Maintenant, nous nous réveillons pour voir que ce n’est pas le cas» («The Weight of Glory», p. 206; les traductions de l’anglais sont de moi). La beauté a souri dans notre direction, mais ne nous a pas vus, accueillis.
Le désir spirituel d’être chez soi
L’expérience d’être coupé, séparé de la réalité devant soi et de sa beauté crée confusément en tout homme, remarque Lewis, le sentiment d’être en exil sur Terre, un étranger. En retour, on désire désormais se sentir chez soi, retrouver sa vraie patrie lointaine. C’est un désir profond «d’être réuni avec quelque chose dans l’univers dont on se sent coupé, d’être à l’intérieur d’une porte qu’on a toujours vue de l’extérieur» (ibid., p. 209). Pareil désir n’est pas une pure invention de l’esprit. Il est éveillé au contact de la réalité elle-même; son origine est objective.
C’est du moins la compréhension qu’en a Lewis. Pour la plupart des hommes, toutefois, l’explication reste beaucoup plus simple, pour ne pas dire superficielle. Pour expliquer ce genre d’expérience, note-t-il, on se contente d’appeler cela «la beauté», comme si ce nom aidait vraiment à clarifier ce que l’on a vécu.
Évidemment, tout le monde aime les belles choses, les paysages majestueux, les couchers de soleil flamboyants! Rien de plus facile à dire. Mais Lewis analyse finement la psychologie humaine: «Nous ne voulons pas simplement voir la beauté… Nous voulons quelque chose d’autre qui peut difficilement être exprimé par des mots – être uni à la beauté qu’on voit, passer en elle, la recevoir en soi-même, se baigner en elle, en devenir une partie» (ibid., p. 208).
Portée universelle
Lewis s’empresse de préciser que ce genre d’expérience n’est pas l’effet de la religion, comme une sorte de formatage, mais plutôt l’une des causes qui conduit l’homme depuis les temps anciens à concevoir des histoires – prises comme réelles ou fictives – afin de renouveler l’expérience et de faire à nouveau cette rencontre.
Même les plus grands athées de notre monde – pour peu qu’ils soient honnêtes avec eux-mêmes – confessent être habités par le même désir, la même intuition. Le célèbre philosophe du siècle dernier, Bertrand Russell, athée convaincu jusqu’à sa mort, en témoigne:
«Le noyau de mon être est toujours et éternellement une terrible douleur… à la recherche de quelque chose au-delà de ce que contient le monde visible, quelque chose de transfiguré et d’infini – la vision béatifique, Dieu – je ne le trouve pas, je ne pense pas qu’on puisse le trouver – mais l’amour de ce quelque chose est toute ma vie… c’est la véritable source de vie en moi» (The Selected Letters of Bertrand Russell: The Public Years 1914-1970, p. 85).
Les histoires fantastiques comme Narnia ou Le Seigneur des anneaux permettent justement d’explorer cette aspiration profonde. Dans une mesure limitée, elles permettent de vivre la communion avec ce quelque chose de plus grand et d’indescriptible, d’expérimenter cet autre monde et, en un certain sens, de s’y rendre déjà.
Il reste toutefois à comprendre comment ce petit miracle de littérature se produit, surtout dans un monde qui relègue souvent l’au-delà au domaine de l’irrationnel et du préscientifique.
Pas question d’y penser!
Que l’on en soit conscient ou non, l’éducation moderne arme, comme un système de défense psychologique, contre la menace d’une invasion d’idées «religieuses» ou «spirituelles». Lewis appelle cela les «dragons guetteurs» de la conscience («our watchful dragons», écrit-il dans «Sometimes Fairy Stories May Say Best What’s to be Said», p. 37). Dès que quelqu’un s’approche de trop près pour parler de Dieu, de Jésus, de l’au-delà, les dragons rugissent.
Incapable de distinguer la science du scientisme, on s’interdit ainsi de concevoir quelque chose au-delà du monde matériel et visible, comme si la science l’avait réfuté, alors qu’il n’en est rien.
Lewis décrit bien le réflexe de pensée athée qu’il a dans ses jeunes années: «J’étais si loin des vœux pieux que je ne tenais pratiquement rien comme vrai à moins que cela ne contredise mes désirs» (Surprised by Joy, p. 198). Presque tout ce qu’il aime alors – comme la beauté, le fantastique, la musique –, il le croit illusoire et imaginaire; et presque tout ce qu’il croit réel, il le pense triste et vide de sens. Or, la description s’applique, certes à un moindre degré, à bien des gens aujourd’hui lorsqu’ils regardent avec soupçon la religion chrétienne en se disant que «c’est trop beau pour être vrai», comme s’il était impossible par principe que le vrai et le beau coïncident.
Comment donc le fantastique fera-t-il pour outrepasser ces «dragons guetteurs» et ainsi permettre à l’homme de vivre les intuitions et les aspirations spirituelles cachées en lui, pour lui rappeler ses vrais désirs?
Expérimenter la vérité
Pour Lewis, la réponse est simple: le fantastique se fraie un chemin entre l’expérience brute du concret et l’abstraction de l’intelligence.
Normalement, on fait face à un dilemme: soit on goute le concret sans le connaitre dans l’abstrait; soit on connait l’abstrait sans le gouter dans le concret. «Nous ne pouvons pas, écrit Lewis, étudier rationnellement le plaisir pendant l’embrassade nuptiale, ni la repentance pendant que nous nous repentons, ni analyser la nature de l’humour pendant que nous rions aux éclats» («Myth Became Fact», p. 65). C’est après avoir expérimenté les choses qu’on réfléchit sur elles pour les comprendre et les définir et, ce faisant, on ne les expérimente plus, on en est coupé.
Or, le fantastique esquive partiellement ce dilemme. Il permet pour ainsi dire d’expérimenter sous forme concrète toutes ces vérités abstraites auxquelles on s’interdit de songer, mais dont on porte pourtant la vive intuition cachée au fond de soi-même. De fait, tout bon récit fantastique ou mythologique cherche à expérimenter un principe universel en des personnages et des lieux précis, sans jamais formuler le principe explicitement. Du moment que le principe est formulé, conscient, on est de retour dans le domaine de l’abstraction: on ne goute plus la chose, on en est coupé.
La vision séculière et athée, pleine de méfiance envers ce genre de perspective, répugne à l’idée d’une vie après la mort. Le bonheur se trouve sur Terre, insiste-t-on. Et pourtant… comme on aimerait avoir la chance de vivre en Narnia! Là – on le pressent – se trouverait le véritable bonheur, la vraie patrie. De même, à voir Aslan conduire Lucy et Edmund aux confins de l’univers, devant la porte qui mène vers une terre éternelle et pure, on sent son cœur se dénouer et respirer pour de vrai, comme s’il avait enfin trouvé ce qu’il cherchait depuis toujours.
Souvent, on se gonfle de mépris simplement à entendre parler de Jésus et de ses enseignements, ces «vérités abstraites». Pourtant, tous affectionnent naturellement le roi Aslan, si noble, sage, fort et plein d’amour. Comme on voudrait qu’Aslan existe vraiment, être son ami. Mais Aslan, c’est Jésus! C’est Jésus expérimenté, gouté, vécu, plutôt qu’expliqué dans un langage intellectuel et abstrait, déconnecté des émotions. Comme on aimerait, à son tour, être exhorté par Aslan à faire le bien et à éviter le mal. On le sent comme un appel qui résonne au plus profond de soi, un appel à devenir des héros – ou des saints.
Voilà le genre de petit miracle que produit le fantastique: il réveille les intuitions cachées au plus intime de la conscience sur le sens profond de la vie humaine. Il le fait sans imposer de l’extérieur comme par violence des idées qu’on n’a jamais eues, mais en épousant de l’intérieur celles qu’on possède déjà, en les irriguant comme la pluie fait naturellement pousser l’herbe.
Une fuite vers le réel
Tout cela est bien beau, dira-t-on, mais n’est-il pas dangereux de fuir ainsi le réel, de se perdre dans des mondes imaginaires inventés par des hommes, comme Lewis ou Tolkien?
De fait, certaines fuites sont nocives. On ne gagne rien par exemple à éviter d’interagir avec de vraies personnes ou à fantasmer sur une vie d’opulence. Mais d’autres fuites sont saines. Pour Lewis, le fantastique offre l’occasion de fuir, en un sens, vers quelque chose de plus réel encore que la vie ordinaire, où l’on ne perçoit plus le sens profond des choses.
C’est tellement une fuite vers le réel qu’à son retour dans le monde ordinaire, le regard change: les choses apparaissent plus merveilleuses, comme dotées d’une nouvelle signification qui échappait jusqu’alors. Après avoir rencontré Aslan le lion ou les Ents – de grands arbres dotés de sagesse dans Le Seigneur des anneaux –, les lions et les arbres du monde réel acquièrent une nouvelle dimension. Ils sont réenchantés.
Et si on y réfléchit bien, on se rend compte que les lions et les arbres ont pu représenter la noblesse et la sagesse dans une histoire précisément parce qu’ils les évoquent déjà dans ce monde réel. Ils sont déjà, ici-bas, les images de réalités plus abstraites. Autrement, Aslan aurait pu être n’importe quoi – une limace, par exemple –, et les Ents auraient pu être des pissenlits.
Contrairement à l’opinion courante, le fantastique, bien utilisé, approche du réel plus qu’il n’en éloigne: non seulement en réveillant en chacun l’intuition d’un autre monde encore plus réel et stable que celui-ci, mais aussi en manifestant le caractère déjà profondément symbolique de la nature, qui est souvent occulté par l’éducation et l’habitude. Et c’est bien pour cela, selon Lewis, que l’homme aime tant le fantastique.
RÉFÉRENCES
Bertrand Russel, The Selected Letters of Bertrand Russell: The Public Years 1914-1970, Londres, Routledge, 2001, 660 p.
C. S. Lewis, Surprised by Joy, Londres, William Collins, 2012, 277 p.
C. S. Lewis, «Myth Became Fact», dans God in the Dock, Grand Rapids, Eerdmans, 1970, p. 63-67.
C. S. Lewis, «Sometimes Fairy Stories May Say Best What’s to be Said», dans Of Other Worlds: Essays and Stories, Londres, Geoffrey Bles, 1966, p. 35-38.
C. S. Lewis, «The Weight of Glory», dans They Asked for a Paper, Londres, Goeffrey Bles, p. 197-211.