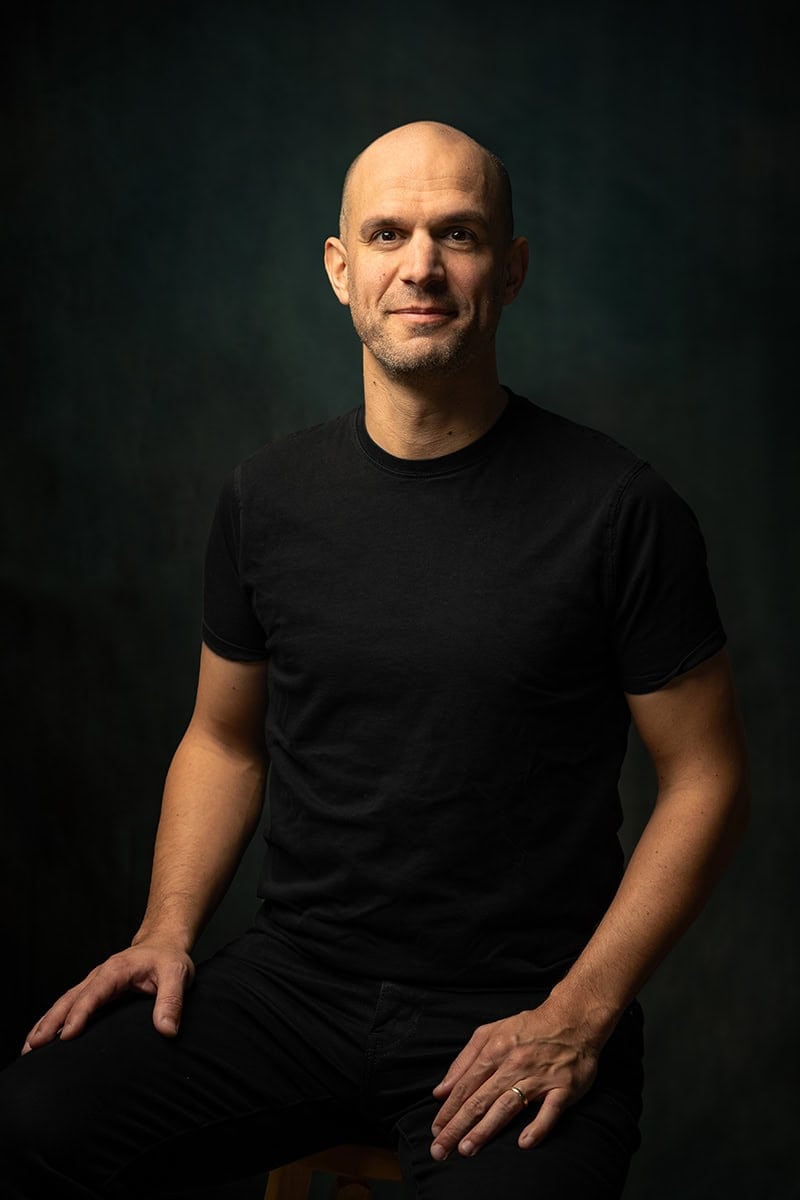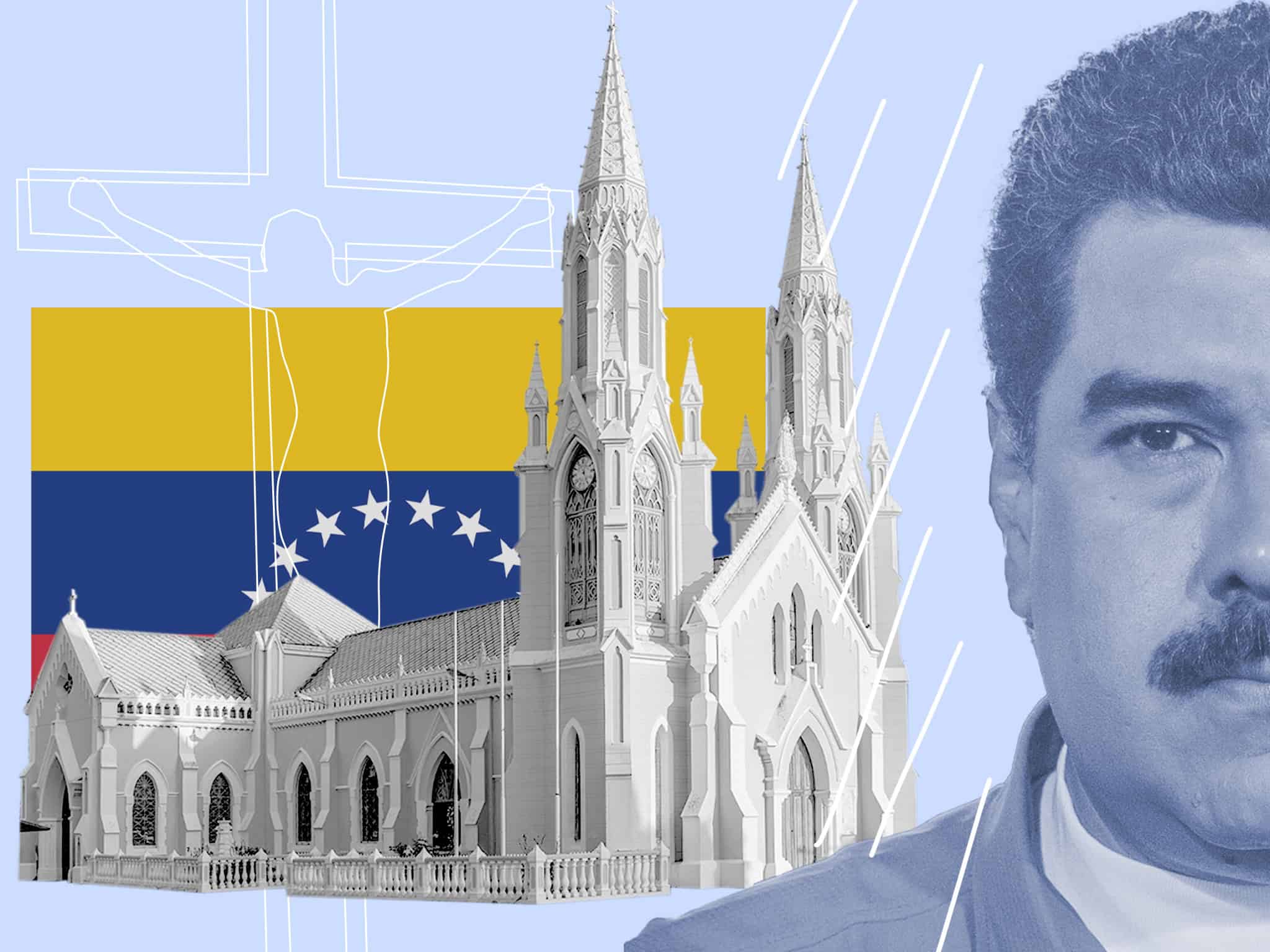Quand la bise fut venue
Moi,
j'raconte des histoires
Des histoires que vous m'avez contées
J'les re-conte à ma manière
Mais tout seul, j'peux pas les inventer
– Paul Piché
Au 18e siècle, l’écrivain et précepteur Jean-Jacques Rousseau déconseillait fortement d’enseigner «La Cigale et la Fourmi» aux enfants. Selon lui, la fable d’ouverture du célèbre recueil de La Fontaine était trop complexe et sa morale ambigüe.
Sur les bancs d’école du 20e, à l’époque antédiluvienne où l’on enseignait encore les classiques littéraires aux petits prépubères québécois, on nous avait pourtant transmis l’interprétation la plus laconique et transparente: «Les vacances sont finies, à l’ouvrage, bande de fainéants!» Rien d’ambigu ici.
Et c’est ainsi que la poésie se trouvait pervertie en argument de vente pour faire de nous de futurs self-made men aussi égoïstes et présomptueux que la fourmi de l’histoire. Du storytelling au storyselling, dirait le philosophe Byung-Chul Han. Youpi!
Et nous nous penchions de nouveau sur nos copies pour mémoriser les vers, avant de les répéter à voix haute. Mécaniquement, sans intonations, sans style.
Pour Péguy, si l’on veut changer le monde, ça ne prend pas une armée ou une guillotine. «Ce qui fait une révolution, ce qui fait la révolution, c’est un certain rythme, propre, c’est un certain sens, une certaine forme, une certaine nature, un certain mouvement, une certaine vie, une certaine âme, un certain caractère, un certain style, parce que le style est de l’homme même» (Les suppliants parallèles, 1905).
Encore au sujet du style. Je m’apprêtais à citer un vers de la chanson «Tu peux partir» de Daniel Bélanger en disant qu’on peut écrire des fables ou des recettes de ragout, des romans ou des traités de théologie, «tout est dans la manière». Quoi que l’on écrive, le style est crucial. Mais j’ai déjà dit ça ailleurs, dans un autre édito.
C’est dommage.
Chaque fois que vient
la bise,
Et que je m’installe pour raconter une histoire,
me frappe soudain la hantise
qu’il s’agisse en fait d’un radotage.
D’abord, il y a la forme. Le lecteur sera en zone connue s’il y retrouve au moins une anecdote tirée de mon quotidien, point d’ancrage ou pivot vers une réflexion wannabe profonde. Ensuite, mes textes doivent immanquablement être ponctués d’apostrophes familières (ou familiales); une ou deux brèches dans le quatrième mur qui devait séparer l’auteur du lecteur. On ajoute aussi une pincée de jeux de mots douteux.
Et sur le fond, ce «Je» dont toutes les fables de notre époque sont affublées, qui me colle aux baskets, moi aussi. Depuis l’apparition du récamier et la disparition du confessionnal, nos récits se vautrent bien souvent dans l’introspection. J’en suis.
Mon truc pour éviter la honte de la redite? Je puise dans un passé récent, disons plus récent que la plus récente livraison du Verbe à votre porte. Et j’espère secrètement que Robert, fidèle réviseur depuis le jour de mon premier édito, aura la vigilance de corriger la répétition, si elle advenait… et la délicatesse de ne jamais m’en parler. Merci, Robert!
Mais dans le mot raconter, on trouve tout de même cette idée de conter encore, et encore. De «re-conter», comme chantait Piché, puis Fred Pellerin lorsqu’il chante du Piché. Ainsi de suite. Conter de nouveau, de vieilles histoires. Comme un père avec ses enfants avant la routine du soir qu’il faut répéter elle aussi (parfois en haussant légèrement, à peine, le ton): «Ramassez le salon, brossez vos dents et faites votre pipi si vous voulez que je vous raconte une histoire.»
*
Laissez-moi vous raconter.
Je ne peux pas tout raconter, évidemment. Sinon, ce serait obscène, ou indigeste. «La vérité, c’est pas mangeable», écrivait l’infréquentable au nom de chanteuse dans son Voyage au bout de la nuit. Tenez-vous vraiment à connaitre tous les menus détails du menu que j’ai ingurgité au petit déjeuner ce matin? C’est précisément pour ça qu’il nous faut des récits, cette médiation entre l’évènement et l’auditeur. Les récits font le tri dans les faits, mais insufflent surtout juste ce qu’il faut de mystère pour que l’histoire soit appétissante. Nous sommes faits pour écouter des histoires qui titillent les sens, et pas seulement d’insipides bulletins de nouvelles où défilent des flots d’informations sans aucun sens.
«La narration est un jeu d’ombre et de lumière, de visible et d’invisible, de proximité et de lointain», écrit Byung-Chul Han dans La crise dans le récit. «Le désenchantement actuel est dû à l’informatisation du monde. La transparence est la nouvelle forme de désenchantement. Elle désenchante le monde en le décomposant en données et en informations.»
Nous ne sommes ni des intelligences artificielles qui absorbent et recrachent des données sans vie ni des fourmis qui ne communiquent entre elles que des informations sans poésie.
Rousseau a raison sur ce point: «La Cigale…» est ambigüe. (Vous suivez toujours? Allez, on s’accroche.) Bien plus qu’un bête plaidoyer pour le travail constant et contre le farniente des gratteux-de-guitare, le texte de La Fontaine contient nombre de mystères insoupçonnés.
Or, pour découvrir quelques secrets cachés dans le récit, il faut parfois descendre de notre rationalisme machinal, de notre fâcheuse tendance à penser comme des robots qui voient le monde comme une série de problèmes techniques à régler. Et il faut se pencher à ras l’humus, au niveau de ces petites bêtes, justement.
«Une cigale, ayant chanté
Tout l’été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue»
La césure n’est pas anodine. Ce «tout l’été» brise le rythme attendu, parfaitement heptasyllabique partout ailleurs. Par la forme, le style dans la rédaction, le fabuliste nous force presque à porter attention à ce qui a l’apparence d’un accident. Ce «tout l’été» souligne que l’insecte cantatrice n’a pas chômé du tout.
Mais ce que ni Rousseau ni même La Fontaine ne savaient à l’époque, c’est que la cigale vit la vaste majorité de son existence à l’état larvaire, cachée sous la terre. Une fois à maturité, son séjour au soleil ne dure que quelques semaines. Disons, le temps d’un été.
Qu’est-ce qui a assez de valeur pour que nous y passions l’essentiel de notre brève existence?
Faire ce pour quoi nous sommes faits. Entonner un récital.
*
«Nous ne racontons plus d’histoires. Nous communiquons en revanche à l’excès. Nous postons, nous téléchargeons et nous likons», écrit encore Byung-Chul Han, en soulignant lui-même un mot sur deux.
Plus tôt cet automne, j’ai liké un post de l’historien de l’art français Pierre Téqui. Il y couchait sur pixels une histoire qui mérite d’être contée et racontée encore.
En montant à l’échafaud, en juillet 1794, où les attendait une lame de la Terreur révolutionnaire française, les carmélites de Compiègne chantaient des hymnes de louange à Dieu. On raconte qu’un silence stupéfait planait dans la foule, habituellement plus bavarde lors des exécutions. Les badauds cois n’avaient d’autre choix que de retenir leurs huées devant le courage cardinal et l’espérance théologale des seize femmes.
Mais après ce silence, rappelle Téqui, la nouvelle devait se propager sur toute la Terre. Après avoir chanté les prodiges du Créateur en marchant vers la guillotine, les héroïnes devaient à leur tour être chantées par des hérauts de ces nouveaux Actes des apôtres.
À cet effet, un message du pape Léon XIV a été lu à Paris lors d’une messe d’action de grâce pour la canonisation des saintes carmélites: «[Elles] ont particulièrement forcé l’admiration de leurs geôliers eux-mêmes et ont imprimé dans les esprits et dans les cœurs les plus endurcis un trouble bienfaisant laissant place au divin. L’abondance des œuvres littéraires inspirées par leur martyre prouve, s’il en était besoin, que les artistes ne s’y sont pas plus trompés que la foule étonnamment silencieuse au moment du supplice.»
Un rapport historique des faits ne suffisait pas. Il fallait des récits, du théâtre, de la musique. Il fallait les mots de Bernanos et les notes de Poulenc pour que le monde entier saisisse la portée du drame de la Terreur, et plus encore le rayonnement éternel d’une vie donnée librement, par amour de Dieu et des hommes.
Sans doute ces religieuses ont-elles été accueillies par le Père avec tout le style qu’on connait au Créateur des fourmis vaillantes, des cigales chantantes et des humains raconteurs:
«Vous chantiez? J’en suis fort aise. Eh bien! Dansez maintenant.»
Saint-Michel-de-Sillery
16 septembre 2025, en la fête des saints Corneille et Cyprien, intercesseurs des chrétiens ayant renié leur foi pour échapper au martyre