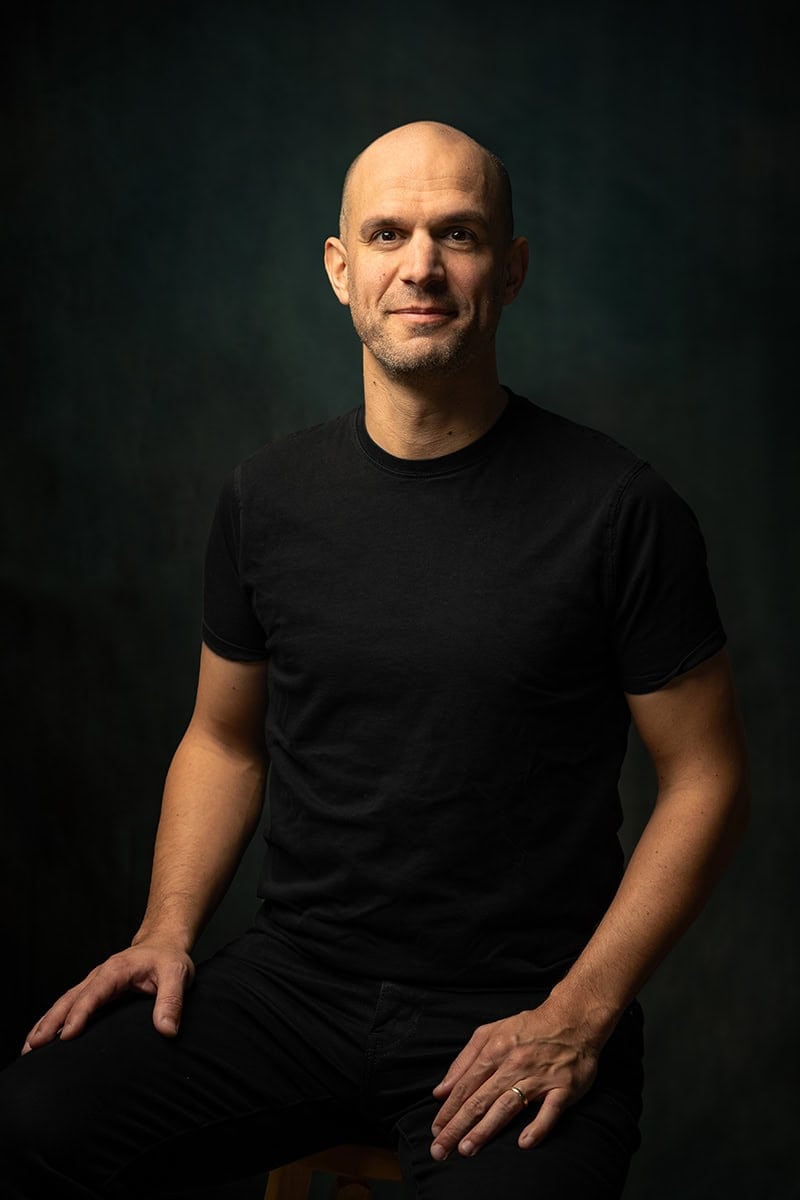L’espoir déçoit
Écoanxiété, conflits commerciaux et militaires, crise du logement et flambée des prix au supermarché… Les raisons de désespérer semblent se multiplier chaque jour dans les bulletins de nouvelles. Pourtant, le remède au désespoir ambiant n’est peut-être pas ce regain d’espoir dont certains chroniqueurs appellent de leurs vœux.
Le 6 mars dernier, le philosophe Jérémie McEwen proposait dans les pages du Devoir une réflexion joliment titrée « L’espérance est un mal ».
« L’espérance est une illusion, un échafaud métaphysique à détruire une fois pour toutes en nos cœurs. L’espérance en des jours meilleurs […] est cette absurdité eschatologique appliquée au politique, cette absurdité religieuse. »
Contre toute espérance, je vous dirais que je suis plutôt d’accord avec le constat de McEwen. Mais je crois qu’il fait simplement une petite erreur dans le choix des termes.
Car nous avons la chance, en français, de pouvoir espérer de deux manières. Le plus souvent, nous espérons avec l’espoir. Et parfois, nous avons la grâce d’espérer avec espérance.
L’espoir en des jours meilleurs, celui que nous mettons dans le progrès, la croissance infinie ou l’avancement technologique sans limite, la fin de l’histoire et l’avènement d’un monde sans aucun conflit. Tous ces espoirs ont la vocation commune de nous décevoir tôt ou tard.
À la différence de l’espérance, l’espoir déçoit. La plupart du temps, on espère que l’autre finira par changer, que les dieux viendront régler nos problèmes de récolte, de fertilité ou de voisin insupportable. En vain.
L’espoir, c’est espérer que nos problèmes très prosaïques, très terre-à-terre, se règlent. Ça peut aller de la vanité de la calvitie au problème hautement plus sérieux de la faim dans le monde. Nous avons tous espoir que tout ça se règle un jour. Et pourtant…
Deux semaines plus tard, toujours dans mon journal matinal, Josée Blanchette citait Nicole Bordeleau et proposait une distinction. « L’espoir est plus circonstanciel; il fluctue. L’espérance est plus stable. »
Ce n’est pas fou, mais ça n’explique pas pourquoi l’espérance est « plus stable ». L’espérance est plus stable parce qu’elle trouve son ancrage dans un temps long – voire dans l’éternité.
L’espérance, c’est la confiance que même si nos problèmes ne se règlent pas, un plus grand bien peut en émerger. Dans cette vie-ci ou au-delà.
McEwen a raison sur un autre point. L’espérance est éminemment eschatologique, orientée vers ce qu’on appelait autrefois « les fins dernières ».
Dans L’espérance ne déçoit pas, le texte qu’a proposé le pape François dernièrement, le souverain pontife souligne que l’espérance nous permet de sortir un peu de l’immédiateté, ce « ici et maintenant », dans lequel notre époque nous enferme bien souvent.
Et contrairement à ce que Marx soutenait quand il comparait les religions à l’opium du peuple, l’espérance, cet ancrage dans l’éternité, permet un engagement encore plus désintéressé dans le bien que l’on peut faire autour de nous. Si notre vie ne se limite pas à notre passage en ce bas monde, nous n’avons plus à compter notre temps chichement. Nous pouvons désormais offrir au prochain ce temps si rare et précieux, sans mesquinerie.
Le désespoir ambiant serait donc une occasion de revoir notre rapport au temps et à l’attente. Dans cette interpellation pertinente (pas seulement pour ses ouailles), le pape invite d’ailleurs à redécouvrir la nécessité de la patience dans « l’attente du bien ».
Que ce bien advienne dans cette vie ou dans l’autre.