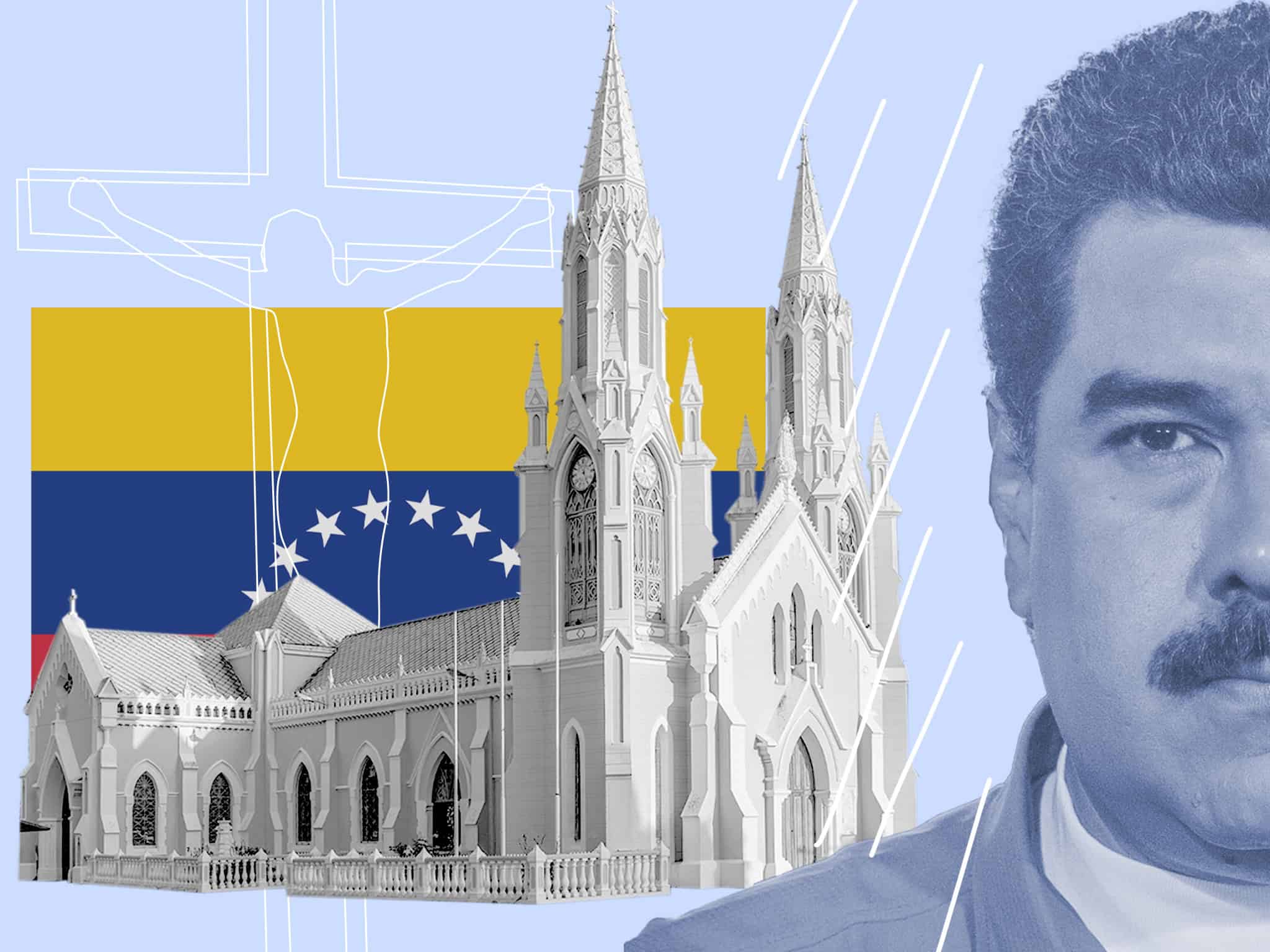La religion à l’école
Je suis une animatrice heureuse de retrouver son poste au secondaire, dans un contexte où des coupes majeures affectent l’ensemble du réseau de l’éducation. L’établissement qui m’emploie n’est pas épargné, mais j’imagine que nous avons davantage de marge de manœuvre que nos voisins du public.
Je suis lucide: si l’on avait procédé par vote populaire, mon poste aurait été supprimé. Animatrice de vie pastorale et communautaire, ça évoque au mieux des métaphores quétaines, au pire le spectre de l’endoctrinement et de l’obscurantisme. S’ils savaient. Cette année, j’aurai encore la chance d’être témoin de petits miracles.
Pas de chiffres
L’animateur œuvre en coulisses, en position basse. Il installe le cadre, prépare le terrain, crée les conditions pour que d’autres puissent rayonner. En tissant des liens, il apaise les tensions et contribue à bâtir une communauté d’apprentissage plus humaine.
C’est un travail de fond, souvent invisible, mais qui agit concrètement sur des enjeux dont on parle constamment: intimidation, radicalisation, suicide. Contrairement à d’autres collègues professionnels, je ne travaille pas à partir de données probantes. Il est difficile de mesurer les résultats de mes actions. On nous le dit parfois: «Ça a changé ma vie.» On ne saura jamais vraiment comment ni à quelle échelle. Mais on continue d’y croire.
Pourquoi?
Jusqu’à tout récemment, il était encore possible de parler de vie spirituelle dans les écoles québécoises. Par «spiritualité», on entend ici toutes ces grandes questions qui nous dépassent: Qu’est-ce qu’une vie réussie? Pourquoi souffre-t-on? À quoi bon vivre, si l’on doit mourir?
Les écoles ne sont pas imperméables à ce qui se passe à l’extérieur de leurs murs. Les élèves sont connectés à l’actualité. Ils vivent des ruptures, des deuils. Ils sont inquiets par rapport à l’avenir. Bien des situations suscitent des questions sans réponse, même pour nous, les éducateurs. C’est précisément là, aux limites, que le spirituel intervient. Parce que cet aspect est difficile à aborder en dehors de toute tradition religieuse, on a choisi de le nier, pour le remplacer par le concept de développement personnel.
L’un sans l’autre
Je comprends la décision du gouvernement. Dans des écoles prétendument laïques, on retrouvait un peu de tout, parfois n’importe quoi: bols tibétains, loi de l’attraction, méditation en pleine conscience, etc. Un certain flou régnait.
Mais la notion de développement personnel n’est elle-même pas exempte d’idéologie. On apprend à adopter de saines habitudes de vie, à mieux se connaitre, à nommer et à communiquer ce qu’on ressent. L’apprentissage des «compétences socio-émotionnelles» est plus que jamais nécessaire et bénéfique. Mais dans quel but?
La religion, sinon le spirituel, soutient la relation à Dieu, certes, mais aussi aux autres. Quelle est la place de l’autre dans le développement personnel? Un instrument de croissance? Et à quoi bon se dépasser, si ce n’est que pour mieux performer? L’amour, défini comme un don, est-il encore audible dans ce cadre?
À force de se regarder le nombril, chacun risque de finir seul, face à lui-même.