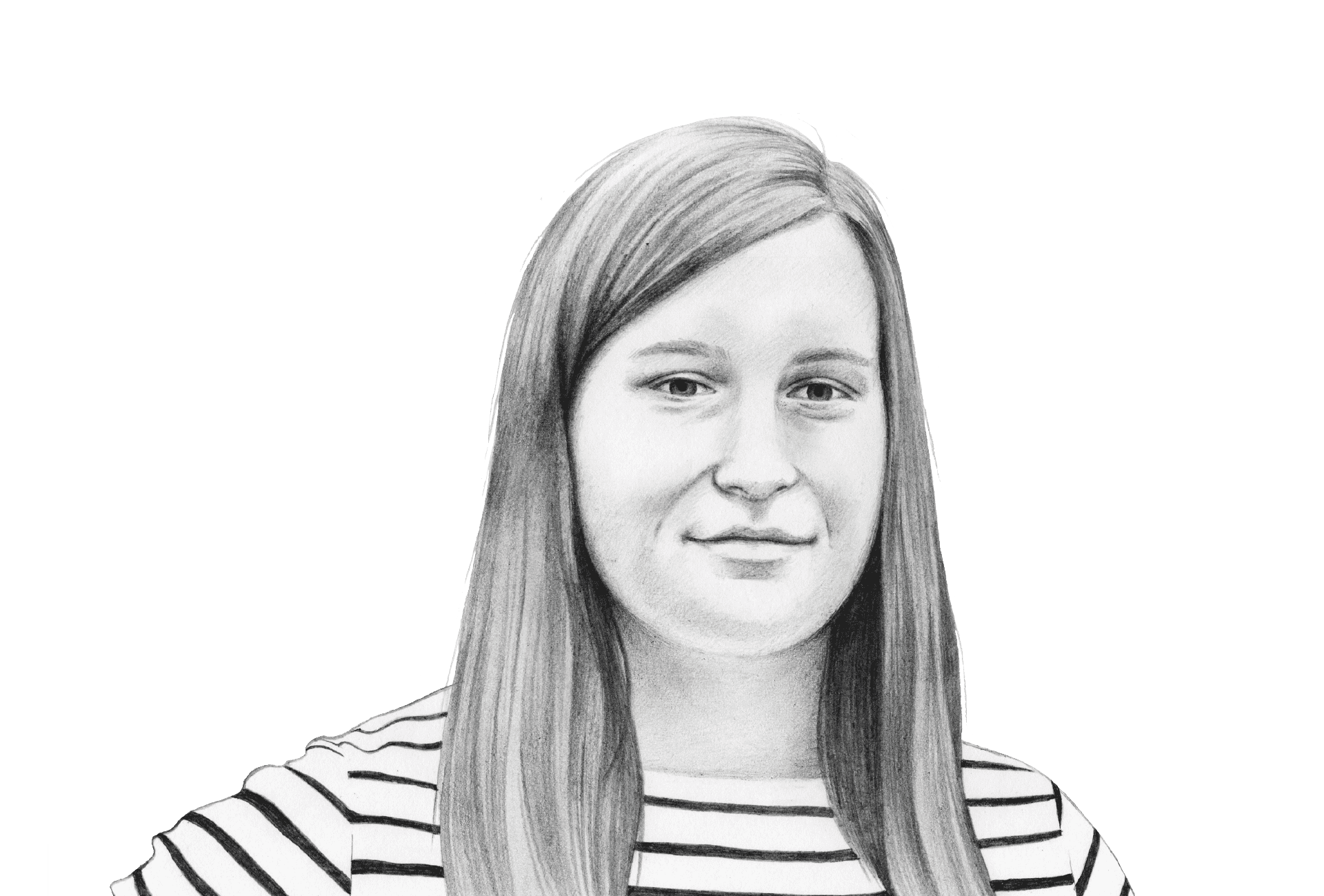
La politesse: fausse vertu?
Dernièrement, le ministre Drainville a annoncé un plan pour renforcer le respect et le civisme dans les écoles du Québec. À partir de janvier prochain, les élèves devront notamment vouvoyer leur professeur.
Certains s’en offusquent. Pas moi. Même si, à une époque, ça m’aurait ennuyée. De fait, adolescente, je me faisais un plaisir de tutoyer mes profs.
Quand j’y repense, il y avait du bon et du mauvais à mon manque de politesse. L’ivraie et le bon grain poussaient ensemble. Je tutoyais en partie par manque d’humilité, et parce que j’avais un problème avec l’autorité. Mais aussi, parce que j’avais soif de sincérité et de proximité.
J’ai encore un peu cette tendance aujourd’hui. On complimente d’ailleurs plus souvent mon franc-parler – ou ma grande gueule comme dirait mon mari – que ma politesse.
C’est que je tombe parfois dans un sophisme du conséquent. C’est évident que lorsqu’on est familier, les manières s’assouplissent et on discute plus librement, sans convention. Mais ce n’est pas en assouplissant les manières qu’on se rapproche nécessairement de quelqu’un.
L’influence du langage
Le pari du ministre Drainville, au fond, c’est ça: en modifiant le langage, il espère changer les cœurs.
Pari absurde, selon certains. Plusieurs nous ont rappelé dernièrement qu’on peut insulter en vouvoyant, haïr poliment. C’est vrai. La politesse, dit le philosophe André Compte-Sponville, n’est pas réellement une vertu. Elle est une apparence, comme un vêtement. Et si l’habit ne fait pas le moine, de même la politesse ne fait pas la vertu.
Sauf que, la politesse prépare la vertu. Croire le contraire, c’est méconnaitre le pouvoir des mots. Confucius, philosophe chinois, affirmait d’ailleurs que rectifier le langage devrait être la priorité d’un gouvernement. «Si les Noms sont incorrects, on ne peut tenir de discours cohérent. Si le langage est incohérent, les affaires d’État ne peuvent se régler.», argumentait-il.
C’est qu’on finit par penser comme on parle. On réfléchit autrement quand on utilise «aide médicale à mourir» plutôt que «suicide assisté», ou encore «séparatiste» plutôt que «indépendantiste». Déterminer le langage, c’est prendre les rênes du débat. Tous les bons politiciens le savent.
Et dire «vous» plutôt que «tu», ça change quoi? Eh bien, ça introduit dans l’esprit une distance, une marque de respect. C’est reconnaitre, je le pressentais adolescente, que le professeur devant moi m’est supérieur en quelque manière.
Un ordre humain
Une pédopsychiatre s’offusquait récemment devant la mesure de Drainville. Demander le vouvoiement, c’est, écrit-elle, «renvoyer l’enfant à sa niche». C’est, poursuit-elle, «voir l’enfant comme un être inférieur, incomplet, qui ne gagnera son salut qu’en devenant adulte après un dressage».
Est-ce vrai? Demander le vouvoiement, est-ce traiter les adolescents comme des chiens?
Je pense que c’est plutôt le contraire. Les animaux ne connaissent pas la politesse. Agir sans manière, c’est se comporter comme une bête. Refuser toute hiérarchie, c’est tomber dans le désordre. C’est manquer à l’humanité.
La politesse, bien comprise, rend libre. Elle rend visible la dignité d’autrui et sa propre dignité.
La force des habitudes
Une autre chroniqueuse demandait de s’adresser à l’intelligence des enfants plutôt que de leur imposer des règles. Elle suggère, entre autres, d’ajouter des cours sur le civisme en ligne au cursus scolaire.
Je ne sais pas pour vous, mais s’il y a bien une chose à l’adolescence qui m’aurait donné envie de niaiser sur mon cellulaire et de dire «tu» à mes profs, c’est bien des cours sur le civisme…
C’est que la morale dépend plus de l’habitude que de l’enseignement, reconnaissait déjà le philosophe grec Aristote. C’est de l’ordre de l’expérience. Même un adulte dépendant à son téléphone ne change pas à coups de discours. Il faut des habitudes : ne pas l’emmener dans la chambre à coucher, l’éteindre au moment de travailler ou le soir, etc.
Fake it until you make it, aime-t-on répéter. C’est vrai en morale. Jouons le jeu de la politesse, on se surprendra peut-être à devenir, qui sait, respectueux en vérité.
Ce contenu n'a pas été chargé automatiquement puisqu'il provient d'un fournisseur externe qui pourrait ne pas respecter vos préférences en matière de témoins.












