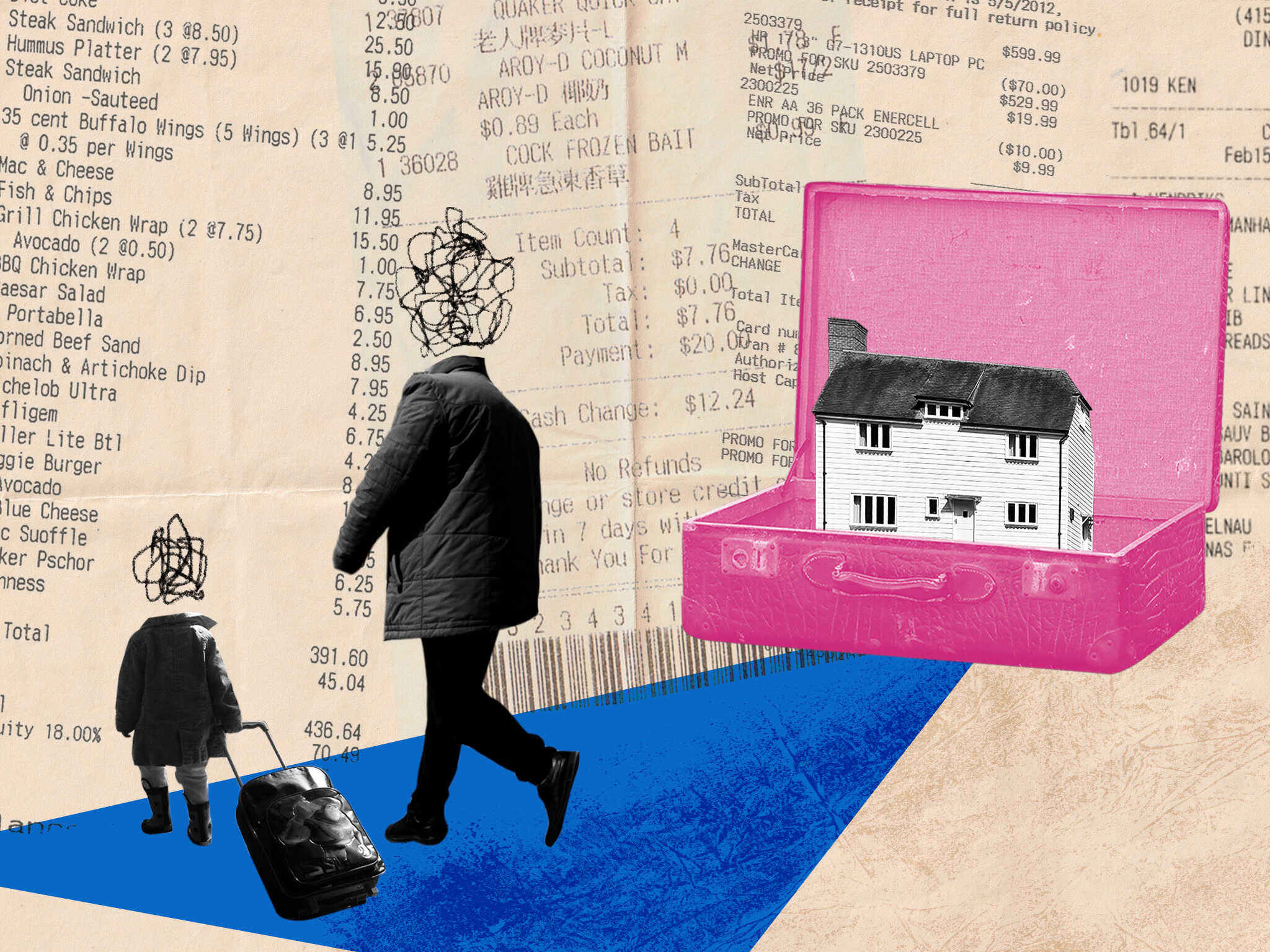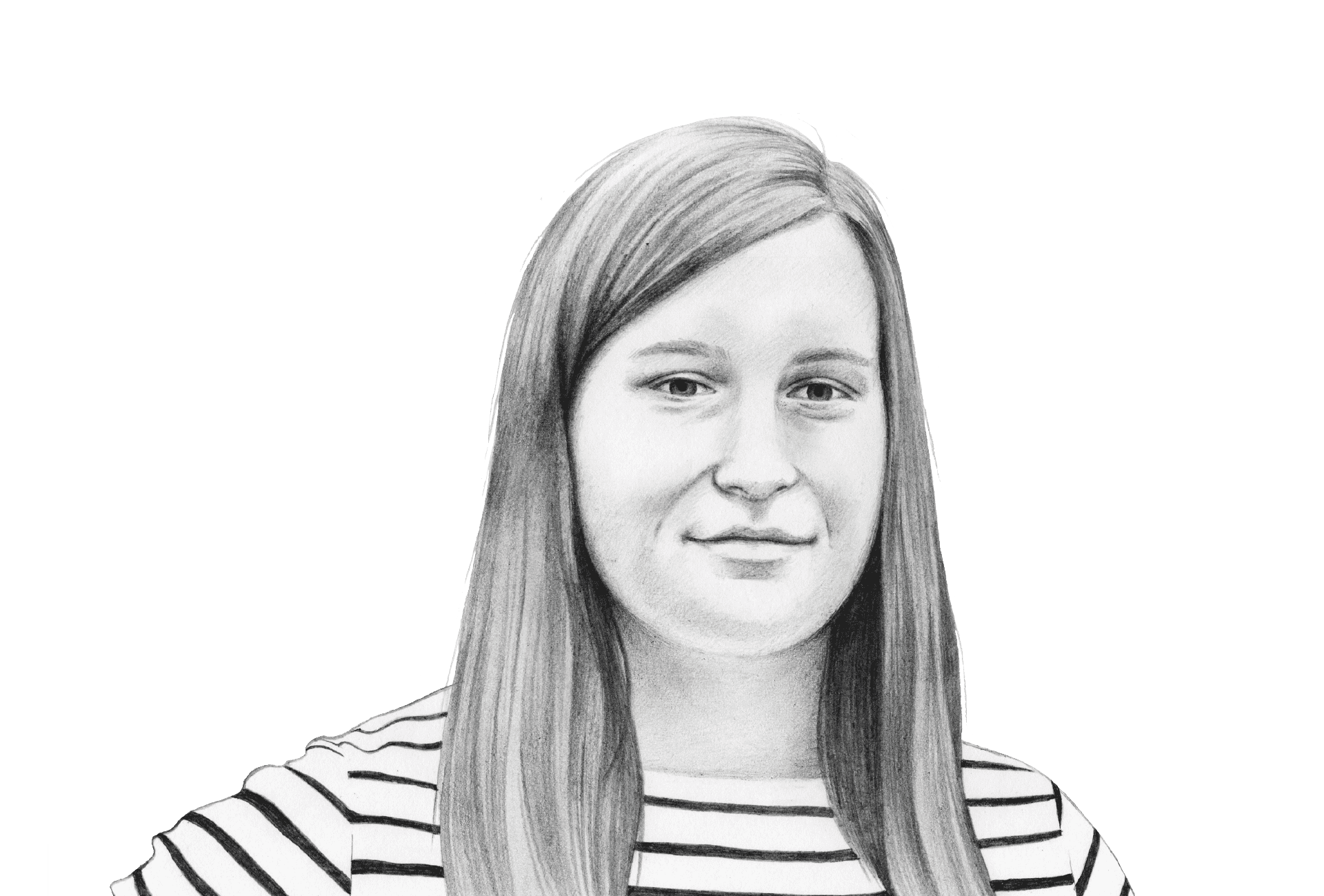
La laïcité à l’italienne
Le rapport Rousseau-Pelchat recommandait récemment une journée nationale de la laïcité pour le Québec. Mais pour célébrer quoi, exactement? La neutralité de l’État ou, comme le voudraient certains, l’effacement de la religion de la sphère publique?
Pendant ce temps, de l’autre côté de l’Atlantique, un pays semble à rebours de cette mentalité laïciste: l’Italie. Un férié aboli en 1977 a été rétabli le 4 octobre dernier, jour de la fête de saint François d’Assise.
Le parlement a pris presque à l’unanimité cette décision, qui coutera pourtant à l’État environ 10,7 millions d’euros par année. Pour mémoire, l’abolition avait eu lieu pour des raisons essentiellement économiques. Surprenante volteface.
Un autre modèle de laïcité
Cet évènement met en lumière la différence radicale entre la laïcité à la française — souvent prise pour modèle au Québec — et la laïcité à l’italienne. L’une veut écarter la religion de l’espace public; l’autre veut que chaque sphère d’influence conserve son indépendance.
Ainsi comprise, la laïcité ne sert pas qu’à protéger l’État d’une ingérence religieuse; elle protège aussi la religion d’une ingérence indue de l’État dans son domaine d’action. C’est le sens notamment de l’article 7 de la constitution italienne: «L’État et l’Église catholique sont, chacun dans son ordre, indépendants et souverains.» Cette précision empêche notamment l’État italien de prendre des décisions concernant l’Église sans son consentement.
Cet article de la constitution n’est pas sans rappeler la lettre encyclique Immortale Dei de Léon XIII: «Dieu a donc divisé le gouvernement du genre humain entre deux puissances: la puissance ecclésiastique et la puissance civile […]. Chacune d’elles en son genre est souveraine; chacune est renfermée dans des limites parfaitement déterminées et tracées en conformité de sa nature et de son but spécial.»
Une religion privilégiée
La relation entre l’État et la religion en Italie ne calque pas non plus le modèle du multiculturalisme, adopté par le Canada sous Justin Trudeau, qui voudrait mettre sur un pied d’égalité toutes les religions. Ainsi, si l’Église catholique se voit reconnaitre son indépendance et, surtout, sa souveraineté, les autres religions ont seulement la licence de pratiquer leurs cultes.
Ainsi, l’article 8 de la constitution stipule que «[…] les confessions religieuses autres que la confession catholique ont le droit de s’organiser selon leurs propres statuts, pour autant qu’ils ne s’opposent pas à l’ordre juridique italien. Leurs rapports avec l’État sont fixés par la loi sur la base d’ententes avec leurs représentants respectifs.»
Là encore, la constitution italienne s’inspire de la lettre de Léon XIII, dans laquelle il met en garde contre ceux qui placent sur le même pied toutes les religions, les rendant ainsi toutes absurdes et caduques. Un tel relativisme religieux, dénonce-t-il, mène au fond à l’athéisme.
Or, qu’un État embrasse le multiculturalisme ou le laïcisme, c’est-à-dire l’effacement de toutes les religions de la sphère publique, le principe dominant demeure le même. Comme aucune religion n’est plus vraie qu’une autre et qu’elles se contredisent les unes les autres, elles sont dès lors toutes fausses.
En offrant au catholicisme un statut privilégié, comme l’Italie le fait, l’État évite cette confusion, qui ne mène pas à la neutralité promise, mais à une vision antireligieuse et athée.
La reconnaissance de ce statut privilégié du catholicisme ne contrevient toutefois pas à la liberté de conscience de chacun. Le christianisme, lorsque fidèle à sa nature profonde, tolère les différences et ne contraint personne à se convertir. Il vaut la peine de rappeler encore les mots de Léon XIII dans Immortale Dei à ce sujet:
«Il n’y a pour personne de juste motif d’accuser l’Église d’être l’ennemie soit d’une juste tolérance, soit d’une saine et légitime liberté. En effet, si l’Église juge qu’il n’est pas permis de mettre les divers cultes sur le même pied légal que la vraie religion, elle ne condamne pas pour cela les chefs d’État qui, en vue d’un bien à atteindre, ou d’un mal à empêcher, tolèrent dans la pratique que ces divers cultes aient chacun leur place dans l’État. C’est d’ailleurs la coutume de l’Église de veiller avec le plus grand soin à ce que personne ne soit forcé d’embrasser la foi catholique contre son gré, car, ainsi que l’observe sagement saint Augustin, l’homme ne peut croire que de plein gré.»
L’exemple de saint François
L’emplacement du Vatican, en plein cœur de Rome, explique peut-être que la cohabitation entre l’Église et l’État y soit plus naturelle qu’à d’autres endroits dans le monde. Plus profondément encore, au-delà des articles de loi, l’Italie semble mieux harmoniser la foi et la culture que d’autres pays.
C’est du moins ce que tend à démontrer cette nouvelle décision de l’Italie de mettre à l’honneur François d’Assise, son saint patron national. Si presque tous les partis du parlement, même les plus hostiles à la religion, ont accueilli cette proposition, c’est parce qu’ils reconnaissent l’importance du «petit pauvre» d’Assise pour la culture de leur pays.
Saint François fait l’unanimité, tant à gauche qu’à droite, tant chez les chrétiens que chez les athées. Sa pauvreté exemplaire touche les cœurs, tout comme sa volonté de dialoguer et de faire la paix, par exemple en allant à la rencontre du sultan Al-Kâmil en Égypte, lors de la cinquième croisade. De ce fait, saint François d’Assise, et l’Italie dans son ensemble en le prenant comme saint patron, donne un exemple éloquent d’un dialogue interreligieux positif dans lequel accueillir l’autre ne signifie pas renier sa propre identité.
C’est tout de même plus inspirant qu’une fête nationale de la laïcité!