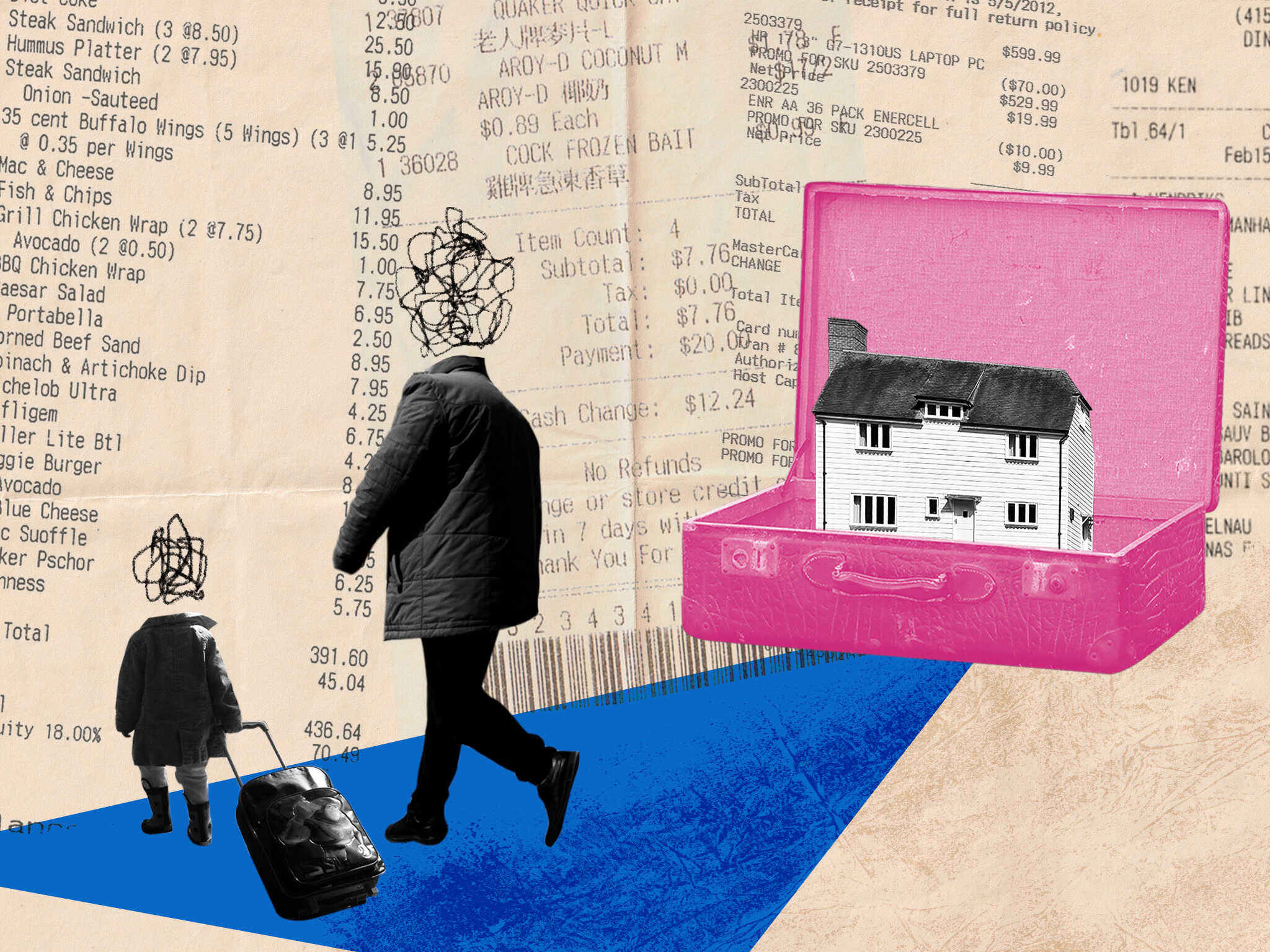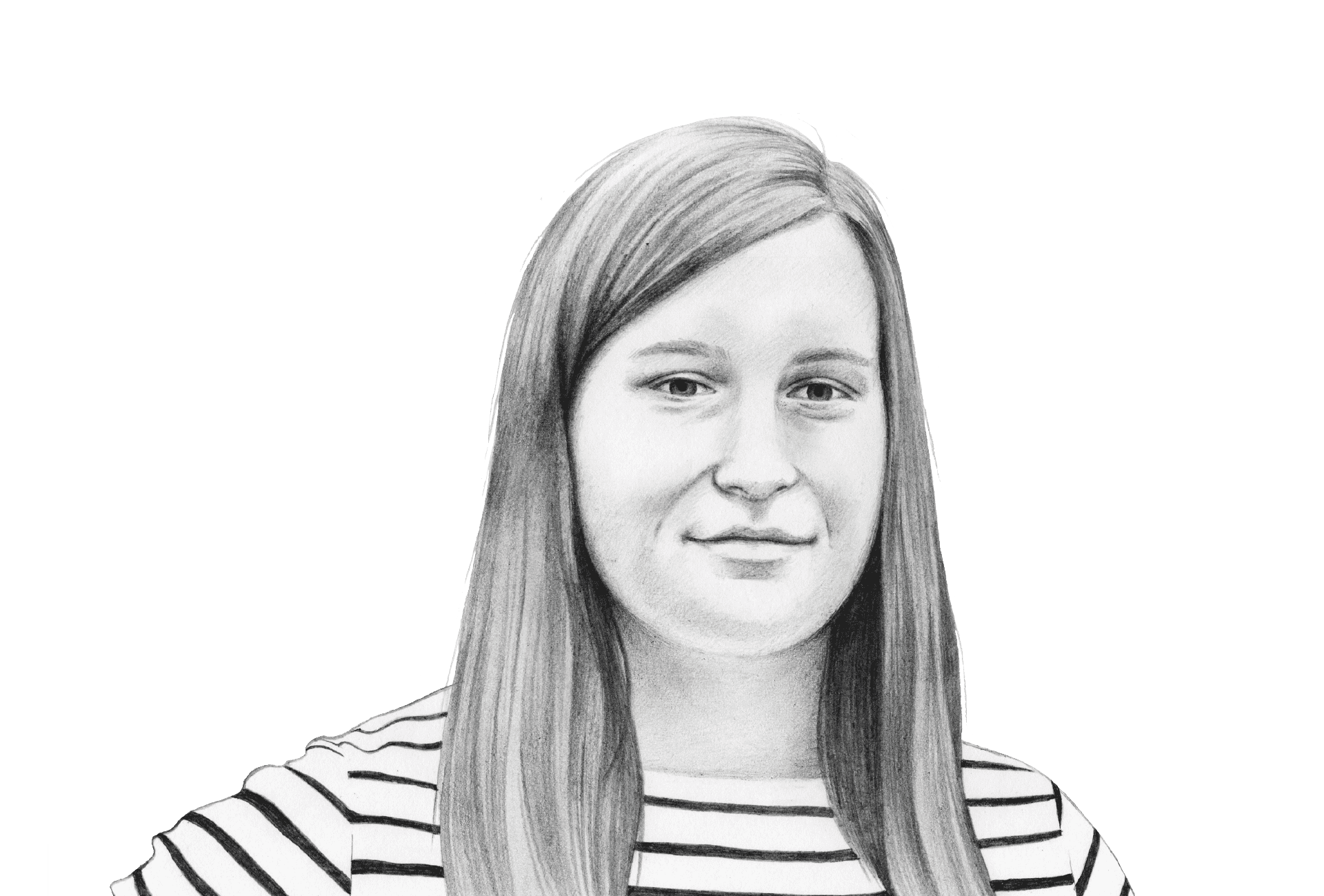
Faut-il toujours penser par soi-même?
Êtes-vous un non-player character ou un «NPC» pour les initiés? Ce concept, tiré de l’univers des jeux vidéo, est traduit en français par «personnage non-joueur». Il sert ici à illustrer le conformisme, soit cette tendance à suivre la masse ou le système sans se questionner. François Fournier s’en inspire dans son dernier livre intitulé NPC, la fabrique du conformisme. Le nom vous est peut-être familier, l’homme, qui détient par ailleurs une maitrise en philosophie, est le cocréateur du balado Ian et Frank. Examinons son livre.
L’auteur examine tour à tour les hypothèses psychologiques, sociologiques, économiques et philosophiques pour expliquer le conformisme. Il identifie notamment le besoin d’appartenance et celui de se percevoir comme vertueux ainsi que la confiance excessive dans le jugement des autres et le manque de courage.
Pour sortir du conformisme, il ne suffit pas, conclut-il, de s’opposer constamment au jugement des autres. «L’anticonformisme semble être une réponse évidente, mais il peut s’avérer un piège. Le risque de sombrer dans une mentalité adolescente, davantage marquée par un syndrome d’opposition qu’une véritable indépendance d’esprit, est considérable.»
Il termine son livre en suggérant plutôt certaines habitudes de pensée comme se laisser du temps avant de donner son avis, revenir sur ses propres idées, développer son esprit critique dès l’enfance ou douter davantage.
Cet ouvrage suscite plusieurs réflexions intéressantes, mais je demeure toutefois sceptique quant à son objectif principal. François Fournier accorde plus d’importance à la liberté qu’à la recherche de vérité et à l’esprit critique plus qu’à la docilité, au sens de «la capacité à recevoir un enseignement».
Pensée moderne
Aujourd’hui, certes, le désir de penser par soi-même semble aller de soi. Depuis l’avènement de la philosophie moderne, avec Descartes et, plus tard, Kant, on a l’habitude d’exalter la raison individuelle. En ce sens, critiquer le conformisme est aujourd’hui… le nouveau conformisme.
Il faut revenir au texte principal que cite Fournier, Qu’est-ce que les Lumières d’Emmanuel Kant, pour comprendre cet esprit moderne et la différence radicale avec la tradition ancienne, celle de l’Église notamment.
Dans ce court texte, qui veut expliquer l’esprit du siècle des Lumières et le nouveau rationalisme, Kant concède que l’homme, dans le métier qu’il exerce ou dans ses différentes fonctions propres, se doit d’obéir. Comment fonctionnerait une société si les militaires, par exemple, remettaient constamment en question les ordres? Si les citoyens refusaient de payer leurs impôts?
Kant défend toutefois une liberté totale de pensée pour chaque homme en tant que «savant». Il rejette alors toute institution ou personne qui se mettrait au-dessus de la raison individuelle.
Illusion d’indépendance
De prime abord, l’appel de Kant suscite la sympathie, surtout pour l’homme moderne habitué à cette idée qui lui parait maintenant évidente. Pourtant, cette promesse de liberté conduit souvent, de manière paradoxale, à une autre forme d’esclavage. Car la liberté totale de pensée à laquelle Kant convie est en fait une illusion.
Tocqueville, philosophe et historien du 19e siècle, le remarque quelques siècles plus tard dans son livre De la démocratie en Amérique. Il défend l’idée que tout homme doit supposer des opinions dont il n’a pas lui-même l’évidence, il doit penser «par les autres» et non seulement «par lui-même».
«Si l'homme était forcé de se prouver à lui-même toutes les vérités dont il se sert chaque jour, il n'en finirait point; il s'épuiserait en démonstrations préliminaires sans avancer; comme il n'a pas le temps, à cause du court espace de la vie, ni la faculté, à cause des bornes de son esprit, d'en agir ainsi, il en est réduit à tenir pour assurés une foule de faits et d'opinions qu'il n'a eu ni le loisir ni le pouvoir d'examiner et de vérifier par lui-même, mais que de plus habiles ont trouvés ou que la foule adopte. C'est sur ce premier fondement qu'il élève lui-même l'édifice de ses propres pensées. Ce n'est pas sa volonté qui l'amène à procéder de cette manière; la loi inflexible de sa condition l'y contraint.»
L’homme moderne, qui se conçoit comme l’égal des autres, refuse de se soumettre à un autre ou à une tradition, car il estime que personne n’est plus intelligent ou sage que lui. Mais, paradoxe s’il en est, il adhère instinctivement aux opinions de la masse.
«Dans les temps d'égalité, écrit encore Tocqueville, les hommes n'ont aucune foi les uns dans les autres, à cause de leur similitude; mais cette même similitude leur donne une confiance presque illimitée dans le jugement du public; car il ne leur paraît pas vraisemblable qu'ayant tous des lumières pareilles, la vérité ne se rencontre pas du côté du plus grand nombre.»
Ainsi, c’est un leurre de se croire indépendant d’esprit. Le mieux, sans doute, c’est d’en prendre conscience, et de reconnaître d’où viennent les influences.
Force de la tradition
Devant la complexité du réel, l’individu, la plupart du temps, se trouve bien démuni. En cela, il faut méditer l’enseignement d’Aristote qui insiste sur la précarité de l’intelligence humaine, ignorante de tout au départ et dépendante de l’enseignement des autres.
Heureusement, comme l’illustrait Bertrand de Chartres, philosophe platonicien du 12e siècle, par cette analogie maintenant célèbre: grâce à la tradition, l’individu peut s’élever comme un nain sur les épaules de géants.
L’homme moderne doit redécouvrir les traditions millénaires, dépôt de la sagesse des plus grands hommes. Ces traditions le protègent par ailleurs des modes passagères et des mouvements de la foule, comme le concède François Fournier lui-même dans un chapitre. C’est certainement mieux que de se laisser balloter au gré du courant médiatique, comme l’auteur le dénonce avec raison.
Ce contenu n'a pas été chargé automatiquement puisqu'il provient d'un fournisseur externe qui pourrait ne pas respecter vos préférences en matière de témoins.