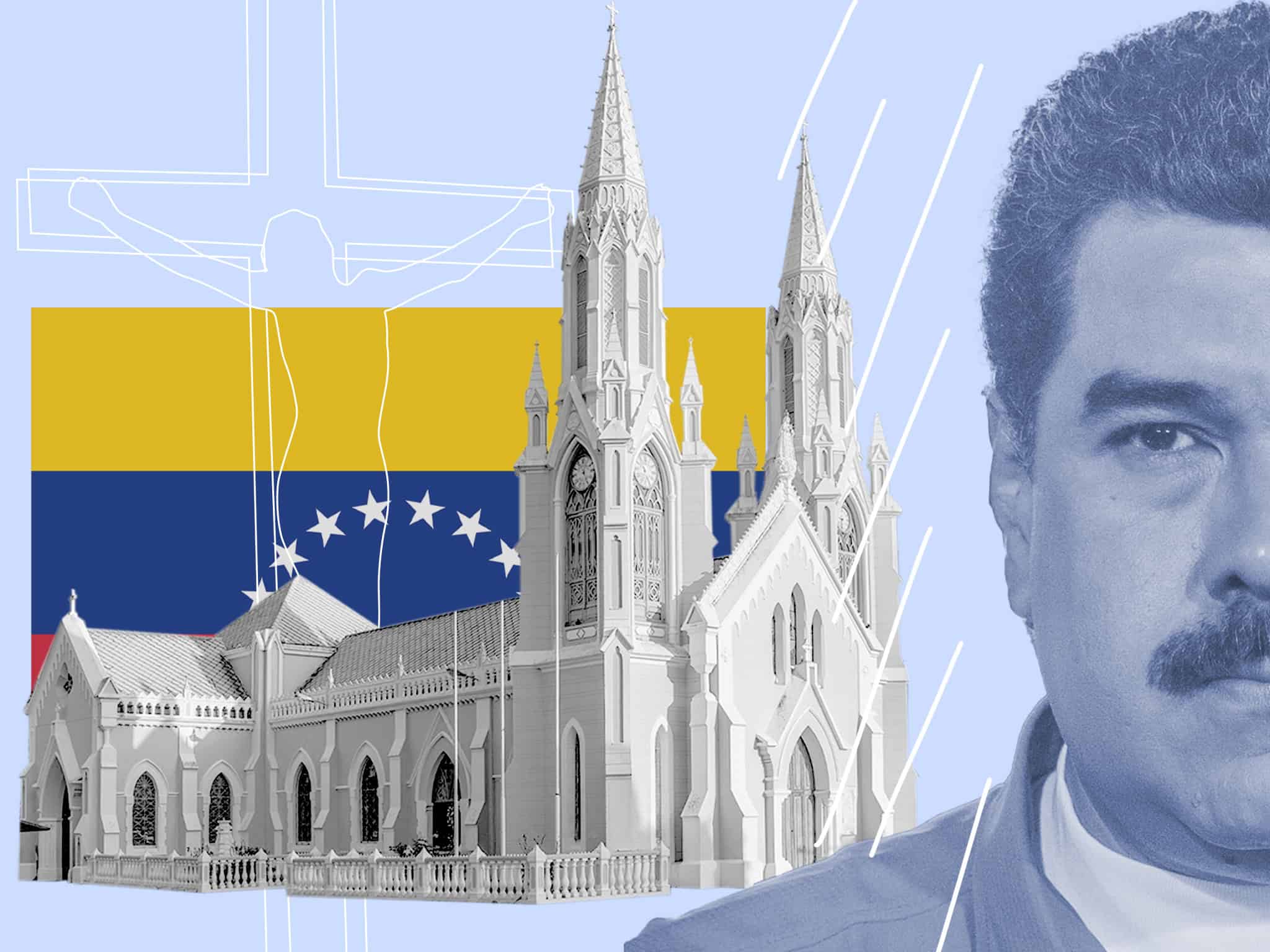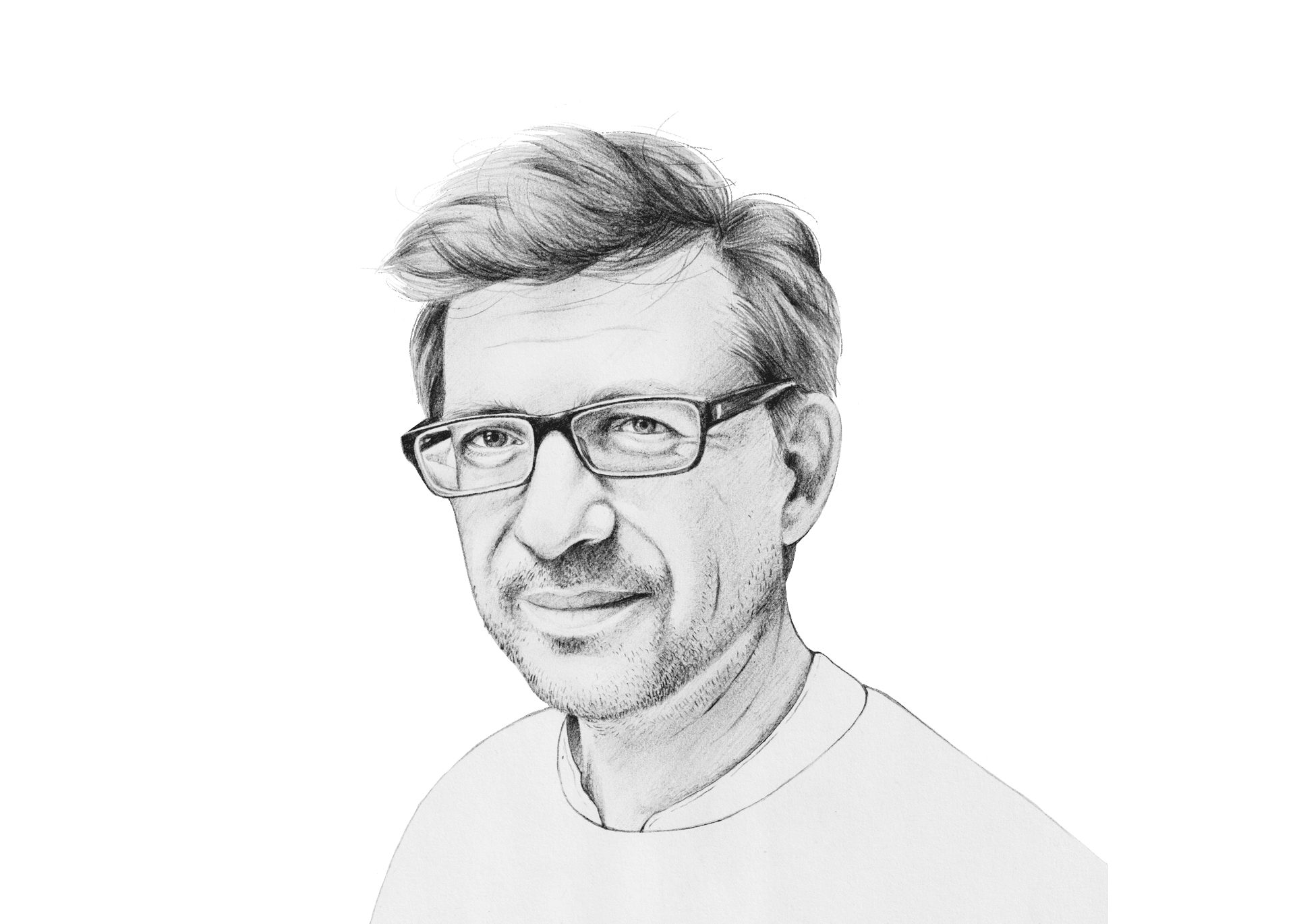
Éloge d’une intelligence artificielle
Je suis adepte de la plus haute technologie, je dirais même de la plus parfaite intelligence artificielle. J’y ai fréquemment recours. Quoique les philosophes soient critiques, sinon sceptiques à son sujet, Dieu l’a bénie par sa Révélation. Car l’intelligence artificielle date de la plus haute Antiquité. Elle se tient, décisive, au commencement de l’histoire. C’est même par elle que l’on définit les temps historiques.
Avant son apparition, ce n’est que la préhistoire avec au mieux ses dessins de vaches dans les grottes obscures. Bien sûr, la technique, le savoir-faire lui sont antérieurs: ils appartiennent à l’âge de pierre. La technologie n’advient qu’au néolithique, et elle fleurit spécialement à l’âge de saint Pierre. Sans elle, difficile à l’homme expulsé de l’Éden de concevoir le Dieu transcendant. C’est le sujet de ma thèse de doctorat (que je soutiendrai à la Sorbonne). Sitôt qu’Adam et sa femme sont chassés de la terre du paradis, leur descendance a besoin de l’intelligence artificielle, c’est-à-dire de ce que l’on pourrait appeler le para-dit du texte.
Tel est bien, en effet, le premier technologos, c’est-à-dire la première parole portée par un objet technique; telle est la première intelligence artificielle, c’est-à-dire un artéfact qui semble parler et raisonner, sans que personne soit présent pour parler et raisonner: l’écrit.
Qu’est-ce en effet qu’un écrit? Qu’avez-vous à cet instant dans les mains, sous les yeux? Ma parole sur papier, voire en pixels sur écran. Ma parole alors que je suis absent, que je dis autre chose ailleurs, que je suis mort peut-être. Ma parole via une inscription matérielle, chose inerte même pas morte (à moins que vous ne me lisiez sur parchemin tiré d’une peau d’animal ou sur papyrus tiré de la moelle d’une plante) et qui relève du minéral ou du chimique. La moindre note sur un bout de cahier est plus puissante que les tables tournantes des spirites: elle fait parler celui qui n'est pas là, qui n’y a sans doute jamais été, qui ne le sera jamais, et beaucoup mieux que par le morse d’un guéridon. Blaise Pascal, par exemple. Ou bien Cicéron. Ou bien le prophète Isaïe…
*
Que faut-il en penser? Est-ce obstacle ou viatique? Supplément ou supercherie? Sublimation ou simulacre? La critique de l’intelligence artificielle remonte au IVe siècle avant la venue de notre Seigneur. On la trouve chez Platon, à la fin du Phèdre. Socrate y rapporte l’invention de l’écriture par Thot, le dieu égyptien à tête d’ibis (que Cicéron, dans son De natura deorum, assimile au Mercure latin, donc à l’Hermès grec):
Thot vint trouver le roi Thamous pour lui montrer les arts qu’il avait inventés. […] Quand on en vint à l’écriture: «Roi, dit-il, cette science rendra les Égyptiens plus savants et facilitera l’art de se souvenir, car j’ai trouvé un remède pour soulager et la science et la mémoire.» Et le roi répondit: «Très ingénieux Thot, tel homme est capable de créer les arts, tel autre est à même de juger leur utilité ou leur nocivité. C’est ainsi que toi, père de l’écriture, tu lui attribues, par bienveillance, tout le contraire de ce qu’elle peut apporter. Car elle ne peut produire dans les âmes que l’oubli de ce qu’elles savent en leur faisant négliger la mémoire. Parce qu’ils auront foi dans l’écriture, c’est par le dehors, par des empreintes étrangères, et non plus du dedans et du fond d’eux-mêmes, que les hommes chercheront à se ressouvenir. Tu as trouvé le moyen non point d’enrichir la mémoire, mais de conserver les souvenirs qu’elle a. Tu donnes à tes disciples la présomption qu’ils ont la science, non la science elle-même. Quand ils auront beaucoup appris sans maitre, ils s’imagineront devenus très savants, et ils ne seront pour la plupart que des ignorants de commerce incommode, des savants imaginaires au lieu de vrais savants.
Platon nous apparait vraiment très contemporain, trop peut-être: ce qu’il dit de l’écriture vaut particulièrement pour le dispositif informatique. Son mythe décrit notre réalité (preuve que notre progrès ressortit aux plus vieilles lubies). Ce que nous croyons être une «augmentation» de l’homme est sa diminution, parce qu’il s’agit pour lui de déléguer ses pouvoirs à un appareil extérieur. La tromperie vient de ce que l’on emploie les mêmes mots pour désigner des choses très différentes: on parle de «mémoire», de «science» ou d’«intelligence», alors qu’il n’y va plus du tout de la mémoire comme prodigieuse faculté de recueillir en soi le monde sensible, ni de l’intelligence comme puissance contemplative, capable d’accueillir l’autre en tant qu’autre au point de nous faire perdre nos moyens (je contemple le visage de Siffreine, ma femme, dans son mystère qui fronce le sourcil, et je ne sais plus où j’en suis…).
Cette pseudo-mémoire de l’informatique, c’est de l’archivage, du stockage d’informations. Elle est sans intériorité, elle ne peut pas, à partir de la saveur d’une madeleine, vous rappeler l’atmosphère de Combray ni ressusciter votre enfance: elle étalera sous vos yeux des photographies, sans doute, ou des vidéos, mais il y a un monde entre ces clichés extérieurs et la ressaisie personnelle, profonde, du temps auquel ils renvoient. Quant à la pseudo-intelligence, c’est, à partir des informations de la pseudo-mémoire, le calcul algorithmique de la solution optimale à un problème. Là où, dans le donné du réel, l’intelligence se tourne vers un donum qu’il convient de célébrer, la pseudo-intelligence le réduit à des data qu’il faut mouliner. Là où l’intelligence s’élève du problème au mystère, la pseudo-intelligence déchoit du problème au calcul.
*
Je viens de faire allusion à Marcel Proust; autant le solliciter explicitement, le citer dans le texte, l’opposant à Platon et réévaluant par là la première des technologies. À l’évidence, Platon n’est pas l’adversaire absolu de l’écrit, puisque c’est par un écrit qu’il en opère la critique. Pour en déjouer le double piège – celui d’une pensée figée qui nous laisse passifs –, il inscrit dans son texte du jeu, de l’ironie, du paradoxe, afin de nous inciter à réfléchir à notre tour – à moins d’abandonner le dialogue. Il n’en demeure pas moins qu’il voit dans l’écriture un simulacre de la parole en sa vivante adresse, et donc, dans l’acte de lecture, un péril: on y apprend sans maitre pour nous guider, sans tutélaire présence pour vérifier que l’on a bien compris, de sorte que l’on se met à réciter ou à répéter du dehors, et on s’enfonce peu à peu dans la pire des ignorances, celle où l’on croit savoir alors qu’on ne sait pas. Qui n’a pas croisé de ces wikipédants qui nous assomment de références et de notifications sans jamais articuler une seule pensée véritable? Qui ne s’est pas heurté à ces savants dégradés en moteurs de recherche, qui procèdent par mots-clés et copier-coller?
Il y a cependant une grande différence entre un bon livre et ChatGPT. C’est pourquoi je disais que Platon était très ou trop contemporain. Sa critique semble valoir davantage pour une «intelligence artificielle générative» que pour un bon livre comme le Phèdre. Et puis, la révélation juive et chrétienne est passée par là, laquelle ne conduit certes pas à une «religion du livre», mais ne saurait exister sans livres (la Bible, si féconde qu’elle appelle d’innombrables autres livres pour dégager et diffuser ses richesses): «Ignorer les Écritures, c’est ignorer le Christ», dit saint Jérôme dans le prologue de son commentaire d’Isaïe. Le chrétien a besoin de cette intelligence artificielle. Le Christ lui-même, alors qu’il est présent, ressuscité devant ses disciples, reprend les textes de Moïse, des prophètes, des psaumes, si bien que nous devons en conclure que le Logos fait chair veut que nous passions par ce technologos d’une parole faite écrit.
Dans son Discours de la méthode, Descartes n’est pas loin de Platon quand il appelle à la méditation seul dans un poêle et critique les livres comme un des lieux où nous recevons «quantité de fausses opinions pour véritables», mais il défend tout de même «la lecture de tous les bons livres… comme une conversation avec les plus honnêtes gens des siècles passés qui en ont été les auteurs». Le texte écrit contiendrait une parole raffinée, sélectionnée ou sélectionnable, en provenance des plus habiles ou des plus sages, et c’est pourquoi j’aime mieux lire Platon que converser avec mon voisin ou même avec mon ami.
*
C’est ici que Proust intervient et marque son désaccord: lire n’est pas converser. Il l’explique dans sa préface au livre de John Ruskin, Sésame et les lys:
Ce qui diffère essentiellement entre un livre et un ami, ce n’est pas leur plus ou moins grande sagesse, mais la manière dont on communique avec eux, la lecture, au rebours de la conversation, consistant pour chacun de nous à recevoir communication d’une autre pensée, mais tout en restant seul, c’est-à-dire en continuant à jouir de la puissance intellectuelle qu’on a dans la solitude et que la conversation dissipe immédiatement, en continuant à pouvoir être inspiré, à rester en plein travail fécond de l’esprit sur lui-même.
La lecture d’un bon livre est doublement active. Dans l’acte d’en entendre le texte, d’abord: à la différence d’un enregistrement musical ou d’une vidéo, à la différence d’une conversation même, qui s’imposent à nous avec leur tempo, le livre nous laisse maitres de la vitesse de lecture. Nous pouvons nous arrêter au milieu d’une phrase, piocher au milieu des pages, relire plusieurs fois le même passage, l’incarner en lisant à voix haute. Cette maitrise du temps ouvre des intervalles pour notre propre méditation. Et c’est là le deuxième sens dans lequel la lecture est active – dans l’acte de se recueillir soi-même: «miracle fécond d’une communication au sein de la solitude», dit Proust. De fait, tout en nous ouvrant à la pensée d’un autre absent, la lecture nous renvoie à nous-mêmes et, nous interdisant d’en rester aux conclusions de l’auteur, nous donne à penser:
… c’est là, en effet, un des grands et merveilleux caractères des beaux livres (et qui nous fera comprendre le rôle à la fois essentiel et limité que la lecture peut jouer dans notre vie spirituelle) que pour l’auteur ils pourraient s’appeler «Conclusions» et pour le lecteur «Incitations». Nous sentons très bien que notre sagesse commence où celle de l’auteur finit, et nous voudrions qu’il nous donnât des réponses, quand tout ce qu’il peut faire est de nous donner des désirs. Et ces désirs, il ne peut les éveiller en nous qu’en nous faisant contempler la beauté suprême à laquelle le dernier effort de son art lui a permis d’atteindre. Mais par une loi singulière et d’ailleurs providentielle de l’optique des esprits (loi qui signifie peut-être que nous ne pouvons recevoir la vérité de personne, et que nous devons la créer nous-mêmes), ce qui est le terme de leur sagesse ne nous apparait que comme le commencement de la nôtre, de sorte que c’est au moment où ils nous ont dit tout ce qu’ils pouvaient nous dire qu’ils font naitre en nous le sentiment qu’ils ne nous ont encore rien dit.
«Loi singulière et d’ailleurs providentielle», dit l’auteur d’À la recherche du temps perdu, «nous ne pouvons recevoir la vérité de personne», «nous devons la recréer en nous-même» (idée qui rejoint la maïeutique de Socrate, mais qui se rapporte ici à l’acte de lire). Tel serait l’enseignement de la première intelligence artificielle, à l’opposé de la dernière. L’intelligence artificielle du «beau livre» sollicite notre intelligence, tandis que celle du «transformateur génératif préentrainé» a pour but de nous en décharger. Le génératif, en cela, est plutôt dégénérescent.
Cela ne m’empêche pas de trouver aussi une certaine providence aux GPT. Disant cela, je ne songe pas à l’ingénieux projet de créer un chatbot dont la base de données serait exclusivement alimentée par des textes des Pères cappadociens (Basile de Césarée, Grégoire de Nysse et compagnie) afin que nos dilemmes moraux soient éclairés par la sagesse du IVe siècle après la venue de notre Seigneur, sans parler des textiles intelligents dont les capteurs de transpiration et de rythme cardiaque pourraient saisir avec 94% de fiabilité que nous sommes en train d’entrer en tentation, et envoyer aussitôt des paroles d’exhortations sur notre smartwatch… Non, je songe au fait que tout ce que nous demandons de faire à un GPT, c’est tout ce que nous ne voulons pas faire nous-mêmes.
Mais pourquoi ne le voulons-nous pas? Parce que cela ne nous apparait pas comme une question de vie ou de mort, qui impliquerait notre chair et notre esprit. En un mot, parce que cela ne relève pas d’une sagesse incarnée. Quand nous sommes amoureux, nous n’envoyons pas un robot à notre place. Quand nous sentons que toute notre personne s’engage dans une parole à donner, nous ne la laissons pas être simulée par une machine.
*
Vraiment, je n’ai rien contre l’intelligence artificielle. Je le prouve par ce texte. J’observe seulement qu’elle a atteint son point culminant au Moyen Âge et que, depuis, elle a eu tendance à régresser.