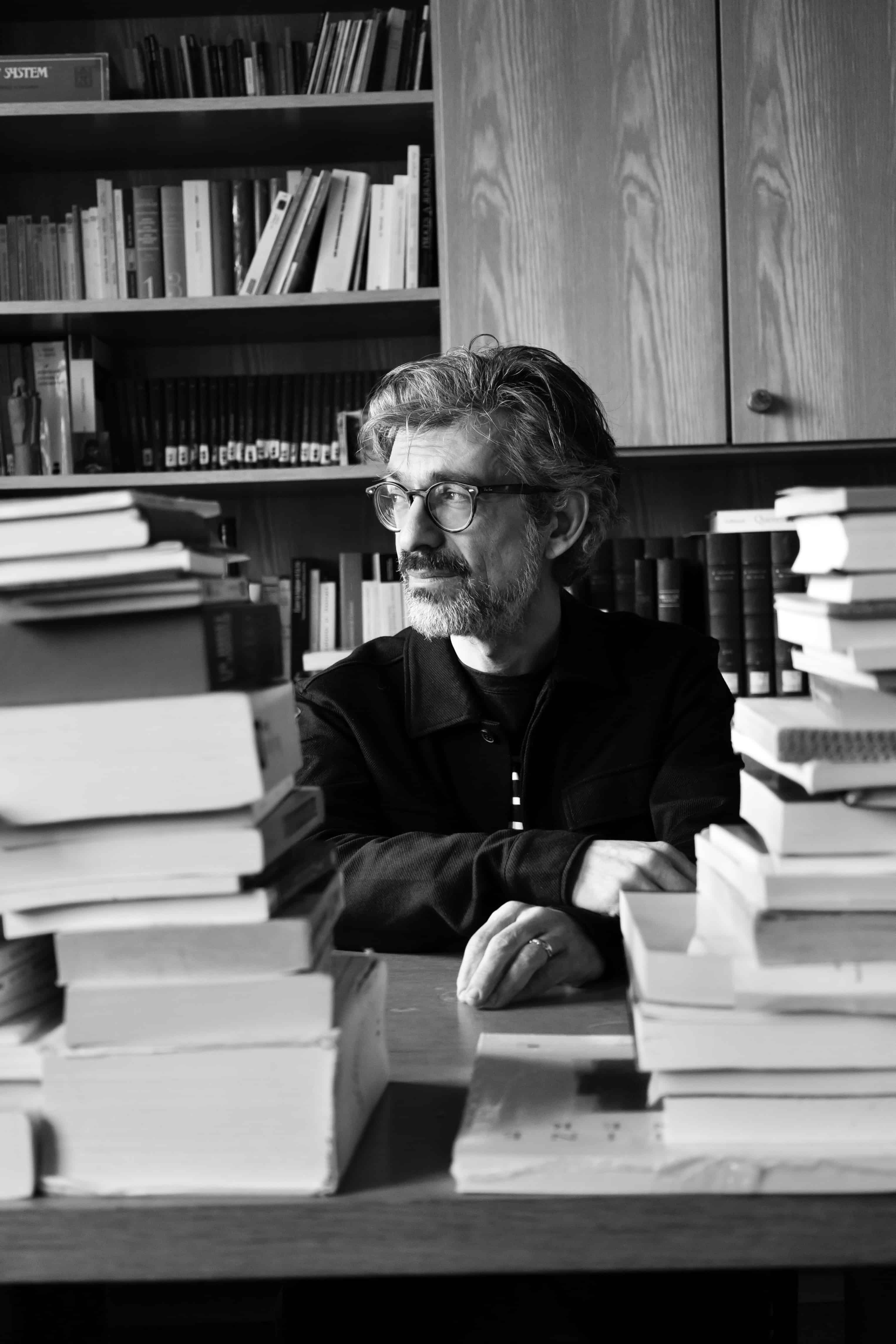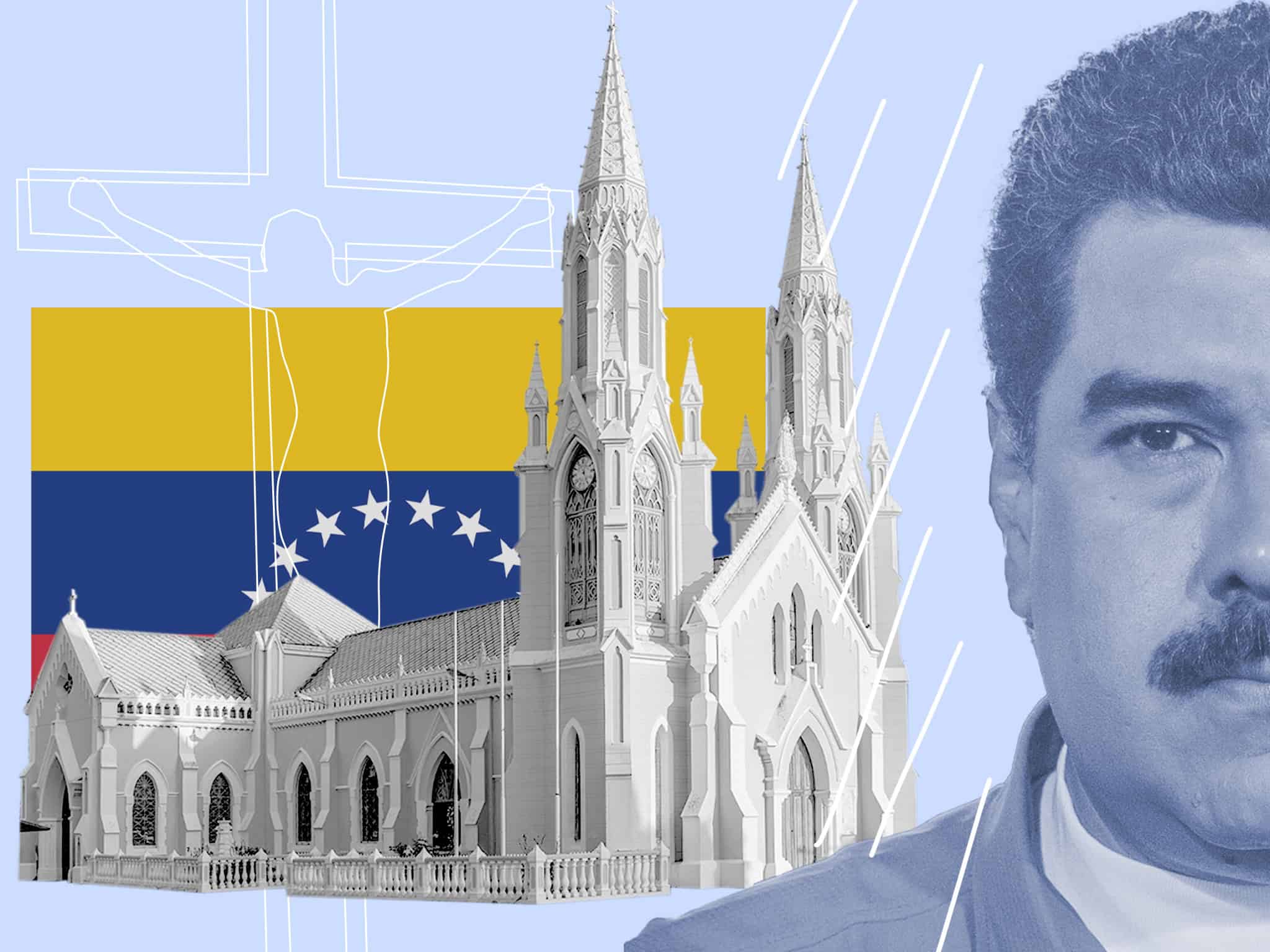Body count
À partir de combien commence-t-on à compter? Zéro, déclarent les mathématiques. — Cinq ou six, répond la réalité. Avant cela, nous voyons le nombre sans avoir à dénombrer. Le dé en donne l’évidence. Certes, l’homogénéité des points et leur disposition facilitent cette perception directe. Avec des enfants, c’est assez différent. Je ne sais plus à partir duquel nous nous sommes mis, ma femme et moi, à compter notre progéniture pour vérifier que nous n’en avions pas égaré un en route (Jacob, sans doute, c’est-à-dire cinq).
Ce passage des noms au nombre a son utilité dans l’organisation pratique. Toutefois, dire à quelqu’un: «Tu comptes beaucoup pour moi», c’est précisément lui affirmer que nous ne le réduisons pas à une unité dans une somme. Il compte pour nous, nous n’avons donc pas à compter. Dès qu’il y a body count, c’est qu’il y a mort d’homme – et une mort au second degré, une mort éteinte, telle qu’elle ne nous atteint pas.
La notion de body count s’est forgée avec le décompte des corps, à la suite d’une catastrophe. Elle correspond au bilan chiffré des victimes. Celui qui s’y livre a gardé assez de sang-froid pour procéder à un tel calcul. Il n’a pas rencontré, dans le tas, un seul visage dont la disparition le bouleverserait au point de lui faire perdre la tête. Il enjambe les cadavres muni d’un carnet, et son crayon regroupe les corps par sizaines – petits carrés barrés d’une diagonale.
On se souvient du mot attribué à Staline: «Un mort, c’est une tragédie; un million de morts, c’est une statistique.» Point de cynisme, ici. Staline énonce un fait. Günther Anders remarque de même: plus grande est la menace qui pèse sur l’humanité, plus nous devenons des «analphabètes de l’angoisse». Nous parle-t-on d’une «ville détruite» que nous ne parvenons à nous représenter qu’«un vague tableau fait de fumée, de sang et de ruines», et c’est déjà beaucoup en comparaison de «l’infime quantité de sentiments ou de responsabilité que nous sommes capables de ressentir en y pensant». La destruction d’une cité ne nous est sensible que si l’on y distingue la mort d’un ami.
La notion a depuis peu subi un léger déplacement. Ce n’est plus un bilan, c’est un score. Il renvoie, parmi la jeune génération, au cumul des «partenaires sexuels». Le Don Giovanni de Mozart fait de nouveau entendre son «Air du catalogue»: «En Italie, six-cent-quarante. En Allemagne, deux-cent-trente-et-une. Cent en France. En Turquie, quatre-vingt-onze. Mais, en Espagne, déjà mille et trois!»
Dom Juan opère encore un classement selon les pays. Preuve, toutefois, que ses conquêtes sont moins charnelles que territoriales ou militaires. Moins que des trophées de chasse, qui du moins montrent encore une gueule empaillée, les corps y font masse. La femme y est quelque chose et non quelqu’un. Aucune ne se détache comme cette épouse qui échappe au recensement et n’est plus une partie du monde, mais celle à travers qui le monde est donné.
Peut-il y avoir un soul count? Des théologiens ont spéculé sur le nombre des élus – grand selon certains, petit selon d’autres. Je crois que, pour un Dieu dont les trois personnes font encore l’unique, les grands nombres s’effacent devant les noms propres. Ne demeure que cette question: «Pour toi, qui suis-je?»