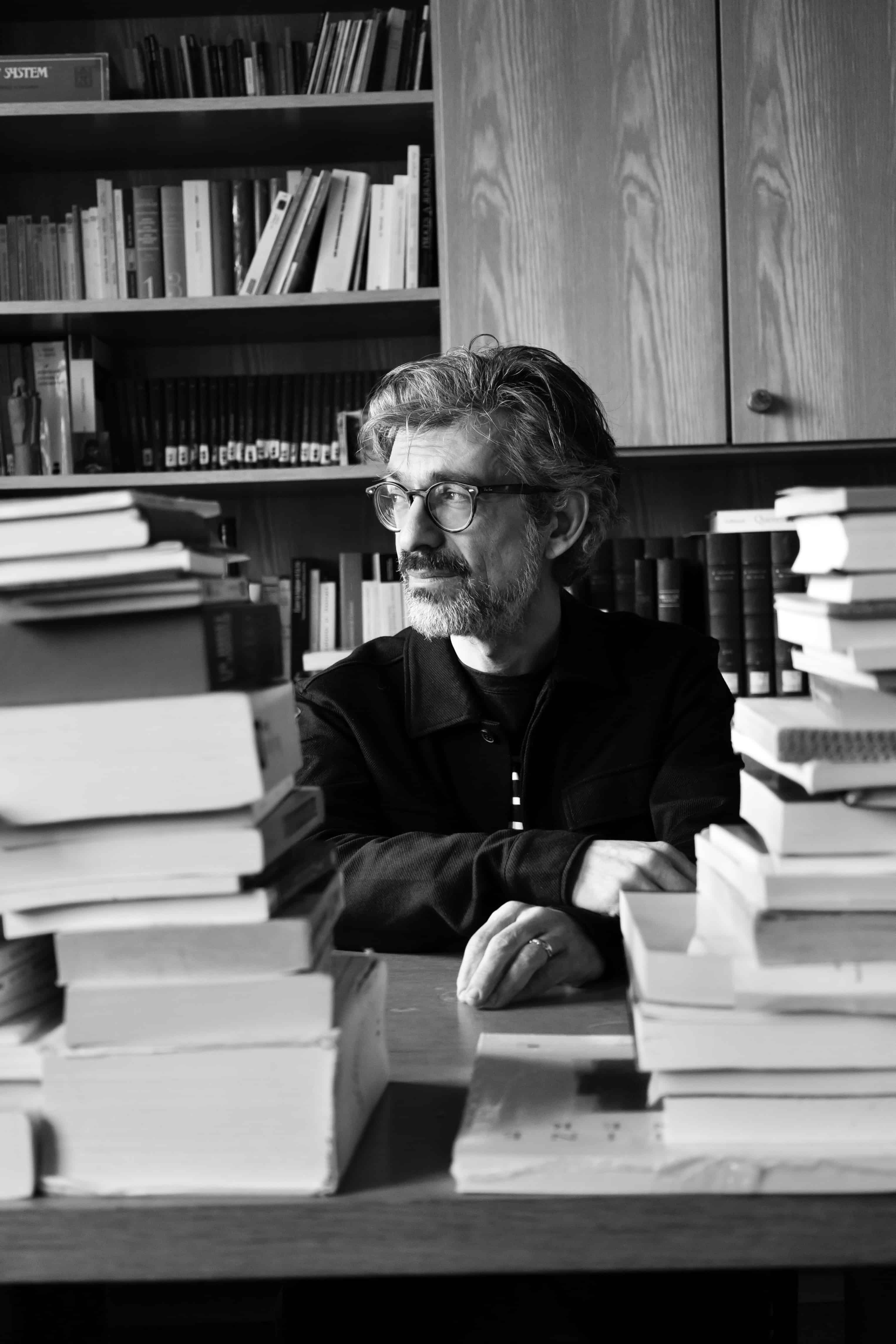Bitcoin
Je l’avoue, ce mot me choque. Sans doute est-ce à cause de sa première partie: bit. Je n’aime pas qu’on dise «bit». Bit est plus et même moins que vulgaire. Bit vient de l’informatique. Son homophonie pourrait le rendre convenable: la bitte renvoie soit au terme d’argot qui désigne l’organe sexuel masculin, soit au terme de marine qui se rapporte au billot de fonte autour duquel sont enroulées les amarres.
Mais le bit… Ça ne se rapporte même pas au comestible «morceau» anglais («Give the duck a bit of bread», comme le dit poétiquement mon Oxford Dictionary), mais à la contraction de «binary digit». Cette brièveté ne l’empêche pas d’être un gros mot. Nul ne l’a jamais prononcé de tout le 17e siècle, au temps des belles conversations. Comment, dès lors, quand vous lui ajoutez «coin» pour sa gloire, ma délicate oreille n’en serait-elle pas choquée?
Le bitcoin est issu de l’accouplement du numéraire et du numérique. Il y avait d’un côté la monnaie, de l’autre l’ordinateur. Ces deux-là étaient faits pour se rencontrer. L’un et l’autre ont pour principe de convertir les choses en quantités calculables. À la place de la demande très difficile et trop personnelle: «Pour vous, qui suis-je?» vous avez cette question tout à fait traitable: «Jésus, c’est combien?» Et la réponse ne se fait pas attendre: «Trente deniers», si l’on s’en tient à la valeur monétaire, «74 101 115 117 115», si l’on s’attache à la valeur informatique.
Bien sûr, la monnaie a d’autres usages: elle ne sert pas toujours à vendre le messie. Ce n’en est pas moins une question de foi. La monnaie est fiduciaire, essentiellement. Voilà pourquoi la monnaie ne s’épanouit pleinement que dans le papier – ou ce que l’on appelle les «écritures de banque». Il s’agit d’une reconnaissance de dettes signée par un organisme financier.
Vous y croyez, vous faites confiance à sa promesse de réalisation. Une jeune femme au sourire un peu figé, dans un magasin, voit votre bout de papier ou l’accord électronique sur son appareil à cartes, et soudain, en échange, elle vous cède ce blouson aviateur doublé de mouton dont vous aviez très envie. Après les accords de Bretton Woods et la fin de l’étalon-or, les États-Unis ont compensé la perte de fiabilité de leur monnaie en inscrivant sur leurs billets «In God We Trust».
Mais si l’inflation devient énorme? Si l’on ne croit plus à la garantie des États ni à leur politique abusant de la planche à billets? On change de croyance. La garantie ne vient plus d’une autorité humaine, avec sa capricieuse liberté, mais de la cryptographie numérique. Et voilà le refuge de la spéculation individuelle et de la foi numérico-numéraire. Voilà le Bit-Mammon dont on croit se servir à sa guise et que l’on sert aveuglément.
Le bitcoin valait moins d’un cent à son apparition. Il vaut au moment d’écrire ces lignes 146 426,55 dollars canadiens ou 86 072,36 francs suisses. Que se passera-t-il lorsque les serveurs informatiques tomberont en panne? Pourra-t-on jeter des bitcoins dans le chapeau d’un pauvre? Ne leur préfèrera-t-on pas le «bit of bread» que l’on donne au canard?