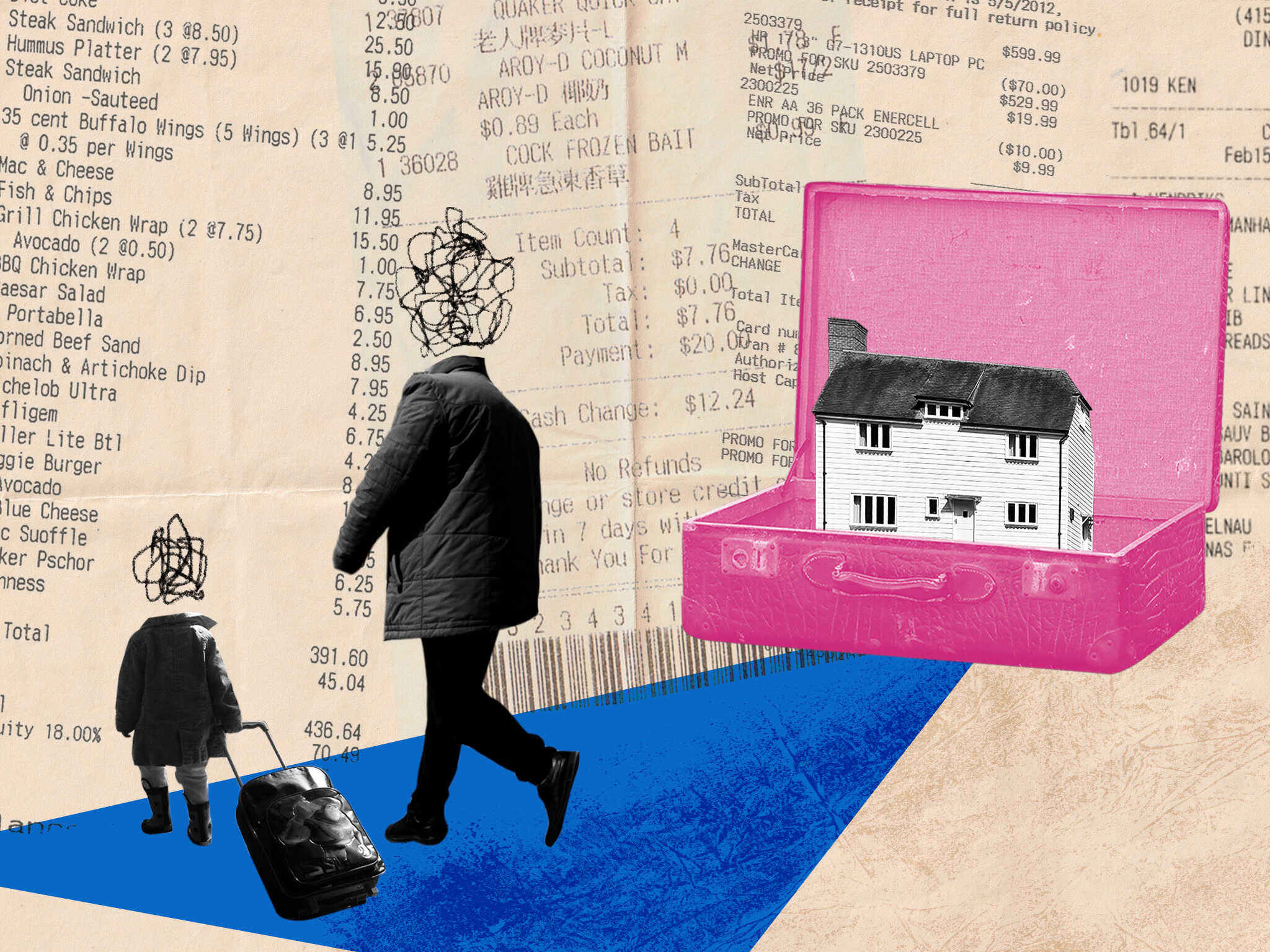Charles De Koninck, constitution et laïcité: rencontre avec Guillaume Rousseau
Il y a tout juste deux semaines qu’avait lieu à l’Université Laval un grand colloque sur la pensée politique de Charles De Koninck, monstre sacré de la philosophie chrétienne au 20e siècle, dont l’héritage dépasse largement les murs du pavillon du même nom. Moins d’une semaine plus tard, le gouvernement du Québec déposait son projet de constitution. Qu’ont en commun ces évènements? Ils portent tous deux la marque de Guillaume Rousseau, professeur de droit à l’Université de Sherbrooke et éminence grise de l’actuel gouvernement. Il a bien voulu nous rencontrer pour parler Charles De Koninck, constitution et laïcité.
Dans son allocution d’ouverture au colloque Bien commun et fédéralisme chez Charles De Koninck, le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette affirmait que le Québec entre en ce moment dans une «nouvelle ère constitutionnelle». Vaste programme. À quelques jours de son dépôt, c’est dire l’importance historique que le gouvernement accorde à son plus récent projet de loi.
Or, l’adoption pour le Québec d’une constitution codifiée est la toute première recommandation du Comité consultatif sur les enjeux constitutionnels du Québec au sein de la fédération canadienne, coprésidé par Guillaume Rousseau et dont le rapport a été rendu public en 2024. Un an plus tard, la réflexion semble vouloir se transformer en action, ce qui réjouit l’influent penseur œuvrant activement à l’arrière-plan du paysage politique.
«Une constitution, ce sont des principes, des règles qui vont régir l’exercice et la limitation du pouvoir», explique-t-il. Le fait de les enchâsser dans un document officiel constitue pour Guillaume Rousseau un «[…] geste d’affirmation significatif. […] Concrètement, pour les citoyens, si cette constitution est adoptée et qu’elle perdure, ça peut devenir un symbole d’identité.»
Le spectre du «Grand État»
Cette démarche s’inscrit dans la lignée d’une vision autonomiste et décentralisatrice de la fédération que Charles De Koninck exposait déjà dans un mémoire présenté à la Commission royale d’enquête sur les problèmes constitutionnels (mieux connue sous le nom de Commission Tremblay) en… 1954. Le titre du texte, La confédération, rempart contre le Grand État, donne le ton et laisse deviner l’intention de l’auteur: offrir une troisième voie entre centralisation excessive et dislocation du pouvoir.
Cette filiation est pleinement assumée par Rousseau, qui en fait l’objet de son intervention au colloque d’octobre. «Charles De Koninck, me dit-il, prônait l’autonomie des provinces, et il s’opposait à l’idée d’un État fédéral tentaculaire, en réaction aux ingérences fédérales qui avaient déjà commencé à l’époque de l’après-guerre.»
En effet, De Koninck reconnaissait que «l’Acte de l’Amérique du Nord britannique évite sans nul doute le nivellement contre nature qu’entraîne inéluctablement le Grand État centralisé» — grâce, surtout, aux dispositions en matière d’éducation, de langue et de droit civil (Charles De Koninck, 1954). Mais une grande vigilance doit pour lui être observée afin que les instances fédérales ne trahissent pas l’esprit des «Pères de la Confédération».
Les propos de Charles De Koninck trouvent leur résonance dans les idées avancées dans le rapport Proulx-Rousseau de 2024 sur plusieurs points, nous dit le professeur de droit. «Il y a l’idée du Québec comme État-nation, et non simplement comme gestionnaire de services publics. Ensuite, le fait que les Québécois doivent d’abord s’investir dans l’État québécois. C’est là que leur loyauté première doit aller. De Koninck dit carrément que c’est l’amour de la patrie qui doit venir en premier, avant l’amour des autres patries. Je vois un rapprochement avec mon rapport, parce qu’on dit que l’avenir des Québécois passe d’abord par l’État québécois, avant le fédéral.»
Un enjeu existentiel
Ce n’est pas d’hier que l’idée de constitution fait son chemin dans notre classe dirigeante. Il s’agit d’un enjeu particulièrement problématique pour le Québec, exacerbé par l’épisode du rapatriement de la constitution canadienne en 1982. Pour Guillaume Rousseau, la province peut néanmoins arriver à tirer son épingle du jeu au sein du système fédéral. «Il y a des moyens pour le Québec de mieux protéger son autonomie, de mieux travailler à la faire accroitre.»
Parmi ces moyens, il y a l’adoption, en plus d’une constitution, d’une «loi sur la défense et l’accroissement de la liberté constitutionnelle du Québec» et la création d’un conseil constitutionnel. Les deux propositions se trouvent actualisées dans le projet de loi que le ministre Jolin-Barrette a présenté.
«Dès qu’il y a un début d’initiative fédérale qui est une ingérence, il faut tout de suite que le Québec se saisisse de la question, et, au besoin, qu’il aille chercher un avis du conseil constitutionnel. Si on pense que l’intervention fédérale empiète sur la liberté constitutionnelle du Québec et est nuisible, il pourrait y avoir rapidement un mécanisme qui fait en sorte que tous les organismes québécois refusent de collaborer avec le fédéral. […] Il s’agit de faire en sorte que chaque fois qu’on élabore une loi québécoise, on peut se demander s’il y a moyen d’aller dans une zone grise de la constitution, d’occuper un espace qui n’est pas occupé par le fédéral.»
Un État laïc
Dans son projet de loi, le gouvernement prévoit de modifier la Charte des droits et libertés de la personne afin que le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes ait préséance sur la liberté de religion. Des changements significatifs sont aussi prévus à la Loi constitutionnelle de 1867, dont un qui vise à affirmer la laïcité de l’État comme caractéristique fondamentale du Québec. Il s’agit là d’une des recommandations centrales d’un autre rapport piloté par Guillaume Rousseau, celui du Comité d’étude sur le respect des principes de la Loi sur la laïcité de l’État et sur les influences religieuses.
Le fait que le Québec soit un État laïc le caractérise en effet selon lui de manière toute particulière. Il reprend à son compte les propos de Benoît Pelletier, ancien député libéral et célèbre penseur de la question constitutionnelle, en expliquant que «[…] ce qui différenciait le Québec, à une certaine époque, c’était la religion catholique, mais maintenant, c’est le rapport au religieux » qui se manifeste dans l’importance accordée à la laïcité. « Je pense qu’on peut faire un lien entre cet attachement plus fort à la laïcité au Québec que dans d’autres provinces et le fait que, jadis, l’Église catholique était très influente ici.»
Mais pour Guillaume Rousseau, il faut rester «modeste» dans le rôle qu’on donne à cette spécificité. «La laïcité, ce n’est probablement pas suffisant pour créer une nation». Le lien avec l’identité québécoise est pour lui indéniable, mais «[…] la séparation de l’État et de la religion ne fait pas nécessairement en sorte qu’il y ait un projet collectif, des valeurs communes. Oui, on peut avoir une vision large et ambitieuse de la laïcité, penser que c’est pour l’émancipation individuelle, par exemple. Mais, en fin de compte, ça prend quand même une culture, une langue, et d’autres éléments du genre.»
*
Le mercredi 1er octobre au soir, après l’intervention de Simon Jolin-Barrette, c’est Adrian Vermeule, célèbre professeur de droit harvardien associé à l’intégralisme catholique, qui faisait la tête d’affiche dans un vaste spectacle hommage au très thomiste Charles De Koninck. Sur le parterre, on retrouve Guillaume Rousseau et bien d’autres, du laïcard type au religieux portant l’habit. À quelques jours de l’annonce d’un projet de loi constitutionnelle visant notamment à renforcer la laïcité de l’État québécois, à canoniser juridiquement le droit à l’avortement et à constitutionnaliser le droit à l’euthanasie, on croit bien assister, comme l’a dit Simon Jolin-Barrette, au début d’une «nouvelle ère».
Mais laquelle?