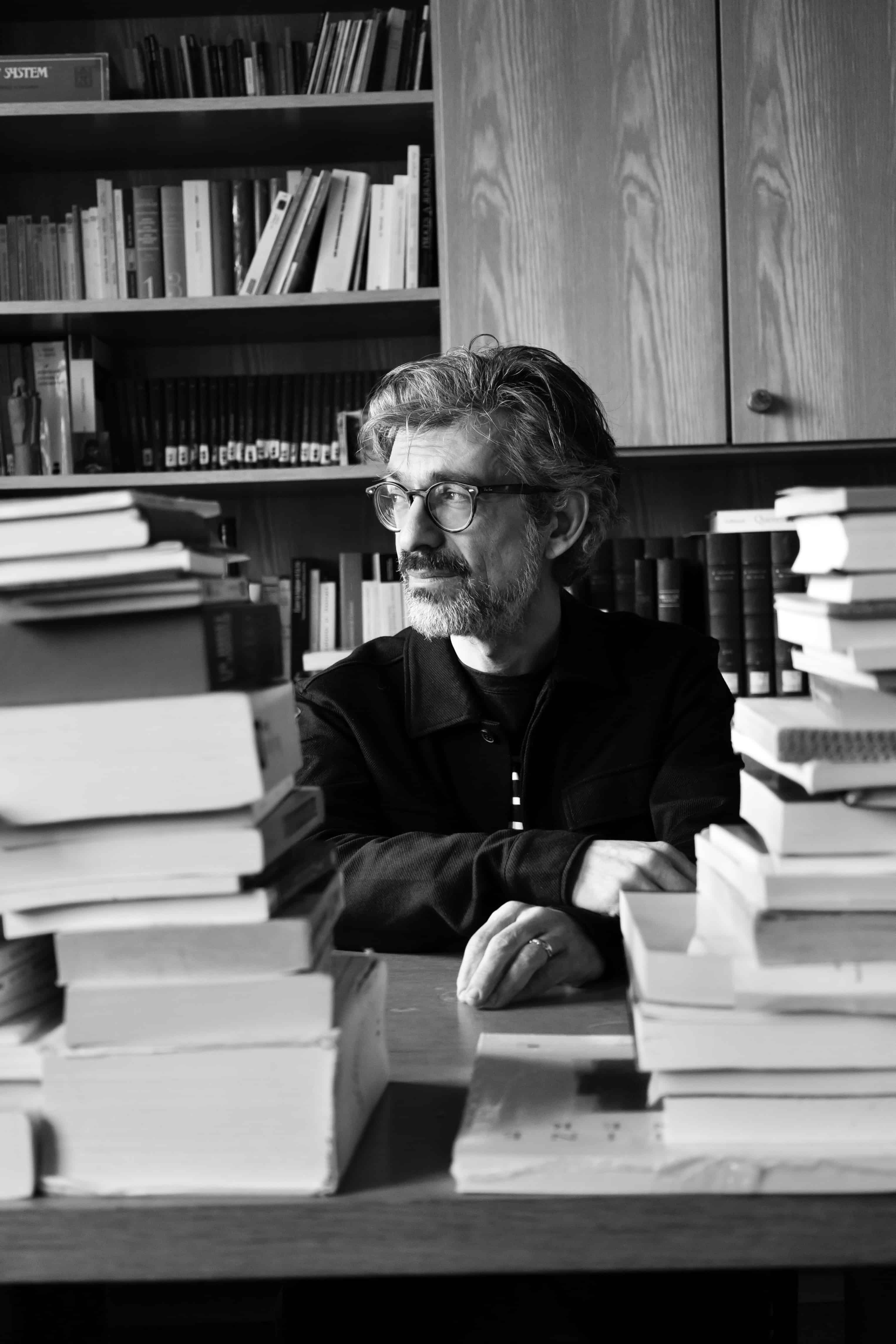L'anniversaire, ou quand le bonheur des uns fait le malheur des autres
Une fête d’anniversaire peut être quelque chose de sinistre. Surtout si vous résidez dans la maison de retraite de Malmköping et que vous avez 100 ans. On a organisé une réception en votre honneur. L’adjoint au maire sera là. Et même le journal local. Votre photo en page 13 vous offrira une forme démocratique de la momification des pharaons. On peut comprendre, en ces circonstances, que vous préfériez passer par la fenêtre et disparaitre sans laisser d’adresse: courir l’aventure, la dernière, sans doute, poursuivi par des membres du gang Never Again plutôt que d’être célébré comme un bronchiosaure dont on vient de déterrer les os. C’est ce que raconte Jonas Jonasson dans son roman Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire.
Bien sûr, quand il s’agit d’un enfant et de ses petits camarades, les choses sont assez différentes. Leur naïveté est telle que la joie ne manque pas de s’inviter sous les ballons à 10 centimes la pièce. Il y a chez eux cet appétit de vivre qui nous émerveille et qui cependant, déjà, nous déchire de nostalgie et plus encore d’angoisse. Que deviendront ces frimousses réjouies dans trente, quarante années, après qu’elles auront croisé le mensonge, l’impureté, la violence et la mort? Leurs fronts creusés de rides, leurs yeux alourdis par les cernes pourront-ils encore s’écarquiller devant les fraises Tagada?
Dès à présent, sitôt que les parents sont venus rechercher leurs petits princes, sitôt que vous vous retrouvez seul face aux restes d’emballages, aux détritus de cotillons, aux paquets éventrés de chips industrielles et aux cadavres de sodas en polyéthylène téréphtalate, sitôt que vous contemplez les reliefs de ce que vous achetâtes en vitesse à l’hypermarché de la zone commerciale Saint-Jean (car les saints donnent encore leur nom à des zones commerciales), vous vous interrogez sérieusement. La fête de votre fils ne fut-elle pas un culte à la consommation? Tous ces articles de bazar, pourtant achetés au rayon «célébration durable», tous compostables, tous déjà recyclés, ne sont-ils pas avant tout propres à vous divertir du vertige d’être là, sans y rien comprendre?
Vous essayez de vous consoler avec des travaux sociologiques. L’anniversaire de votre enfant aura du moins servi à sa «première socialisation»: inviter des camarades de classe, choisir ceux qui viendront et ceux qui seront exclus, se demander si ce que l’on préfère, c’est Mathis ou le déguisement de Naruto qu’il a offert… Voilà qui éduque et prépare aux hauts emplois… L’interrogation n’en devient que plus pressante. Pourquoi fêter la naissance d’un mortel? Et même s’il est énarque et devient ministre de l’Intégration sociale, ne conviendrait-il pas mieux de pleurer?
Conditions matérielles et morales
Comme le note l’anthropologue Jean-Claude Schmitt: «La manière quasi spontanée dont nous pensons à célébrer notre anniversaire et celui de nos proches nous fait oublier la complexité des conditions intellectuelles requises par une telle opération.»
De fait, il faut d’abord connaitre sa date de naissance. Le nouveau-né n’étant pas à ce moment-là en état de lire un calendrier ni de s’en souvenir, il doit s’en remettre à la mémoire d’autrui – ses parents, un acte écrit, un enregistrement officiel. Or, ses parents ont bien d’autres choses à faire: la mère doit allaiter et se remettre de son accouchement, le père ne peut délaisser les champs ou la forge – en quoi marquer d’une pierre blanche cette date aurait-il plus d’importance que les soins immédiats de la vie? Quant à l’État civil, il n’existe que depuis la Révolution française. Certains y sont nés un 21 fructidor de l’an II – ce qui montre aussi la nécessité d’un comput stable et commun.
Par commodité, sans doute, plus que par dévotion, l’État français est revenu au calendrier grégorien, déjà assez moderne. Il fut proclamé par le pape Grégoire XIII dans la bulle Inter gravissimas du 24 février 1582, date de naissance du calendrier lui-même. Pour simplifier les choses, on décida sa non-rétroactivité: toutes les dates qui précèdent resteront celles du calendrier julien. Quand un historien dit que saint Louis est né le 25 avril, ce n’est pas notre 25 avril cosmique, mais quelque chose comme le 2 mai. Célébrer le jour de sa naissance suppose donc toute une organisation sociale du temps, une mesure commune de l’année, et même un calcul relatif à la naissance d’autre chose, que l’on considère comme l’évènement de référence qui ordonne tous les autres: la fondation de Rome, la proclamation de la République, la Création, la naissance de Jésus à Bethléem…
S’agissant de saint Louis, nous savons le jour, non l’année: est-ce 1214 ou 1215? Joinville dit que le roi est né «le jour de la Saint-Marc», ce qui prouve que les fêtes des saints avaient plus de valeur que l’anniversaire des rois. À dire vrai, du 5e au 15e siècle, dans la chrétienté, on ne fête pas les anniversaires de naissance, hormis la Nativité de Jésus, puis celles de Jean-Baptiste et de Marie. C’est que, dans la Bible, ceux qui célèbrent leur anniversaire n’ont rien de très exemplaire. Ce sont Pharaon (Gn 40,20) et Hérode Antipas (Mt 14,6). La comparaison est gênante: la célébration de sa naissance se présente comme autoréférentielle ou autocratique. Qui fête son anniversaire finit par mettre les Hébreux en esclavage ou faire couper la tête de celui qui crie dans le désert.
Est-il bon d’être né?
Par-delà cette suggestion biblique se pose effectivement un problème qui relève à la fois de la physique et de la morale. Physiquement, la question est simple: à quel âge nait-on? Ou pour le dire autrement: pourquoi célébrer la naissance alors que la vie commence in utero?
Certes, il est difficile de dater la conception. Mais on peut se fier à d’autres indices. En de nombreux endroits d’Asie, on fixe arbitrairement à un an la durée de vie prénatale: le nouveau-né entame directement sa deuxième année et souffle donc deux bougies lors de son premier anniversaire. Chez des Aborigènes d’Australie, c’est le moment où la mère sent les premiers mouvements du bébé en son sein qui forme l’évènement inaugural. On pourrait aussi choisir la première nausée, le premier mois d’aménorrhée, le jour présumé de l’étreinte féconde et pourquoi pas la médiane des jours où les parents des parents se sont parlé pour la première fois…
Pourquoi s’arrêter à l’entrée dans le visible et à la séparation d’avec la mère? En fêtant le jour de naissance, ne souscrirait-on pas à l’ordre patriarcal? Ne s’accorderait-on pas aussi avec ceux qui estiment que l’avortement ne supprime pas une vie humaine, puisque l’humain ne surgirait qu’à la naissance? Ce n’est pas ici le lieu de répondre à ces questions, mais on voit qu’elles se posent.
Moralement, fêter un anniversaire suppose trois choses: primo, qu’il est bon d’être né; deuxio, qu’il est bon de prendre une année de plus; tertio, que le simple fait d’être né, et non celui d’avoir vécu dans la justice ou de mourir en état de grâce, suffit à une célébration collective et sans réticence.
Sur le premier point, Hérodote rapporte cette coutume d’un peuple thrace: «La famille du nourrisson se rassemble autour de lui et se lamente sur les maux qu’il devra subir puisqu’il est né, en rappelant toutes les calamités qui frappent les malheureux mortels; mais le mort est mis en terre au milieu des plaisanteries et de l’allégresse générale, puisque, disent-ils, il jouit désormais de la félicité la plus complète, à l’abri de tant de maux[1].» Pleurer la naissance, donc, et fêter la mort. Le principe se retrouve chez Sophocle, proféré par un chœur de vieillards:
Ne
pas naitre vaut mieux que tout ce qu’on peut dire
Le meilleur après ça, dès qu’on a vu le jour,
C’est retourner très vite au néant d’où l’on vient[2].
Sans doute n’est-ce pas le genre de poème que l’on récite habituellement à un anniversaire. Il serait bon d’essayer, cependant, et, après avoir essuyé l’accusation d’être un affreux rabat-joie, d’écouter ce que l’on peut répondre à cette objection, afin de parvenir à une joie lucide.
La faute de logique est assez évidente: comparer le fait d’être né avec le néant équivaut à comparer quelque chose avec rien, et donc à ne rien comparer. Le néant ne se situe pas sur l’échelle des réalités positives. Il ne saurait être «mieux» que quoi que ce soit. Aussi Épicure juge-t-il que ce chœur des vieillards est à la fois contradictoire et déloyal: «Si l’homme qui tient ce langage est convaincu, comment ne sort-il pas de la vie[3]?» Un tel dénégateur s’en prenant à son propre souffle, il devrait être déjà mort et ne rien dire. Plotin pour sa part en arrive à cette claire conclusion: «À mépriser l’être et la vie, on témoigne contre soi-même et contre ses propres sentiments; si l’on se dégoute de la vie mélangée de mort, c’est ce mélange qui est odieux, et non pas la vie véritable[4].»
La vie naissante ne peut être critiquée que par comparaison avec la vie véritable, et non avec le néant. Ce qui nous amène à notre deuxième supposition: la vie devient-elle plus vraie au fil des années? Est-il bon de vieillir? Après la question de l’être vient celle du devenir. Dans un monde voué au culte de l’enfance[5], la fête d’anniversaire tient le coup jusqu’à 11 ou 12 ans, après quoi l’on passe de l’autre côté de la pente – à l’adolescence ingrate, puis à la maturité frustrée, puis à la vieillesse cacochyme. Le centenaire bénéficiera encore d’une réception dans la salle polyvalente de la municipalité, mais c’est comme une rareté zoologique ou un phénomène de foire, sans susciter l’envie. En bref, pour applaudir en toute lucidité à cette ruine, il faudrait pouvoir affirmer avec saint Paul: «Nous ne perdons pas courage. Lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvèle de jour en jour» (2 Co 4,16).
Reste le dernier point. À Crésus qui fait étalage de son opulence et lui demande s’il ne le trouve pas le plus heureux des hommes, Solon réplique: «Je ne puis te répondre avant d’avoir appris que ta mort a été belle.» Il mentionnait auparavant le cas de Tellos d’Athènes, «qui mit en déroute l’ennemi et périt héroïquement[6]». Cette pensée d’une célébration seulement post mortem, la naissance n’étant justifiée que par une vie de héros ou de martyr, passera du paganisme à la chrétienté. Elle peut s’appuyer sur la parole de Jésus à propos du traitre: «Mieux vaudrait pour cet homme qu’il ne fût pas né» (Mt 26,24). Le Happy birthday est conditionné par la Holy life et la Happy death. C’est pourquoi, pendant plus d’un millénaire, on ne fête pas le jour de sa naissance, mais son saint patron, et l’on célèbre des messes pour les anniversaires de sa mort. Peu à peu, les registres ecclésiastiques ayant précédé ceux de l’état civil, on songe à célébrer le jour de son baptême, c’est-à-dire de sa naissance à la grâce, pour se rappeler de ne pas en faire mauvais usage.
Au début du 12e siècle, cependant, l’auteur de la Gesta Dei per Francos, le bénédictin Guibert de Nogent, laisse entrevoir la possibilité d’une célébration de la naissance comme telle. La vie naturelle, même blessée, même condamnée par le péché originel, demeure le fondement de la vie dans la grâce. Celui qui n’est pas né ne saurait être saint. Le jour de la naissance peut donc être perçu comme l’avènement visible d’une vocation:
Puisqu’il est véritable que c’est Dieu qui m’a créé et non point moi, que je n’ai point fixé moi-même ce jour solennel pour ma naissance, puisque c’est Dieu qui l’a choisi, je ne puis m’en glorifier qu’autant que toute ma vie, se conformant à la sainteté de ce jour, accomplira ce qu’il semblait présager de moi. Notre naissance réfléchirait véritablement toute la splendeur du jour où elle a lieu si nous n’agissions jamais que guidés par un sincère et complet amour pour la vertu. Oui, cette glorieuse entrée dans la vie paraitra une faveur justement accordée à l’homme toutes les fois que son âme persévérant dans l’équité honorera ainsi sa naissance[7].
Le jour de ma naissance est saint non parce que je le suis déjà, mais parce qu’il constitue un appel à la sainteté. Ma venue au jour m’indique que je dois venir à la pleine lumière. Le moment où je deviens visible m’incite à devenir digne de la gloire. La seule manière de fêter ma naissance est d’entrer plus avant et de persévérer dans la justice. L’anniversaire est alors le temps pour un bilan, sans doute, mais surtout pour un envoi, une exhortation à «passer en faisant le bien» (Ac 10,38). Le «Joyeux anniversaire» a de quoi nous réjouir et nous faire trembler. Il porte avec lui l’exigence la plus vive. C’est un aiguillon qui nous pousse à répandre autour de nous la joie, jusqu’à cette «joie parfaite» qui consiste à «donner beaucoup de fruit» (Jn 15,8-11).
*
Ce texte est extrait de la préface de Fabrice Hadjadj au livre de Josef Pieper, Dire oui au monde: une théorie de la fête, paru chez Salvator. Il est reproduit ici avec la gracieuse autorisation de l’éditeur.
[1] Hérodote, L’enquête.
Livres V à IX, V, 4, trad. A. Barguet, Gallimard, coll. Folio classique, Paris, 1990, p. 31.
[2] Œdipe à Colone, v. 1225-1227.
[3] Lettre à Ménécée.
[4] Ennéades, VI, 7, 29.
[5] Cf. George Boas, Le
culte de l’enfance, Éditions de la
revue Conférence, Trocy-en-Multien, 2013.
[6] Hérodote, L’enquête.
Livres I à IV, I, 30-32, op. cit., p. 53-54.
[7] Guibert de Nogent,
Histoire des croisades, suivie de Vie
de Guibert de
Nogent par
lui-même, trad. Guizot, Collection des mémoires
relatifs à l’histoire de France, Paris, 1825, p. 353.