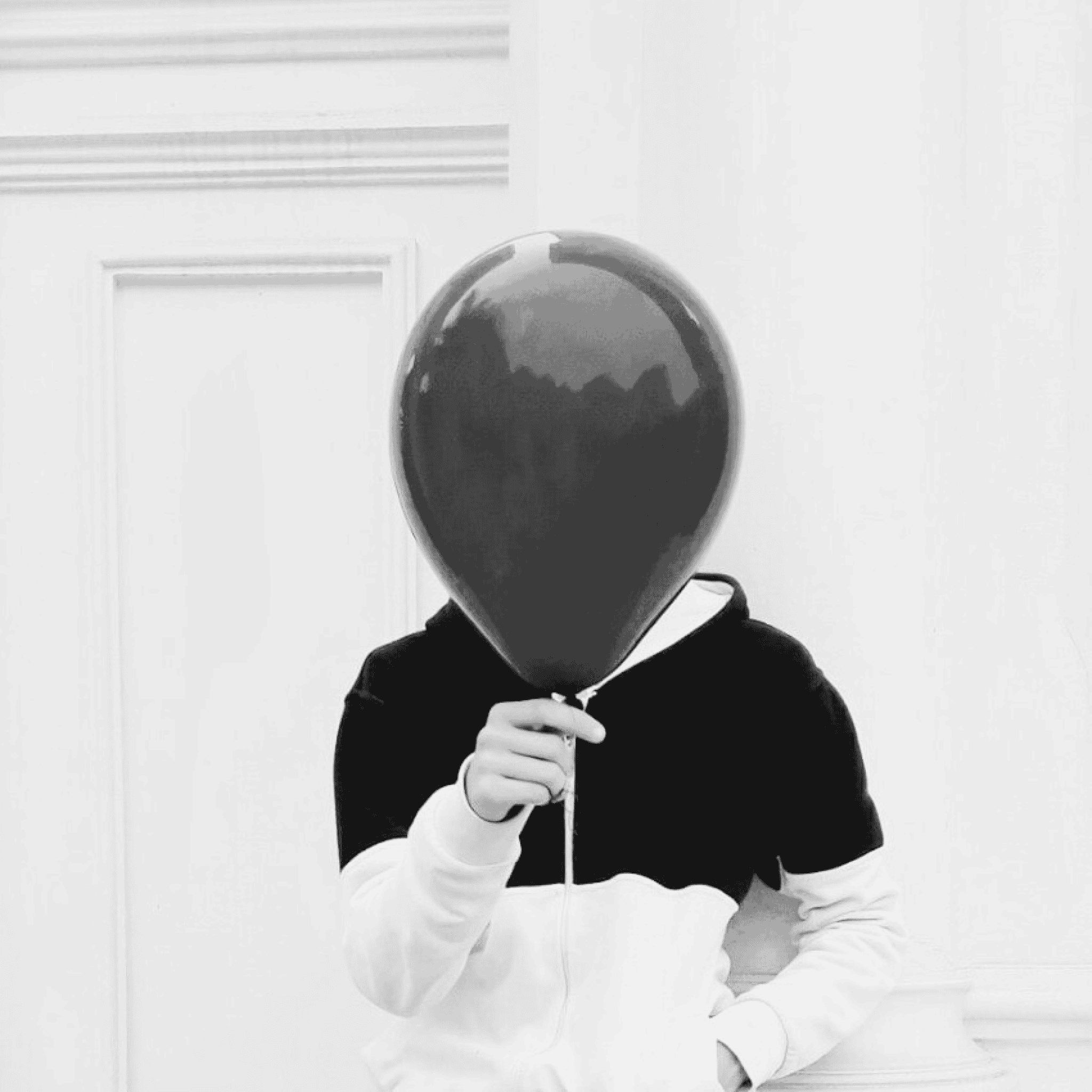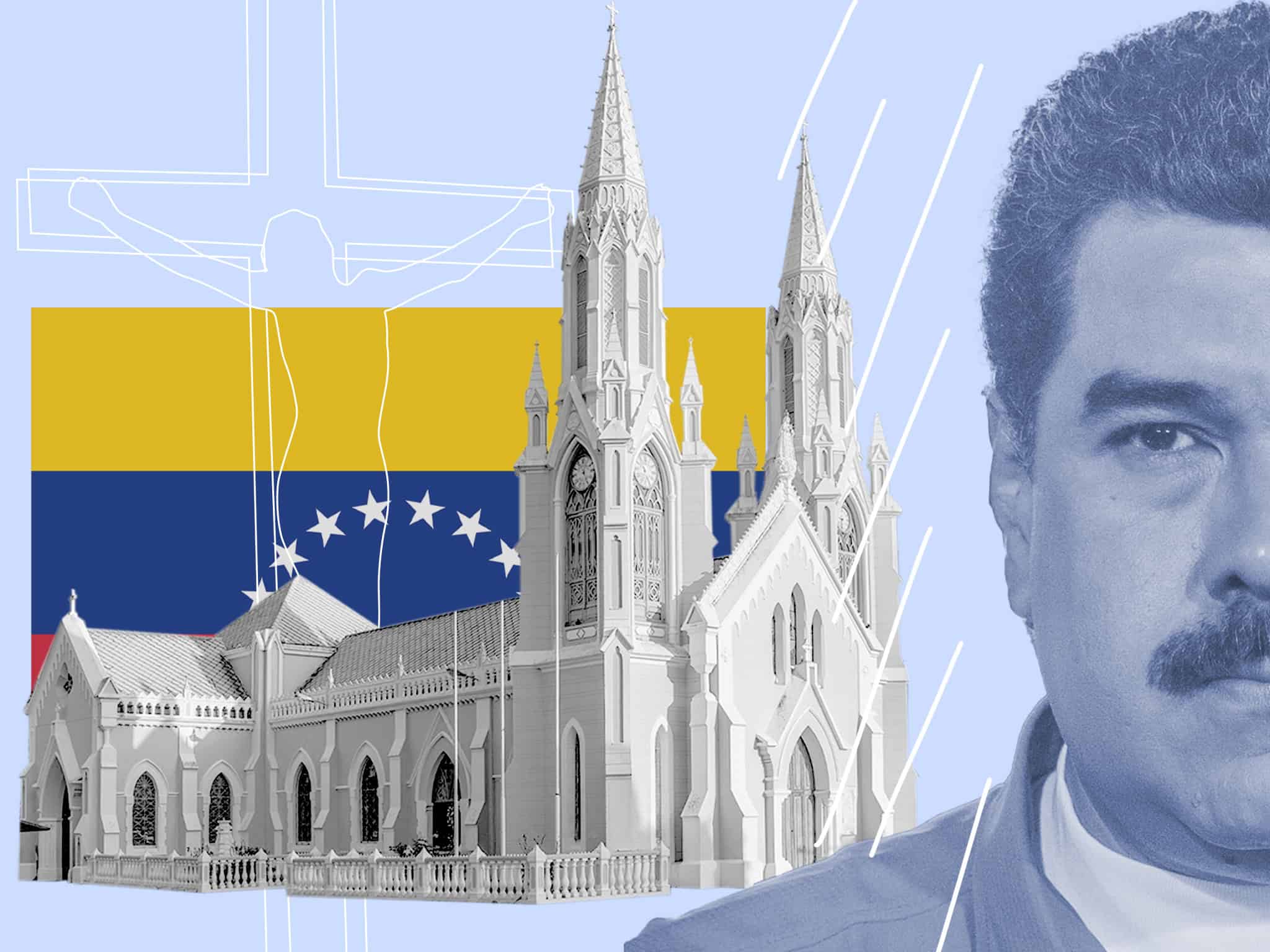À quoi sert la gentillesse?
Texte écrit par Ersun Kayra
Il faisait ce froid qui pince le nez et rend les trottoirs prudents. Devant le dépanneur, quelqu’un tient la porte pour une inconnue. Rien d’extraordinaire. Deux mots: «Merci, bonsoir.» Une micropaix.
En sortant, un jeune me dépasse en courant. Il tient la porte pour la personne derrière lui sans se retourner. Le battant ne claque pas, petite victoire contre la fatigue du monde. Elle ne sera pas comptée, mais je la note ici, pour mémoire.
Je me surprends à guetter ces instants: la caissière prend des nouvelles de la mère de M., une main remet un gant tombé, un homme dégage la neige d’un banc. Il ne prêche pas, il dégage. C’est déjà beaucoup.
Puis, un accroc. Un client repose un pain: trop cher cette semaine. Il sort avec seulement du lait. Personne ne commente. La clochette tinte. Le monde n’est pas un conte, la gentillesse ne suffit pas toujours. La petite bonté ne remplace pas la justice, elle nous empêche de durcir en attendant mieux. La chaleur humaine n’est pas l’alibi de l’inaction; c’en est souvent l’étincelle.
Car ce «mieux» ne tombe pas du ciel, il se travaille. Organismes, bibliothèques, refuges, voisins qui s’organisent. Les petits gestes n’effacent pas les factures, mais ils ouvrent la porte aux actions plus structurantes: épicerie solidaire, collecte, aide administrative, mobilisation pour un logement digne.
«Tenir bon», ce n’est pas héroïque, c’est tenace. Raccommoder sa journée avec un fil de bonté quand le tissu se déchire. Refuser de durcir. Dans cette obstination douce, il y a quelque chose de profondément humain — et peut-être, qui sait, d’un peu divin.
*
À force d’observer, je découvre un pays discret, celui des petites fidélités. Ici, on remet la chaise sous la table. Là, on ramasse une canette. Plus loin, on dit «merci» au chauffeur de bus.
À la bibliothèque, une dame peine avec le terminal. «Laissez, on va le faire à l’ancienne», sourit le bibliothécaire. Une phrase, rien de plus, et je repars moins seul. Je ne sais pas s’il croit, espère ou doute. Je sais qu’il rend la ville plus habitable, cinq minutes à la fois. C’est déjà une leçon.
Ce sont des gestes que personne ne photographie. Ils ne prouvent rien. Ils annoncent.
Annoncer plutôt que dénoncer. La liste de ce qui ne va pas est longue. Mais si je ne vois plus que ça, je deviens aveugle à ce qui guérit — souvent à la taille d’une main: tenir quelqu’un sur la glace, rendre un gant, poser un thé chaud.
*
Un soir, le vent froisse la ville. Je m’assois sur un banc vide. Dans ce clair-obscur, j’ose un mot que je dis peu: grâce. Pas comme théorie, mais comme sensation. Grâce, c’est quand une porte reste ouverte au moment opportun; quand on reçoit plus que ce qu’on mérite; quand le cœur fait une marche de plus et ne glisse pas.
On dira que c’est seulement de la gentillesse. Eh bien, vive la gentillesse! Elle entraine les muscles du cœur au mouvement de l’espérance. Elle ne règle pas tout; elle empêche de renoncer. Les petites fidélités ne changent pas le monde à elles seules — elles réveillent celles et ceux qui, demain matin, iront le changer.
Et, parfois, parce qu’une porte est restée ouverte, un cœur aussi reste ouvert.