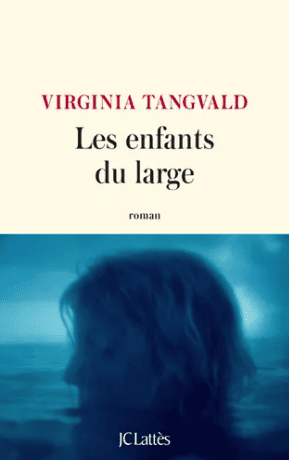Vraie et fausse liberté avec Virginia Tangvald
«Il y a trois sortes d’hommes: les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer.» Virginia Tangvald ouvre ainsi son récent film, Les enfants du large, pour décrire son père et son frère, Peter et Thomas. Ils auraient été les trois à la fois. Après une tournée en salle et dans les festivals, l’opus remportait le Prix du public TV5 du meilleur film francophone. Il est depuis peu disponible sur le site Web de l’ONF. Quelque temps auparavant, le roman biographique du même nom était un succès de librairie au Québec et en France, lui valant le prix Révélation d’automne de la société des gens de lettres. Le Verbe a souhaité faire le point avec l’autrice sur un récit familial traversé par une quête de liberté assassine.
Le Verbe: Pourquoi était-il important de revenir sur l’histoire déjà connue de ton père?
Virginia Tangvald: Sans dire pour autant qu'il mentait, son récit me semblait omettre des éléments pour qu’il ait vraiment du sens pour moi. J'avais l'impression de vivre avec une adéquation entre la liberté et la mort, comme si, pour être libre, il fallait forcément se jeter dans la gueule du loup. Mon père disait qu'il voulait être libre, quel qu'en soit le prix. C'était le nom de son autobiographie.
Qui sont Peter et Thomas Tangvald?
D’origine norvégienne, Peter Tangvald (1924-1991) devient navigateur au début de la trentaine et part à l’aventure à travers le monde. Il se fait connaitre par la nouveauté de son mode de vie nomade, qu’il relate dans ses articles. Au fil des années, trois femmes se succèdent dans sa vie et donnent chacune naissance à un enfant à bord: Thomas, Carmen et Virginia. Ses deux premières épouses meurent mystérieusement en mer, laissant planer un féminicide. Peter, quant à lui, s’échoue sur une côte caraïbéenne avec ses deux premiers enfants. Thomas, seul survivant, demeure toute sa vie obsédé par l’appel du large. Il disparait énigmatiquement à son tour en 2014 dans les eaux de la Guyane française, laissant derrière lui femme et enfants. Son corps n’a jamais été retrouvé.
Sa manière de parler de la liberté était extrêmement séduisante, mais elle ne tenait pas. Dans le récit qu’il avait construit, il était le personnage principal. C’est lui qui était dans la lumière. On comprenait bien sa quête et ses choix. Mais tous ses proches ont payé le prix de sa liberté – ils étaient comme des dommages collatéraux, des personnages secondaires avec moins d'importance. J'avais besoin de déconstruire son récit pour replacer les autres au centre et essayer de comprendre pourquoi cette tragédie n'arrêtait pas de se perpétuer.
Cherches-tu à mettre en avant une autre conception de la liberté?
Oui, je crois vraiment dans le pouvoir des histoires. Je trouve qu'on est défini par notre histoire, avec soi et avec les autres, en tant qu'individu et en tant que collectivité. Les histoires et leur logique interne sont extrêmement puissantes. Et je trouve que c’est essentiel d’en raconter entre nous, en société. Parfois, ce sont les histoires des autres qui ont été essentielles pour moi, pour me donner accès à moi-même, pour comprendre ce que je vivais. Alors, j'avais envie de faire partie de ce partage, de cet échange.
Mon père était vraiment mythologisé, il était présenté comme un héros d'une version de la liberté qui, en fait, exploite les autres. Et nos histoires en font souvent l'apologie, comme celle de Jack Kerouac par exemple. C'est ce genre de mythologie qui nous définit aussi en tant que société. C'est comme ça que l’on comprend la liberté entre nous. Je voulais remettre en question ce mythe de la liberté et en donner une autre définition.
Ton film m’en a rappelé d’autres – Les enfants du Refus global ou Vers l’inconnu, par exemple – dans lesquels les proches des protagonistes sont perçus comme des entraves à leur liberté. Pour ton père, c’était aussi le cas, non?
Absolument. C'était extrêmement individualiste. Pour mon père, les autres représentaient un danger. Ils étaient l'ennemi de sa liberté. Il ne voulait répondre à personne, à aucune loi, qu’elle soit humaine ou naturelle. En fait, il s'est piégé, parce qu'il avait besoin des autres. Il voulait être complètement autarcique, ce qui est une illusion.
Mais c'est peut-être là où j'ai été le plus transformée, en confrontant le raisonnement de mon père et son idéologie. En voyant à travers ses lettres comment sa psychologie se dégradait avec le temps. Son aventure avait commencé dans les années 1950 avec une ouverture sur le monde, un élan de curiosité pour aller vers l'autre. Et à la fin, c'était vraiment un vieil homme triste, enfermé sur lui-même et qui devenait fou. Il y avait pourtant des gens autour de lui qui l'avaient aimé. Mais il a toujours refusé de tenir compte de qui que ce soit d'autre que de lui-même. Il a tout perdu. Et finalement, il ne pouvait pas être libre tout seul sur son bateau au milieu de nulle part. Il ne faisait qu’errer. Libre de quoi? Pour faire quoi? D’aller où? Il ne pouvait pas répondre à ces questions.
Crois-tu qu'il est devenu dépressif parce qu'il était déçu du monde ou plutôt parce qu'il a pris conscience de son erreur?
Je crois qu'il était déçu, mais on peut voir dans ses lettres que cette société qu’il jugeait trop mondialisée avait déjà commencé à le décevoir plus tôt. Je crois qu'il a été rebuté par tout le luxe et la richesse de son enfance. Quand il parle de ses traversées en bateau, ce sont vraiment des expériences mystiques, transformatrices. Je pense que sa quête a commencé par un désir de découverte de soi, de transformation profonde, qui était aussi valable et sincère.
Dans la mythologie, il y a le cycle du héros qui part seul et qui revient – transformé par l'expérience vécue – à la société pour la réintégrer, cette fois en étant totalement lui-même. Pour mon père, il n'y avait pas de retour. Puisque tous les héros ont une faille mortelle, psychologique ou morale, s'ils ne la surmontent pas à temps, ils se détruisent ainsi que le monde autour d'eux.
Mon père avait de grandes qualités, mais il est devenu paranoïaque et c'est ce qui a mené à sa chute.
Tu ne peux pas juste vivre tout seul sur ton ile, être le seul capitaine à bord, sans te remettre en question, sans être confronté à la réalité de l'autre. Et à force de tenir absolument dans ce genre de rigidité psychologique, il s'est dégradé. On a besoin des autres pour être libre, pour accomplir ce qu'on veut accomplir. Il refusait cela.
 Photo: Marie Laliberté/Le Verbe
Photo: Marie Laliberté/Le Verbe
Dirais-tu que tu es complètement libérée de cette «malédiction», comme tu l'appelles dans le film?
Je crois que oui. Du moins d'une sorte de fascination que j'avais pour mon père. Il est plus accessible maintenant parce que je le vois davantage comme un humain, et moins comme une figure mythologique. Il m’a fait comprendre que j'avais besoin des autres pour être libre.
J'ai compris que j'avais envie de faire partie d’une réalité plus grande que moi. J'ai eu envie de faire partie de la société, de vivre en amitié avec les autres, ce que je ne ressentais pas avant. J'avais de l'amitié, j'étais gentille, mais je me sentais comme si j'étais de passage, toujours errante. Finalement, c'était vraiment une sorte de solitude profonde. Ça m'a donné envie d'avoir un enfant, alors que je n'en avais jamais voulu avant parce que j'étais prise avec des fantômes. J’étais dans la mort, avec l'impression que cette quête de liberté allait tout me couter d'un instant à l'autre. Je n'avais pas de pulsion à donner la vie. Ça m'a vraiment transformée.
Comment ton histoire familiale influence-t-elle maintenant ta manière d'éduquer ton enfant?
Il y a des expériences dans la vie qui sont difficiles à expliquer, parce qu’elles sont transcendantes, et je crois que cette sensation de liberté puis de communion avec la nature est plus grande que tout, qu’elle nous emporte. Mais il y en a une autre, et c'est l'amour. Il y a quelque chose d'infini dans l'amour.
Mon frère est disparu en mer, puis ses enfants sont encore en train de lui jeter des bouteilles; il était tellement aimé! Mais il avait cette incapacité à connecter avec les autres, à être vulnérable. Il a sacrifié ce qui avait autant de valeur.
Pour moi, la liberté, maintenant, c'est un mot qui n'a plus beaucoup de sens. J'ai l'impression que mon père voulait obtenir un style de vie qui allait lui garantir la liberté. Mais la liberté, ce n'est pas un oiseau que tu peux attraper et mettre en cage. Dès que tu as l'impression de la posséder, de l'avoir pour toi, elle va changer de visage.
J'essaie de me concentrer sur cette question: «libre en vue de quoi?» J'ai envie d’accomplir ce que je veux faire de la manière la plus entière que possible; j'ai l'impression que si je suis fidèle à moi-même, et loyale aux gens que j'aime – en premier lieu à mon fils – et que je suis dévouée à cet amour-là, la liberté viendra me voir de temps en temps.