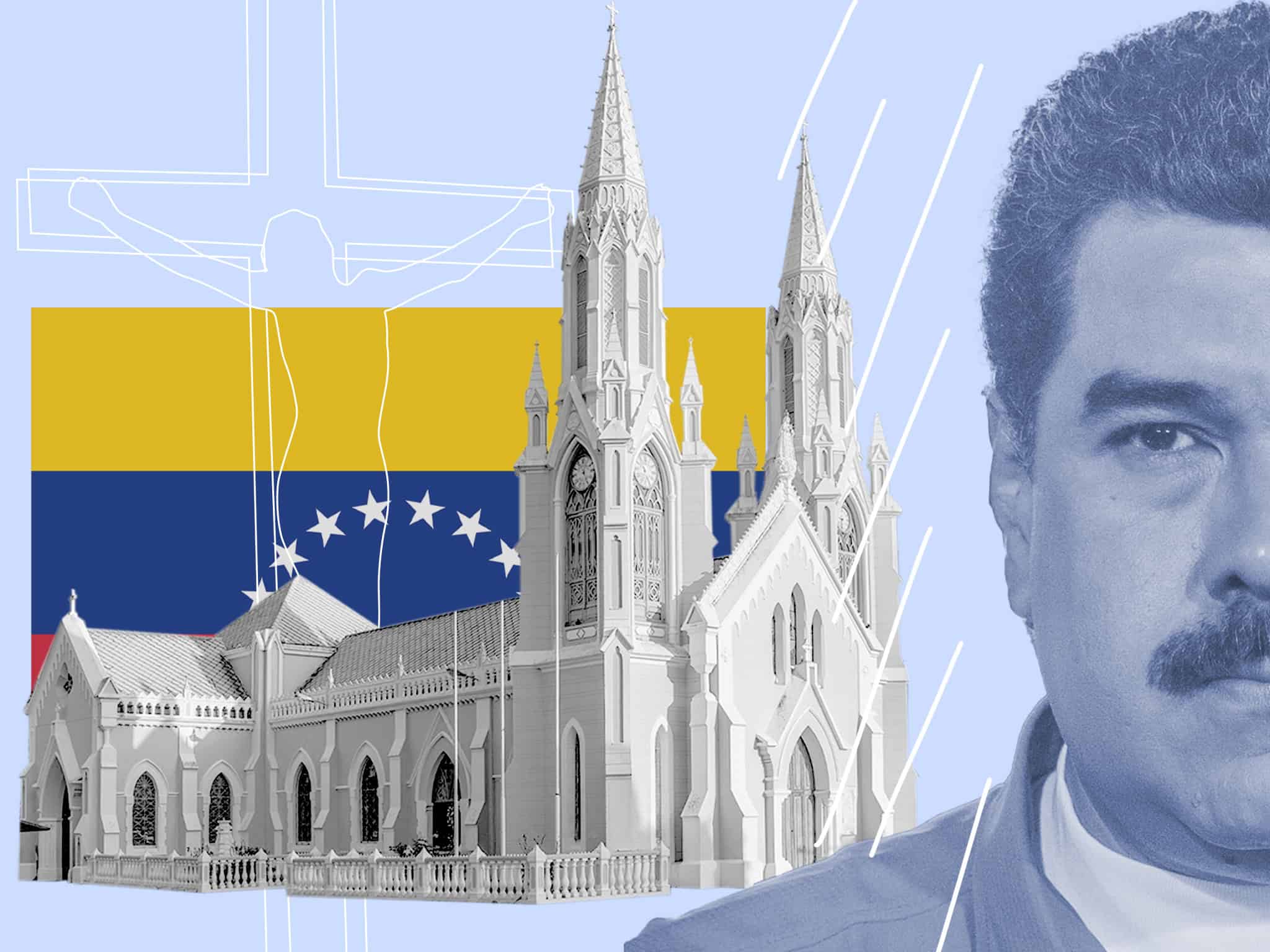Raconter l'aventure humaine avec Kim Thúy
Originaire du Vietnam, Kim Thúy fait partie de ces réfugiés, appelés boat people, qui ont défié l’océan pour fuir les effets de la guerre, entre les années 1970 et 1990. En 1978, à seulement 10 ans, Kim débarque à Granby avec sa famille, où ils se bâtissent une nouvelle vie. D’abord avocate puis propriétaire de restaurant, Kim Thúy se lance dans la carrière d’écrivaine en 2009 avec le roman Ru, qui conquiert aussi bien le Québec que la France. Rencontre avec une optimiste passionnée des mots, des récits humains et de la beauté.
Le Verbe: Vous avez la réputation d’une amoureuse du français. D’où vient votre affection particulière pour la langue de Molière?
Kim Thúy: J’aime toutes langues, mais la langue française – je devrais dire la langue québécoise –, je l’affectionne particulièrement parce qu’elle m’a donné la possibilité d’avoir une deuxième vie et qu’elle m’a accueillie avec une affection inconditionnelle sans aucune attente en retour. Pour moi, c’est plus qu’une langue. C’est émotif, c’est irrationnel, ça vient des entrailles. C’est la beauté pure d’un humain face à un autre, c’est l’aide et l’accueil que j’ai reçus quand je suis arrivée au Québec.
Comme écrivaine, vous mettez cet amour de la langue au service de la littérature. Vous racontez des histoires. Comment définiriez-vous le récit?
Oh! c’est une bonne question. Sérieusement, je ne sais pas y répondre [rires], je n’y ai jamais réfléchi avant. Quand l’éditeur de mon premier livre m’a demandé si c’était un roman ou un récit, je l’ai regardé et je lui ai dit: «C’est quoi, la différence?» Je ne savais vraiment pas. Pour moi, mes livres sont des livres, point. Je ne les mets pas dans des catégories.
Mais je dirais qu’un récit, c’est l’aventure humaine racontée. C’est la vision de la vie d’une personne. Le fait que vous soyez venues de Québec pour me rencontrer aujourd’hui, c’est une aventure humaine qui devient un récit. Ça vaut la peine d’être raconté et partagé. On pourrait dire que c’est anecdotique, mais ça ne l’est pas, car je crois qu’on absorbe la beauté d’un moment qu’on vit pendant cette aventure. Tu vois, en ce moment, on aborde des sujets dont je n’avais jamais parlé avant. Tu m’amènes ailleurs et je suis contente que tu me donnes l’occasion de réfléchir à autre chose. C’est quoi, un récit? C’est la première fois que je mets les mots «aventure humaine» sur ce terme.
Pensez-vous que le récit est encore utile en 2025? Si oui, que peut-il nous apporter, selon vous?
On ne peut jamais voir ce que les autres voient. On ne voit qu’avec nos yeux. Et on pense que tout le monde voit comme nous, que notre vision est la seule, la bonne. Je crois que le récit nous permet de voir quelque chose que l’on ne voit pas, de découvrir une vision nouvelle à travers les yeux d’un autre.
 Photo: Marie Laliberté/Le Verbe
Photo: Marie Laliberté/Le Verbe
À quoi ça sert? À mieux comprendre la réalité dans laquelle on vit et pourquoi l’autre agit comme il agit. La vie est tellement complexe. Personne ne peut en avoir une vision à 360 degrés. On a besoin des autres pour qu’elle soit enrichie, plus complète et éventuellement plus nuancée. Ce partage de visions, c’est une richesse, il nous apporte des connaissances qui deviennent des outils pour nous rendre plus résilients. Moi, par exemple, j’ai vécu dans un camp de réfugiés, donc je ne crains pas que l’épicerie manque de nourriture. Je sais comment survivre. Les humains, nous sommes la seule espèce qui soit capable d’accumuler les récits pour mieux comprendre le monde. C’est fascinant.
Qu’est-ce que le récit vous a apporté dans le rapport à votre histoire personnelle? Vous a-t-il aidé à guérir votre relation avec le passé?
Ma guérison s’est faite dès que j’ai mis le pied sur le territoire québécois. Instantanément. Le récit, personnellement, ça ne guérit rien. C’est une jouissance, c’est l’euphorie. C’est un privilège d’écrire. Je n’ai rien à régler avec la vie. Rien. Je n’ai pas de discorde, pas de malentendus. Rien. Aujourd’hui, c’est juste du gâteau avec du gros crémage!
«Nous sommes la seule espèce qui soit capable d’accumuler les récits pour mieux comprendre le monde.»
Vous semblez être très en paix. Avez-vous peur de la mort?
Ben non! Je pourrais mourir aujourd’hui. Je suis plus que satisfaite. La vie m’a donné plus que ce que je suis capable de prendre. Je suis tout à fait prête à donner ma place à quelqu’un d’autre. Grâce à mon passé – si je puis dire –, je connais la fin, la mort. On s’est regardées dans les yeux, ce qui fait que j’ai une relation très amicale avec la mort. Et comme je vois la fin, je peux construire ma vie à partir d’elle. Je crois que la vie devrait avoir pour point de repère la mort.
Le contact avec la mort favorise souvent un certain dénuement. Dans une entrevue accordée à Radio-Canada, vous dites que l’extérieur – en d’autres mots, les apparences – importe peu. L’important serait ce que l’on nourrit à l’intérieur. Que nourrissez-vous?
Mes valeurs, et je n’en ai pas beaucoup, deux ou trois, tout au plus. Je pense que, si on appliquait un peu plus nos valeurs, le monde irait mieux. La plus importante, pour moi, c’est le respect. Je vais te donner un exemple. J’étais invitée à Tout le monde en parle pour le lancement d’un de mes livres alors que je m’étais engagée six mois plus tôt à aller donner une conférence à des bénévoles d’une commission scolaire. Le choix logique à faire, c’était d’aller à l’émission, mais j’ai refusé l’invitation. Faire passer Tout le monde en parle avant les bénévoles, c’était leur dire qu’ils étaient moins importants que mon livre.
C’est très facile de dire qu’on a des valeurs, mais les appliquer, c’est autre chose. Chaque fois que tu les mets en application, ça fait mal et elles viennent en contradiction avec la logique politique, économique, matérielle, environnementale. Je nourris mes valeurs, car quand je les suis, je me sens bien et je sens que je reste fidèle à moi-même, que je deviens un peu plus Kim.
Que souhaitez-vous transmettre à travers vos livres?
Je veux transmettre la beauté de l’humain. Pourquoi? Pour nous élever plutôt qu’exacerber notre côté sombre, ce que font déjà assez les politiciens, d’après moi. Nous traçons beaucoup de frontières entre nous, alors qu’en partageant, on apporte de la joie à l’autre.
C’est difficile de trouver une personne agaçante quand elle sourit, non? Si tout le monde se donnait la responsabilité de faire sourire l’autre – du leadeur politique au bébé –, y aurait-il des conflits dans le monde? Je me pose la question. Je me donne la mission de partager avec le monde la beauté de l’humain et la paix que j’ai la chance de connaitre en vivant ici, au Canada. On pense que c’est acquis alors qu’en fait, c’est précieux et fragile.
D’où vous viennent cette sagesse et cet optimisme que vous portez en vous?
Vivre, c’est tough. La vie ne nous lâche que des épreuves. Au Vietnam, quand quelqu’un meurt, on dit qu’«il a fini de payer sa dette à la vie». La vie est difficile et on est obligés de la vivre jusqu’au bout. Alors, si en plus de ça on s’en met davantage sur le dos en ne regardant que ce qui va mal, on ne s’aide pas. Selon moi, l’optimisme, c’est une discipline. Ce n’est pas facile, ça prend de l’entrainement. Avec le temps, ça devient un réflexe, ça s’intègre à notre personne. On peut s’énerver pour un rien ou l’on peut chercher la beauté, le côté positif, dans la situation.
Vous parlez beaucoup de la beauté. Elle semble importante pour vous. Pourquoi?
La beauté nous élève et nous amène nécessairement dans un état de bienêtre. C’est une philosophie de vie pour moi. On prend très peu de temps pour contempler la beauté, mais on prend le temps de regarder ce qui est laid et catastrophique. Quand est-ce qu’on ralentit pour regarder les fleurs sur le bord de l’autoroute? Pourtant, on ralentit pour regarder un accident, et parfois, on espère même voir de près la catastrophe.
Il faut qu’on donne aux enfants dès leur jeune âge les outils pour répondre à tout ce qui est négatif dans la vie et leur apprendre comment voir le beau derrière les épreuves. C’est la mission que je me donne.