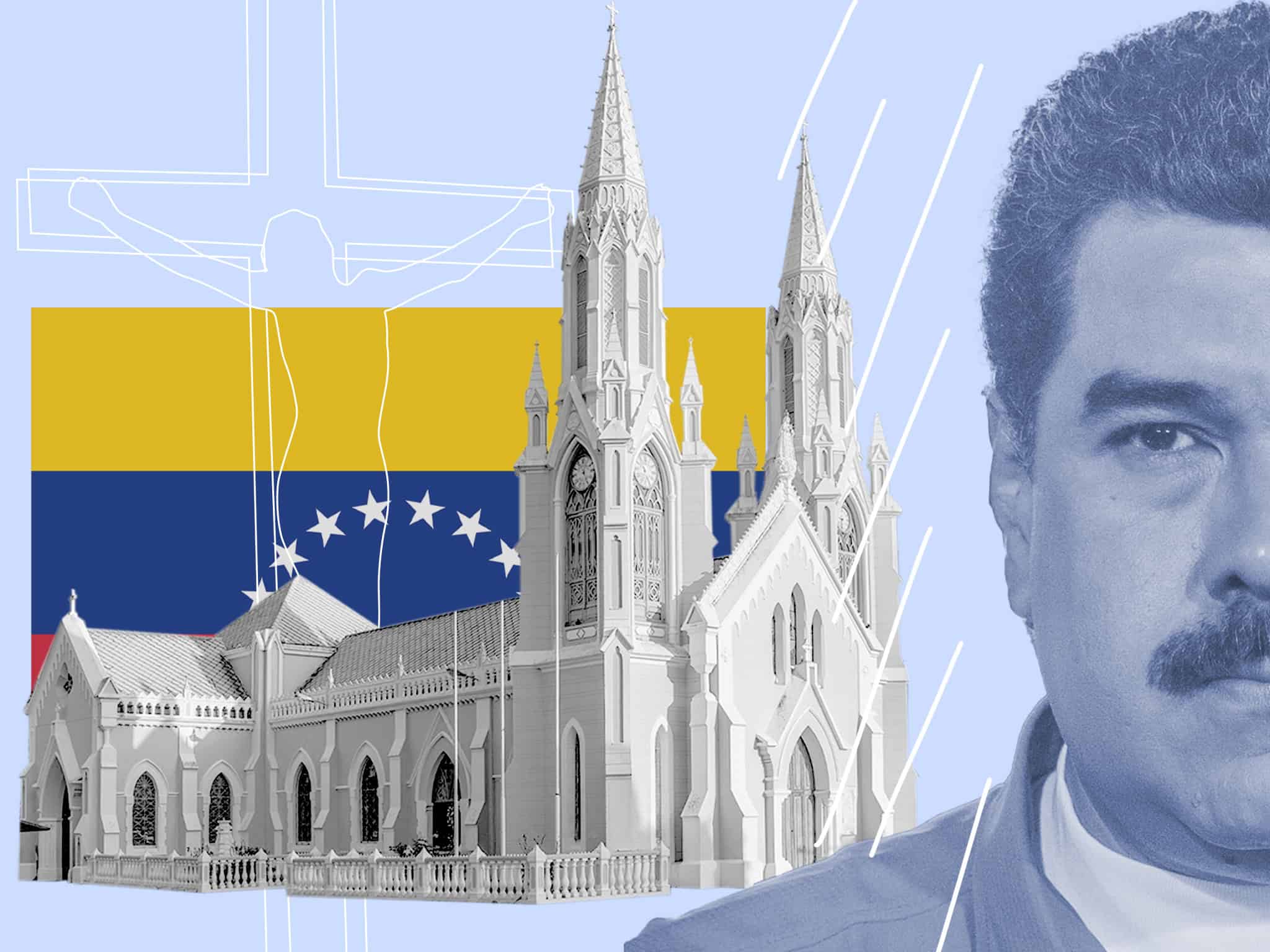Louis-Jean Cormier à l’école de l’abandon
D’abord comme chanteur du groupe Karkwa, puis à travers une carrière solo couronnée de succès, Louis-Jean Cormier impose sa marque sur le paysage musical québécois depuis plus d’un quart de siècle. Récemment, il s’ouvrait sur la quête spirituelle qui le pousse à réfléchir aux grandes questions, comme la vie, la liberté, le bonheur. Le Verbe est allé à sa rencontre au lendemain de la présentation de son dernier spectacle, Les entretoits, pour un entretien autour des idées qui logent dans le grenier de sa pensée.
Le Verbe: Dans ton récent spectacle, tu fais principalement des reprises. Pourquoi avoir voulu laisser autant de place à ces grands artistes qui t’ont tant influencé?
Louis-Jean Cormier : Il y a le fun que j’ai à réinterpréter des chansons. J’aime ça me lancer le défi de leur donner une nouvelle vie. Et mon fun est décuplé quand je vois la réaction des gens. Je comprends que c’est par le biais d’une réinterprétation de chansons connues que tu peux en quelque sorte démontrer l’étendue des possibilités créatives dans la musique. Il y a une part de contemplation, de surprise et d’étonnement là-dedans. Au fond, il n’y a aucune différence entre chanter les chansons des autres et ses propres chansons. On est comme des connecteurs dans une grande bibliothèque du savoir vital !
La création est-elle un acte de liberté? Faut-il simplement se laisser faire et être traversé par plus grand que soi?
C’est sûr que c’est un acte de liberté. Du moment que tu t’enlèves de dans tes pattes, tu es dans une liberté absolue. La vie devrait être vécue comme ça, je pense. À un moment donné, je dis dans le spectacle: «Nous autres, on est des troubadours, on est des passeurs.» Je pense que tout le monde devrait être dans une position de lâcher-prise ultime pour être capable de dire: «Je vais faire ce que la vie me donne, me demande de faire.»
 Photo: Marie Laliberté/Le Verbe
Photo: Marie Laliberté/Le Verbe
Tu acceptes presque toujours les nouveaux défis qu’on te propose, les demandes qu’on te fait. C’est la liberté aussi, dire «oui»?
Oui, et surtout dire «oui» quand ton réflexe premier serait de dire «non». C’est là que ça devient important.
La phrase du show, c’est «la vie sera toujours plus intelligente que toi». Et de là l’émerveillement devant la synchronicité des évènements. Le show est basé là-dessus. Quelles sont les chances que je fasse de la musique dans la vie? Que je sois vivant? Et toi, tu es ici, dans le noir, entourée d’inconnus et tu viens écouter des chansons. Il n’y a rien qui peut être planifié là-dedans.
L’idée, c’est que tu abandonnes le besoin de contrôler quoi que ce soit. Le lâcher-prise, c’est ne plus s’agripper à ce qu’on pense contrôler. Pourquoi on contrôle les affaires? Parce qu’on a peur. On a peur de l’inconnu, on a peur de mourir, on a peur de la souffrance. Mais là, je suis rendu dans un cours de spiritualité! (rires)
Tu sembles émerveillé par la communion avec le public. Y a-t-il quelque chose de spirituel et d’universel dans les mots et la musique? Dans le fait de vibrer tous ensemble?
Être entouré d’inconnus dans le noir. Ne plus en avoir conscience, tant que ça. Être en communion directe, absorbé par un matériau invisible, en plus. Il y a un dude, là. Il y a des cordes qui vibrent et des fréquences, mais tout ça est invisible. Moi, c’est ça qui me fascine dans mon métier: je travaille avec des deux-par-quatre transparents!
D’ailleurs, les mots aussi sont des bijoux. Ils sont pour moi aussi importants que les fréquences sonores de la musique. Ils possèdent aussi une musique en eux.
N’y a-t-il pas aussi une part de mystère dans la création artistique elle-même?
C’est encore plus important, pour moi. Ça devient un peu un jeu. Je dis souvent que l’important, c’est justement de ne pas savoir. Dès que tu penses savoir quelque chose, tu retournes dans ton personnage. Si tu veux avoir accès à la création la plus pure, il faut être dans l’intuition. Un peu dans l’inconnu. En fait, pas un peu, mais totalement dans l’inconnu.
Tu acceptes et tu dis whatever. C’est un peu ça, l’idée derrière le fait de dire «oui» à quelque chose quand, d’emblée, tu aurais le réflexe de dire «non». Même si ce n’est pas agréable, il y a un élément que tu n’aurais pas vu venir, qui va faire naitre autre chose. C’est ça, l’idée de confiance en la vie ou de lâcher-prise. Sinon, tu passes à côté de choses que tu ne connais pas, dont tu ne sais pas qu’elles vont arriver. Tu ne vas vraiment rester que dans ton petit connu.
As-tu toujours eu cette confiance? Que dirais-tu à ceux qui n’ont pas cette disposition à l’abandon?
Je pense que ça nait avec l’insouciance, un peu. J’ai ce terme-là qui me revient souvent. J’ai eu une enfance probablement très calme, sans perturbations. Je comprends que la source d’un désir de contrôle de sa vie est vraiment ancrée dans les peurs, les traumatismes, les choses qu’on veut éviter à tout prix. C’est normal, on tient le volant serré parce qu’on ne veut pas retourner où on est déjà allé. Et moi, j’ai eu la chance de grandir un peu dans la ouate. On n’était pas du tout riches, mais on n’a jamais manqué de rien.
«Moi, c’est ça qui me fascine dans mon métier: je travaille avec des deux-par-quatre transparents!»
Mais la vie peut décevoir?
La noirceur, ça n’existe pas, c’est l’absence de lumière. Beaucoup de lumière, moins de lumière, pas de lumière. La déception, en un sens, n’existe pas non plus. Elle est faite d’attentes non comblées. Des prévisions, un désir: de là vient la déception.
En un autre sens, c’est sûr que ça existe. On la sent. Mais elle n’existerait pas s’il n’y avait pas eu d’attente, de prévision, de vision de sa vie. Quand tu t’efforces de vivre ta vie avec les portes et fenêtres grandes ouvertes, avec le désir de dire «impressionne-moi, trimbale-moi quelque part», il n’y a plus d’attente, donc moins de déception.
Tu reviens beaucoup sur ton père qui a rejeté la foi pour fonder une famille. Qu’est-ce que ça signifie pour toi?
Il n’a pas rejeté sa foi, mais la prêtrise. Il nous a quand même obligés à aller à la messe et tout ça. Aujourd’hui, je lui en suis reconnaissant, même si dans le temps je détestais ça pour mourir, et qu’encore aujourd’hui mon opinion égoïste de la religion est très sévère. Je trouve que c’est une aberration complète que ces mouvements-là soient devenus si puissants, qu’on ait pu exterminer des peuples, créer des guerres. C’est «bébé la la», quand tu y penses. Je suis sévère sur le résultat de la religion, mais je suis passionné par la naissance des religions et par les valeurs véhiculées. Leur raison d’être à l’origine est tout à fait logique et raisonnable.
Tu parles plus de ta vie intérieure depuis un certain temps. Comment qualifierais-tu ta démarche spirituelle? Que cherches-tu?
C’est beaucoup de faire de mon passage sur Terre une réussite, quelque part. Pour moi, la seule manière de calculer une vie réussie, c’est dans le nombre de secondes d’émerveillement. À partir de maintenant, je veux être capable d’être émerveillé jusqu’à ma mort, de façon puissante et constante. De là, la quête spirituelle, parce que tout ce que tu vas étudier va revenir à ça: être heureux.