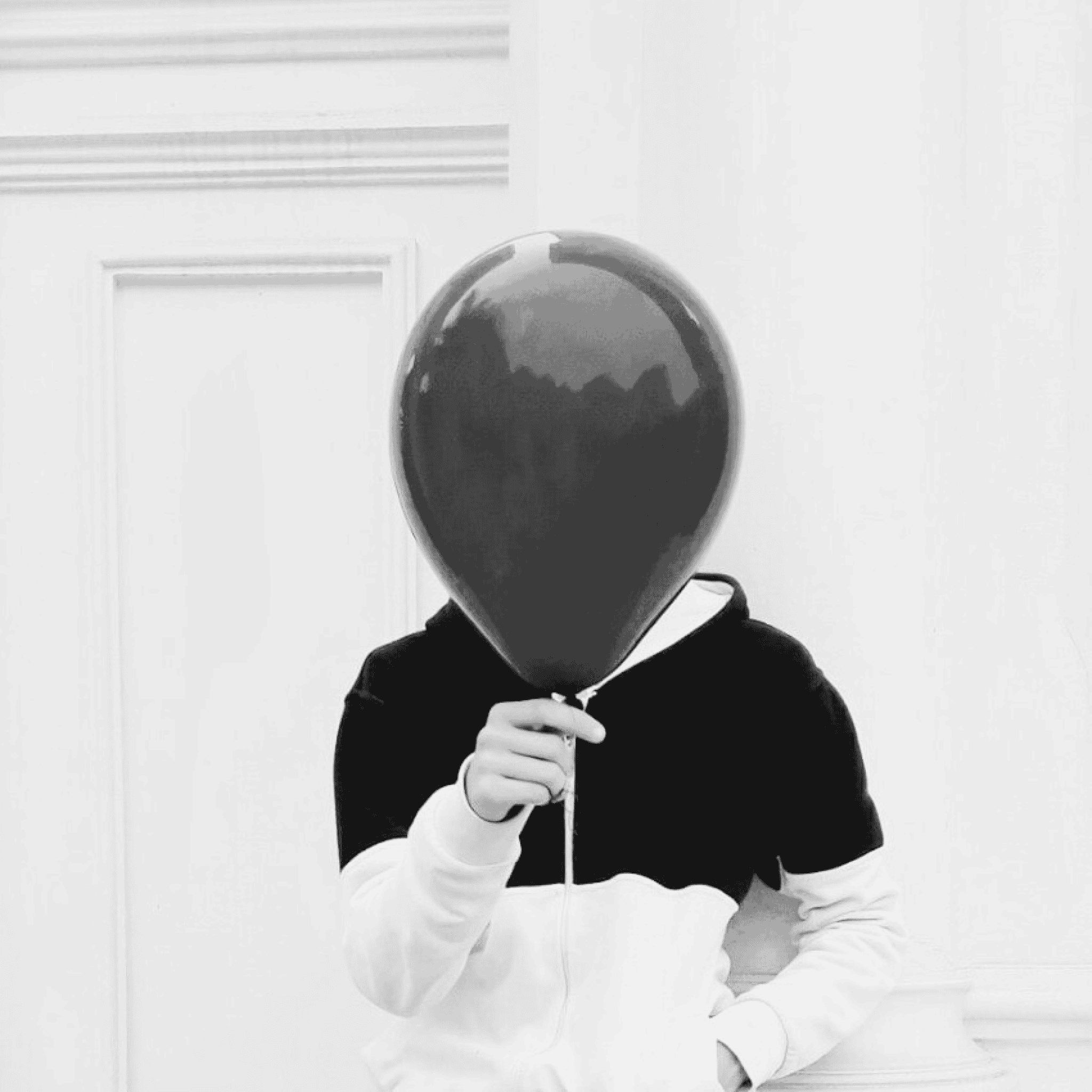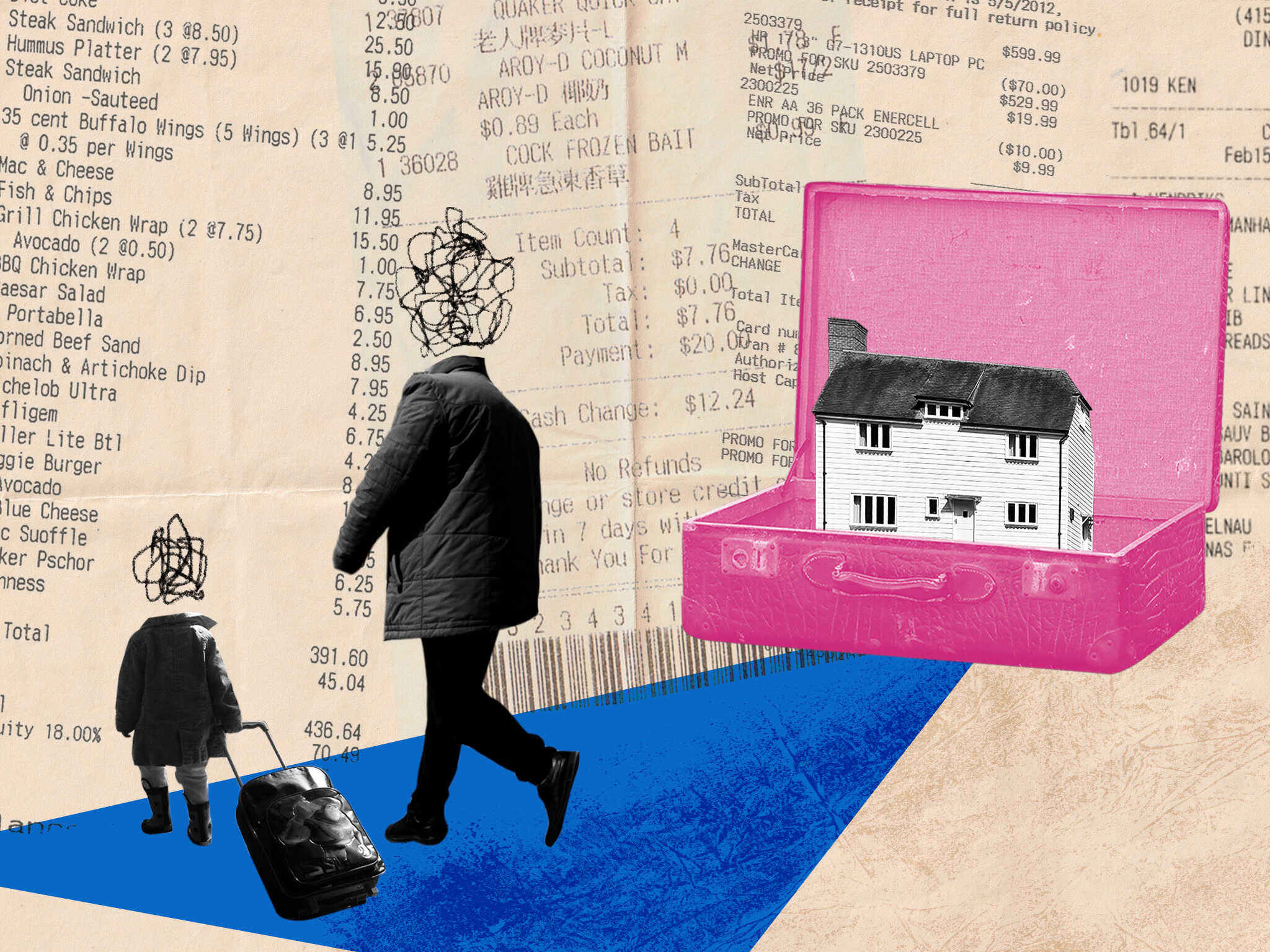Se (re)convertir à l’oral
Texte écrit par Mikaël Grenier
Depuis l’invention de l’imprimerie, nous vivions sous le règne de l’écrit. Or, avec la révolution informatique et la démocratisation du téléphone intelligent, un revirement se fait sentir. Nous avons chacun un petit appareil radio numérique dans la poche, qui précipite un retour en force de la communication orale dans la sphère culturelle et en redéfinit les contours. L’univers numérique chrétien n’y échappe pas, et l’impact sur les mentalités et les rencontres se fait sentir.
Dans les sociétés traditionnelles, la transmission des récits fondateurs qui constituent l’âme d’une communauté se faisait principalement à l’oral. D’ailleurs, il faut prendre «traditionnel» au sens large, puisque le Québec de nos grands-parents n’y fait pas exception, comme en témoigne la variété des versions d’une même légende.
De la même manière, les Grecs chantaient l’Illiade avant de l’écrire, et l’Église des tout débuts n’avait pas d’Évangile écrit. La communication orale est beaucoup plus souple: Les paroles s’envolent et les écrits restent, dit le proverbe. Dès qu’on ouvre la bouche, un discours nouveau prend forme. Une idée, même plusieurs fois exprimée, se laisse formuler différemment d’une fois à l’autre. Qui plus est, on s’imprègne surtout de l’esprit de ce qu’on entend. Il est rare qu’on répète exactement un propos entendu; on le reformule d’ailleurs autant de fois qu’on se le rappelle.
La parole et l’écrit
Avec l’écrit, c’est tout le contraire. On doit méditer le sujet, structurer ses idées et les ordonner avant de prendre la plume. L’écriture exige de réfléchir en amont, puisque les corrections étaient très difficiles à apporter. C’est moins vrai depuis la révolution informatique, qui a introduit le copier-coller. Avant celle-ci, une erreur d’impression exigeait la publication d’un erratum avec chaque copie du texte distribué. Le travail de révision était alors colossal, car une fois publié, le texte est figé. Il résiste à l’effet du temps qui passe et devient une preuve à consulter en cas de doute. Bref, une référence.
«À peine notre esprit a-t-il pu décanter tout ce qui s’y est déposé qu’on le remue à nouveau par plus d’informations. L’aliment est abondant, mais nous perdons de vue nos signes de satiété.»
La démocratisation d’Internet et du téléphone intelligent précipite le retour de l’oral dans nos vies et dans le contenu culturel que nous consommons. Certes, la radio existe depuis longtemps, mais la baladodiffusion s’en distingue beaucoup. Là où la radio diffuse en voiture, au café, dans le centre commercial où chez le barbier, le balado s’écoute plus souvent seul par le biais d’écouteurs personnels. La radio semble faite pour être écoutée «publiquement»; le balado, pour être écouté seul.
Contrairement à la radio, le balado offre le choix du moment de son écoute. L’auditeur a le choix du programme, du sujet, et les ondes captées ne limitent plus son choix. Plus encore, des algorithmes bien sophistiqués ont tôt fait de cerner sa sensibilité idéologique et de l’y conforter. Bientôt, l’auditeur se retrouve enfermé dans sa chambre d’écho, victime d’un algorithme.
Deux facettes du consommateur de culture
Le texte écrit, par opposition au discours oral, est particulier en cela que c’est le lecteur qui lui donne vie. Il est maitre du jeu: il décide du rythme de sa progression, et même de l’ordre dans lequel il survole le texte. Lorsque sa compréhension est imparfaite, il s’arrête, se questionne, vérifie au besoin le sens des mots. C’est l’imagination du lecteur qui choisit les images et donne aux mots leur sens spécifique.
L’écrit exige aussi la pleine attention du lecteur. Il est difficile en effet de lire en prenant une douche, en nettoyant la cuisine, en faisant une séance de musculation ou en conduisant; on peut cependant vaquer sans problème à toutes ces occupations en écoutant son balado préféré. L’auditeur de balado est ainsi plus passif.
Il en résulte une plus grande facilité à consommer à outrance les balados qui nous intéressent. Les lecteurs voraces existent, mais libérer du temps pour lire plusieurs livres par semaine est plus complexe qu’il ne l’est de consommer plusieurs balados. Cela n’est pas sans impact sur notre capacité à digérer l’information. À peine notre esprit a-t-il pu décanter tout ce qui s’y est déposé qu’on le remue à nouveau par plus d’informations. L’aliment est abondant, mais nous perdons de vue nos signes de satiété.
Entendre l’appel
Quand on est en quête de réponses, qu’on cherche à étancher sa soif intérieure, cette grande disponibilité de contenus peut vite engendrer une sorte de boulimie culturelle, voire spirituelle. Les balados chrétiens se multiplient et leurs offres de contenus aussi. Manne pour les chercheurs de sens? Chaque créateur propose une certaine façon de vivre la foi, mais surtout de la comprendre. Or, leur maitrise des enseignements de l’Église ou des Écritures n’est pas toujours certaine, et l’accumulation de connaissances n’entraine pas forcément un changement de vie. D’expérience, les rencontres humaines, les amitiés et les discussions en chair et en os sont plus souvent l’occasion d’une réelle croissance intérieure.
Cela dit, la diffusion massive de contenu culturel chrétien est une excellente nouvelle. Il s’agit d’un premier niveau de témoignage où, derrière ses écouteurs, l’auditeur se laisse rencontrer. Mais c’est l’expérience qui trouve son parachèvement dans les discussions où l’auditeur devient interlocuteur. Évitons de nous limiter à la simple absorption de contenus qui, consommés à l’excès, deviennent une nourriture idéologique plutôt que spirituelle.
Ce contenu n'a pas été chargé automatiquement puisqu'il provient d'un fournisseur externe qui pourrait ne pas respecter vos préférences en matière de témoins.