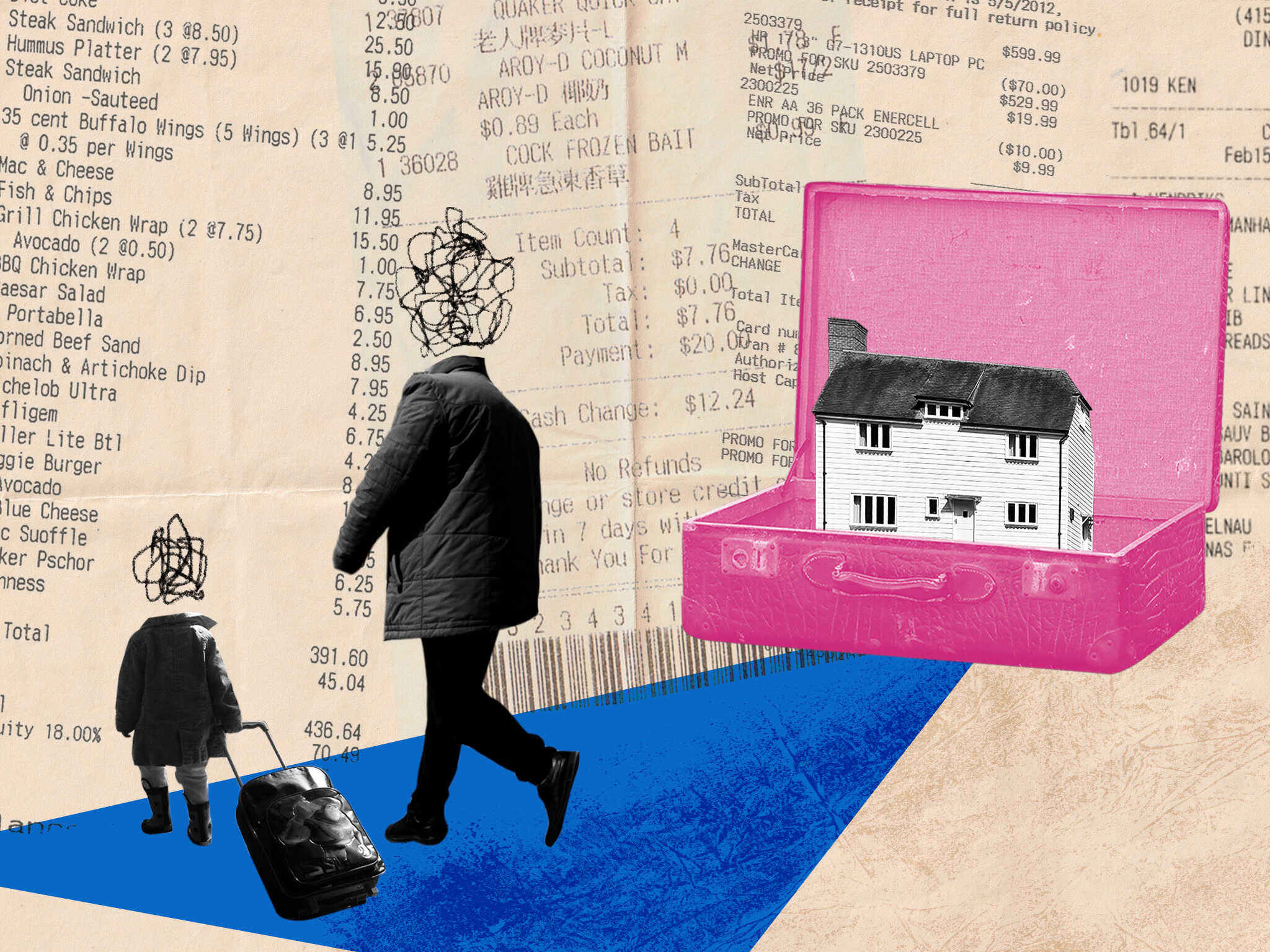Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan
Le dernier film de Ken Scott, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, est un succès en salle depuis sa sortie il y a un peu plus d’une semaine en France. Il offre une histoire touchante dans laquelle tous semblent se reconnaitre. Chef-d’œuvre sans bavure? Pas tout à fait. Il fait bon toutefois de voir que ce genre d’histoire peut encore toucher un si vaste public.
Adapté du roman biographique du même nom, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan raconte l’histoire de son auteur, Roland Perez, aujourd’hui avocat célèbre dans l’Hexagone. Né dans les années 1960 avec un pied bot, il est condamné par les médecins à ne jamais marcher. Le film présente surtout la détermination de sa mère, qui refuse les pronostics médicaux et remue ciel et terre pour que son fils soit «normal» et puisse éventuellement entrer à l’école comme tous les autres enfants, en marchant.
C’est ainsi qu’Esther Perez rencontre avec le petit Roland des dizaines de spécialistes. Ils sont unanimes: il a besoin «d’appareils» pour être mobile, son pied est trop tordu. Mais pour la mère, pas question que son fils, le dernier de six enfants, soit handicapé. Elle rencontre, après plusieurs années durant lesquelles Roland se déplace en rampant dans leur appartement, une dame qui saura comment redresser le pied rebelle. Durant les nombreux mois que dure le traitement, c’est l’amour du garçon pour Sylvie Vartan (chanteuse populaire de l’époque) qui l’aidera à supporter l’inconfort et l’ennui.
Et sa mère triomphera: Roland finit par marcher, sans appareil, sans béquilles et pratiquement sans boiter.
Mais l’histoire ne s’arrête pas là: on découvre rapidement que l’amour indescriptible d’Esther pour son fils a du mal à évoluer. Elle peine à prendre une saine distance alors que ce dernier grandit et devient un homme, un époux et un père. La seconde moitié du récit s’attarde à cette relation complexe et parfois douloureuse.
 Les Films Opale
Les Films Opale
Glorification d’un amour malsain
Si le film de Ken Scott a été qualifié par plusieurs médias français de «feel good movie» (film pur bonheur), qu’il est certes à la fois comique et émouvant, je dois avouer que j’ai éprouvé un profond malaise à plusieurs reprises. En soi, le long-métrage est bien construit, les acteurs sont très convaincants, mais l’histoire m’a, par moments, rendue inconfortable.
C’est que la détermination de la mère à faire «guérir» son fils s’approche beaucoup d’un déni et d’une incapacité à accepter son fils tel qu’il est, dans tout ce qu’il est. De confession juive, elle passe ses journées à prier pour que Dieu lui donne un miracle. Lorsqu’elle l’obtient finalement, on oublie tout à coup toutes les années de souffrance que Roland a vécues auparavant. Alors qu’on voit plutôt bien les conséquences de cette dévotion totale de la mère pour son enfant lorsqu’il devient adulte, j’aurais bien aimé qu’on en montre autant lors de son enfance.
Je concède qu’on peut difficilement creuser profondément tous les états d’âme de chaque personnage en 90 minutes, mais cet aspect de la vie du héros m’a manqué. Peut-être que cela aurait permis d’équilibrer de façon plus juste l’espèce de glorification de cet amour malade et malsain d’une mère pour son enfant.
Il y a aussi la manière dont est dépeinte la foi d’Esther, très utilitaire. Elle prie sans cesse pour obtenir un miracle et une fois que sa prière est exaucée, il n’est pratiquement plus question de Dieu dans le film. Autrement dit, elle attend de Dieu qu’il règle ses problèmes, qu’il soit à son service, ensuite, au placard! C’est une image assez caricaturale, voire grossière de la foi, surtout considérant que le mot «Dieu» est dans le titre de l’œuvre.
Un film à voir, tout de même, ne serait-ce que pour le jeu des acteurs. Et aussi parce qu’il invite chacun à réfléchir à sa relation avec ses parents, ou avec ses enfants.