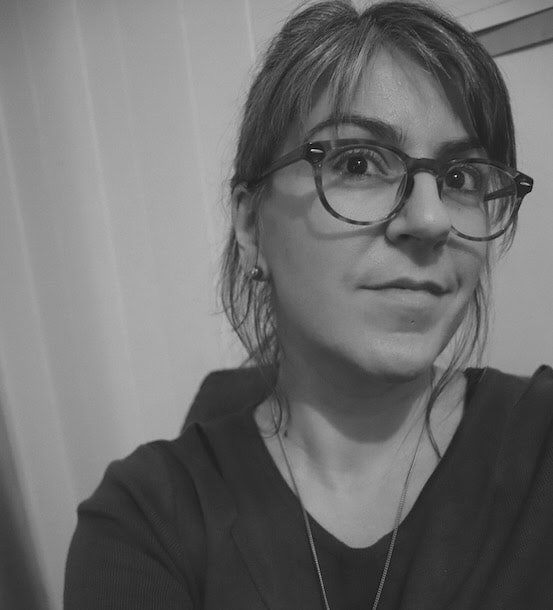L’héritage symbolique des prénoms
Comment se prénommaient vos grands-parents? Marie-Ange, Toussaint, Rosaire? Avez-vous un ami qui s’appelle Pascal? L’histoire des prénoms au Québec n’est que l’une des multiples facettes de notre patrimoine religieux! Il suffit d’arpenter un cimetière catholique ou d’ouvrir un classique de la littérature québécoise: les héros s’appellent Euchariste, Maria ou Séraphin. Et si on se penchait un peu sur cet héritage pour mieux le comprendre et, pourquoi pas, se le réapproprier?
Dans plusieurs cultures ou religions, les prénoms témoignent de l’appartenance à une famille spirituelle. Les catholiques ne font pas exception. Par le baptême, l’enfant est accueilli dans l’Église comme enfant de Dieu et comme membre d’une communauté de croyants. Un prénom lié aux valeurs chrétiennes est consciencieusement choisi à cette occasion. Le baptisé est ainsi confié à la protection divine et se voit offrir un modèle de vie à suivre. Sauf quelques exceptions originales, le nom se rattache à l’une ou l’autre de ces catégories:
- Saint ou sainte (Thérèse, Antoine, Jean);
- Variation mariale (Marielle, Mariette, Dolorès pour Notre-Dame-des-Douleurs, Rosaire);
- Référence biblique (Samuel, Élie, David);
- Vertu (Constance, Clémence, Prudence);
- Dévotion angélique (Angélique, Archange, Michel, Gabriel);
- Fête liturgique (Noëlla, Pascal, Épiphane).
Les classiques
À l’époque de la Nouvelle-France, l’éventail des prénoms semble réduit. Les femmes se nomment souvent Marie, Catherine, Marguerite, Madeleine ou Jeanne; beaucoup d’hommes s’appellent François, Jean-Baptiste, Pierre, Charles ou Jacques. Le prénom se transmet alors du père au fils aîné, de la mère à la fille ou des parrains et marraines aux filleuls.
Les classiques Marie et Joseph – voire Marie-Josèphe pour une femme –, encore plus présents dans la colonie qu’en France, ont toujours été populaires. Cependant, au 19e siècle, ils commencent à être systématiquement donnés comme deuxième prénom sur l’acte de baptême. Cette pratique dure longtemps. Ma mère, née dans les années 1950, a reçu Marie comme deuxième prénom.
Fait intéressant, le nom Jean-Baptiste en est venu à incarner le Canadien français typique, un peu comme le John Bull des Anglais. Ceci vient d’une anecdote remontant à la guerre anglo-américaine de 1812: un officier anglais constate, à l’appel des soldats, la fréquence de ce nom parmi les enrôlés canadiens. «Damned, they are all called Jean-Baptiste!», s’étonne-t-il. Il n’en fallait pas plus pour que le prénom devienne un sobriquet donné aux francophones par les Anglais. Cette anecdote aurait joué un rôle dans le choix du nom de la Société Saint-Jean-Baptiste, et dans la désignation de ce saint prophète comme patron des canadiens en 1908 par le pape Pie X.
Litanie des saints
À partir des années 1850 environ, on voit apparaître une grande diversité de prénoms; certains sont inusités, et même carrément bizarres! Cherchez dans votre arbre généalogique, et vous trouverez certainement de ces noms qui font sourire ou écarquiller les yeux. Dans le mien, il y a un Alpide, une Almoza et un Odélime. Un passionné a même compilé près de 30 000 de ces noms originaux et présente son répertoire sur internet.
Mais pourquoi tant de variété, soudainement? À cette époque où les familles étaient très nombreuses et la mortalité infantile moins élevée qu’auparavant, les enfants se succédaient rapidement et étaient baptisés très tôt après la naissance, voire le jour même. Il semble qu’une pratique courante consistait à consulter le curé, qui allait vérifier dans le calendrier liturgique quels saints et saintes étaient fêtés le jour de la naissance du bébé. Sainte Restitue? Eh bien, voilà un charmant prénom!
Pourtant, cette hypothèse ne saurait répondre elle seule à la question, car j’ai beau fouiller, je ne trouve pas de saint patron pour chacun de mes ancêtres aux noms insolites! Se peut-il que des prêtres aient été durs d’oreille, au point de mal orthographier les noms? Il faut aussi considérer le taux d’analphabétisme élevé à l’époque; beaucoup écrivaient leur nom «au son» sur certains registres civils. Cela pourrait expliquer ce genre de variation: Agapet, Agapide, Agapien, Agapit, Agapite, Agapitre.
Mise à part la galerie des saints, certaines modes ont amené des prénoms nouveaux. Par exemple, on m’a souvent parlé d’un homme de la génération de mes grands-parents qui s’appelait Sarto; je trouvais ce nom étrange. J’ai appris récemment qu’il s’agit du patronyme du pape Pie X, Giuseppe Sarto, mort en odeur de sainteté au début de la Première Guerre mondiale. Dans les décennies suivantes, le nom Sarto aurait été en vogue dans le monde catholique.
Faire du neuf avec de l’ancien
Aujourd’hui, les prénoms anciens semblent avoir la cote. Ils sont appréciés pour leur noblesse de caractère, pour leur filiation avec les ancêtres, ou parce qu’ils s’inscrivent dans une continuité historique et culturelle. Comme on restaure avec amour une belle maison ancienne, pourquoi ne pas faire honneur à nos saints et nos héros d’ici en leur redonnant un visage jeune, celui de la prochaine génération de Québécois? Déjà, on rencontre des petites Léonie (sainte Léonie Paradis), des petits André (saint frère André). Quant à moi, je vous suggère Mance ou carrément Jeanne-Mance (vénérable Jeanne Mance), ou bien Kateri (sainte Kateri Tekakwitha). Une belle façon de garder vivant l’héritage de notre «peuple de Jean-Baptiste»!