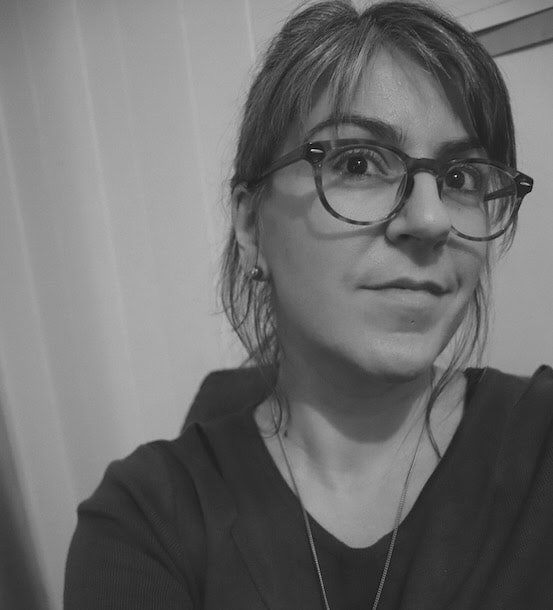Cet été, osez le plus vieux voyage du monde
On le répète souvent: jamais l’humain n’a autant voyagé qu’en ce 21e siècle. Globetrotteurs, nous parcourons la planète pour toutes sortes de raisons. À l’approche de l’été, vous êtes peut-être en train de planifier des vacances loin de la maison, des excursions, un voyage à l’étranger? Et si l’envie vous prenait d’y ajouter un cheminement intérieur, une profondeur spirituelle? Vous passeriez alors de simple voyageur à pèlerin!
En cette année jubilaire décrétée par le pape François, le moment est parfait pour entreprendre un pèlerinage. Si un jubilé est l’occasion d’un parcours intérieur — la conversion du cœur pour les croyants —, c’est aussi une occasion pour visiter des lieux saints et faire le plein de bénédictions. Examinons un peu cette pratique aussi universelle qu’ancienne.
Pèlerins dans l'âme
Présent dans toutes les cultures et à toutes les époques, le pèlerinage est un déplacement, seul ou en groupe, vers un lieu sacré. L’endroit peut être lié à des reliques — restes humains appartenant à un personnage vénéré —, à des récits de miracles et de guérisons, au tombeau d’un saint ou d’une sainte. Un lieu de pèlerinage en est un où la communication avec le divin est ressentie d’une façon particulière.
Chez les chrétiens, les pèlerins seraient apparus dès les premiers siècles, en se concentrant sur les lieux de la Passion et de la mort de Jésus, comme le Saint-Sépulcre. Ce pèlerinage en Terre sainte atteint son apogée au Moyen Âge et fait partie des trois grands pèlerinages de la chrétienté avec Saint-Jacques-de-Compostelle et Rome.
Mais pourquoi entreprendre un tel périple? On le fait surtout pour obtenir une faveur divine, une guérison ou la réponse à une prière. C’est aussi une démarche pénitentielle entreprise pour expier une faute commise. Mais, au-delà de l’objectif, c’est surtout une occasion de croissance spirituelle. Car le chemin est aussi important que la destination! Traditionnellement, le voyage se fait à pied, avec tous les risques et difficultés que l’on peut imaginer. Lorsque bien vécus, ces revers peuvent porter du fruit et rapprocher le pèlerin de Dieu. Plusieurs récits en témoignent.
Pour les croyants, le pèlerinage est une sorte d’analogie de la condition humaine sur terre. Comme des exilés, nous cheminons entre les épreuves et les moments de grâce, en route vers notre «vraie patrie», celle du ciel.
Les foules accourent
Après une longue période de latence, les pays de l’Occident chrétien connaissent un nouvel âge d’or des pèlerinages, au 19e siècle. La piété mariale reprend du galon grâce à certains évènements comme les apparitions de Lourdes, en France. Au Québec, la ferveur religieuse du mouvement ultramontain favorise les grandes manifestations populaires de la foi. Les foules se rassemblent en plein air pour entendre des prédicateurs célèbres, et des monuments religieux sont érigés un peu partout. Les Sacré-Cœur, statues et chemins de croix émaillent le paysage québécois. Le développement des transports – trains, bateaux à vapeur – a aussi sa part de responsabilité dans ce nouvel engouement. Il permet le déplacement plus simple et plus rapide des groupes de pèlerins, parfois même considérables.
C’est à cette époque qu’est amorcé l’aménagement des grands sanctuaires québécois, dont le développement se poursuivra au fil des décennies: l’Oratoire Saint-Joseph (Montréal), le sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré (près de Québec) et celui de Notre-Dame-du-Cap (Trois-Rivières). Ces lieux, et plusieurs autres, sont étroitement associés à de saints personnages comme le frère André et le père Frédéric Janssoone, ainsi qu’à des membres du clergé et à des communautés religieuses qui ont travaillé d’arrachepied pour bâtir ces immenses lieux de prière.
Après le pic de popularité des années 1950 — où il n’était pas rare de voir des processions de milliers de personnes sur les sites des sanctuaires —, la sécularisation croissante du Québec a eu pour effet de diminuer l’achalandage sur les lieux de pèlerinage. Si l’on exclut le cas un peu à part de l’Oratoire Saint-Joseph, encore visité par des pèlerins et des touristes du monde entier tout au long de l’année, l’affluence est surtout concentrée lors des fêtes religieuses importantes (fête de sainte Anne, Assomption de la Vierge).
Sortir du quotidien
Le thème du Jubilé 2025, «Pèlerins d’espérance», invite justement à sortir du marasme ambiant pour aller chercher de manière active ce qui procure la paix. Pas besoin d’aller à Rome – quoi que… pourquoi pas? –, le Québec comprend à lui seul une belle panoplie de petits et grands sanctuaires. Il s’agit souvent de lieux hautement significatifs sur les plans historique et culturel, en plus d’être situés, dans bien des cas, au sein d’un paysage inspirant. Cet été, faites changement et pèlerinez!
Mis à part les fameux lieux de pèlerinage mentionnés plus haut, voici quelques endroits qui valent le déplacement. Qui sait ce qui vous attend là-bas… ou en chemin?
L’Ermitage Saint-Antoine, à Lac-Bouchette
Le calvaire de Saint-Élie-de-Caxton, en Mauricie
Le sanctuaire et musée du Bon Père Frédéric, à Trois-Rivières
La basilique Notre-Dame et la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal
Le parcours des Sanctuaires du fleuve, en Montérégie, qui inclut sept lieux exceptionnels
Le parcours des tombeaux des fondateurs de l’Église canadienne, à Québec
Le Centre Marie-Léonie Paradis, situé dans la cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke, qui comprend un musée et le tombeau de la sainte