

Valérie Laflamme-Caron
Valérie Laflamme-Caron est formée en anthropologie et en théologie. Elle anime présentement la pastorale dans une école secondaire de la région de Québec. Elle aime traiter des enjeux qui traversent le Québec contemporain avec un langage qui mobilise l’apport des sciences sociales à sa posture croyante.
-

#Tradwives : des traditions de façade
Des femmes de divers pays ont parti un mouvement sur TikTok, #tradwife, qui sert de canal pour mettre de l’avant le mode de vie des femmes à la maison des années 1950. Certaines se réclament de la « sagesse ancienne » comme Alena Kate Pettitt. D’autres sont ouvertement racistes comme les #tradwives américaines. Ces influenceuses rétros ont toutefois un point en commun : elles sont en colère. On ne s’en douterait pas, mais je me plais à jouer à la reine du foyer. Je me réjouis lorsque je planifie les repas de la semaine. Je change la déco du salon suivant les fêtes du
-

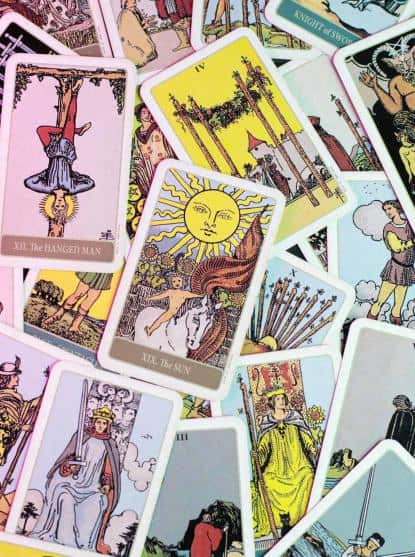
Les sorcières de TikTok
Alors qu’il était périlleux, à une époque, de se faire identifier comme sorcière, ce titre est désormais revendiqué par des influenceuses qui font un tabac sur TikTok. Les vidéos regroupées sous le mot-clic « witchtok » ont été vues plus de vingt-milliards de fois. Certains craignent que cette nouvelle tendance ne vienne corrompre la jeunesse. Que penser de ces cybersorcières qui assaillent le web ? Sur le « witchtok », on retrouve une diversité de contenus qui vont de l’astrologie à la divination, du yoga à la méditation, en passant par la lecture des cristaux. Ces pratiques visent à favoriser la guérison, augmenter l’estime de soi
-


« Pumpkin spice latte » : la saveur de la nostalgie
Avant de me lancer dans l’écriture de cette chronique, j’ai allumé une bougie aux arômes de « churros caramélisés ». J’ai lancé ma playlist automne 2021. Ces jours-ci, je suis dans les reprises folksy de chansons populaires des années 2000. Sur le buffet de la cuisine, j’ai disposé quelques bibelots au milieu des courges soigneusement alignées. Par la fenêtre, rien n’indique que l’automne s’est installé. J’habite dans la basse-ville de Québec, là où les feuilles ne rougissent pas : les arbres sont inexistants. C’est l’arrivée des lattés à la citrouille dans les cafés du coin qui me rappelle que l’hiver approche. Une tradition américaine Cette boisson phare de la
-


Pèlerins et touristes : une cohabitation nécessaire
Pendant que les paroisses sont désertées et les églises démolies, les grands sanctuaires du Québec sont investis par des masses de touristes en quête de beauté et d’authenticité. Chaque année, c’est en moyenne quatre-millions de visiteurs qui se relaient dans ces lieux souvent boudés par les locaux. Tendance lourde dans l’industrie, le tourisme religieux est appelé à croitre. Pour les responsables d’Église, cet afflux représente autant un défi qu’une occasion favorable. Claude Grou a été recteur de l’Oratoire Saint-Joseph du mont Royal pendant quinze ans. On visite pour différentes raisons ce sanctuaire qui abrite le tombeau de saint frère André :
-
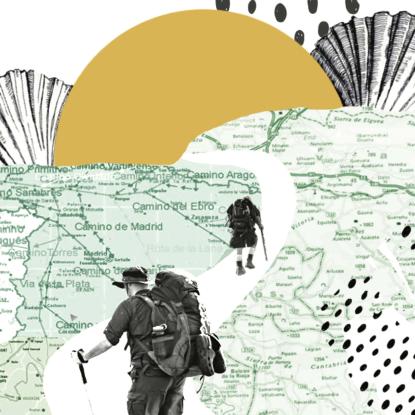
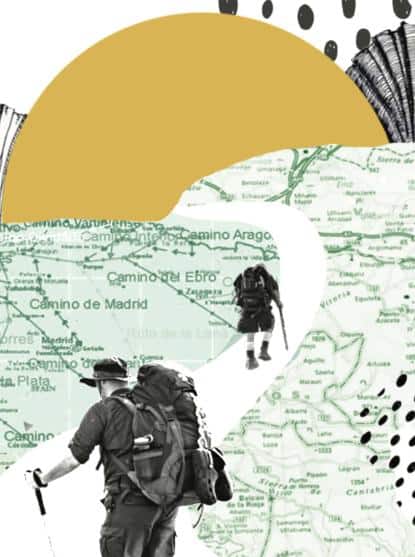
À Memphis comme à Compostelle : la pratique pèlerine aujourd’hui
Éric Laliberté a plusieurs cordes à son arc. Après s’être investi pendant près de dix ans dans le domaine de l’animation au secondaire, il découvre le pèlerinage. Il fonde avec Brigitte Harouni l’organisme Bottes et vélo, qui offre des services de formation et d’accompagnement spirituel dédié au pèlerinage de longue randonnée. Il termine présentement un doctorat en théologie à travers lequel il se spécialise en études pèlerines. Nous l’avons rencontré afin qu’il nous parle des manifestations contemporaines de cette pratique. Tout d’abord, les études pèlerines, c’est quoi ? Un champ interdisciplinaire assez récent qui s’est développé dans les années 1970. Les parents
-


Un féminisme en mutation ?
Qu’ont en commun les femmes transgenres, les personnes prostituées et les femmes musulmanes ? L’approche intersectionnelle rassemble des militantes issues de ces groupes dans une lutte contre ce qui est conceptualisé comme une « matrice de domination ». Ce féminisme oppose au patriarcat le paradigme de la diversité, dans lequel se dissolvent les référents à la féminité. Regard sur les mutations du féminisme contemporain. En novembre 2013, lors des États généraux du féminisme, une centaine de militantes ont quitté la Fédération des femmes du Québec (FFQ) pour fonder leur propre organisation. Ce schisme, provoqué par un débat sur le port du hijab, a
-


Les enfants qui aident les enfants
Parce que leur pays s’est développé au point où l’on parle maintenant de « miracle africain », le Rwanda est aujourd’hui une terre d’asile pour près de 150 000 réfugiés. Au moyen d’un camp de jour organisé par l’Enfance missionnaire, les jeunes du diocèse de Byumba participent activement à intégrer leurs camarades d’origine congolaise. De novembre à janvier, ils sont quelques centaines à se regrouper chaque semaine pour vivre des activités ludiques et éducatives. Chaque rassemblement débute par une prière pour tous les enfants du monde. Comme au Canada, des jeux et des cris de ralliement marquent le quotidien du camp. Le groupe entame
-


Les chemins de la désillusion : de l’étranger au Canada
Le mythe de l’eldorado est apparu en Amérique du Sud au 16e siècle et a été relayé par les conquistadors partout en Europe pendant près de 400 ans. Ce mirage a conduit bien des hommes à leur perte. Aujourd’hui, c’est l’Occident qui se dresse telle une cité d’or pour des millions de personnes à la recherche d’une vie meilleure. Qu’elles proviennent de l’Équateur, du Cameroun ou de la Syrie, les personnes qui immigrent au Canada sont nombreuses à vivre une désillusion. Quatre d’entre elles ont accepté de nous partager les aléas de leur intégration à la vie québécoise. Un rêve José et
-


Religieuses au cœur de la pandémie: isolées, mais pas seules
Le Québec compte actuellement 7 973 religieux et religieuses, ce qui représente 70 % de tous les religieux du Canada. Plus de la moitié d’entre eux sont âgés de plus de quatre-vingts ans. Les couvents, maisons et résidences où ces personnes habitent sont particulièrement vulnérables à la pandémie de Covid. Trois religieuses qui ont dû composer avec l’intrusion du virus dans leurs milieux de vie ont accepté de nous partager comment elles vivent ce temps d’isolement. Sœur Doris Lamontagne est la sœur supérieure des Petites Franciscaines de Marie de Baie-Saint-Paul. Au moment où je m’entretiens avec elle, elle vient de vivre sur Zoom
-


Les mauvaises connexions : étudier à distance au temps de la covid
« M’entends-tu ? » « Attends, je vais te rappeler. » « Je crois que ça fonctionne ! » Aucune rencontre en ligne ne commence sans un peu de cafouillage, et mes entrevues avec ces étudiants ne font pas exception. J’ai voulu discuter avec eux de leurs nouvelles réalités scolaires. Même si Édouard, Anne et Raphaël ont des parcours bien différents, ce qu’ils ont à dire à ce sujet se rejoint. La perte d’un milieu de vie Édouard est en première année au cégep. Parce qu’il se passionne pour tout et refusait de choisir, il a débuté cet automne un programme exigeant en sciences, lettres et arts. « L’école,
-


Koukoumesh : sœur Renelle Lasalle chez les Anicinabek
Sœur Renelle Lasalle a une montagne à son nom, à Saint-Michel-des-Saints, où elle a fait aménager des pistes de ski en prévision des Jeux du Québec. Élevée par un père alcoolique, elle voulait sauver le monde par le sport. C’est à travers l’éducation physique qu’elle a d’abord accompagné les jeunes sur les chemins du dépassement et de la réconciliation. Cinquante ans plus tard, on connait cette sœur des Saints Cœurs de Jésus et de Marie en Abitibi sous le nom de koukoumesh, « petite grand-mère » en langue anicinabe. Quand elle a croisé des Autochtones pour la première fois, dans les années 1970, sœur Renelle
-


Ces femmes tissées serrées : le Cercle des fermières de Beauceville
La réunion mensuelle du Cercle des fermières de Beauceville commence dans l’effervescence. Louise Boucher, présidente, obtient difficilement le silence. L’ordre du jour est chargé : introduction des nouveaux membres, présentation des activités à venir, dégustation de tire d’érable à la pause. Pour lancer la rencontre, François Proulx, séminariste stagiaire à la paroisse, partage une prière qui se termine par ces mots : Combien de mailles comportera le tricot de ma vie ?Dieu seul le sait.Père, donne-moi le courage de terminer mon tricot afin que tu le trouves digne de l’exposition éternelle. Un peu plus de cent ans après sa fondation, en 1916, le
-


Une soucca en basse-ville
J’ai rencontré Paul en 2011, au moment où j’ai emménagé dans mon premier appartement. Il était mon voisin d’en dessous. Le premier soir, ma laveuse a eu un problème qui a provoqué un dégât d’eau dans son logement. J’étais loin de me douter que dix ans plus tard, je partagerais encore, de temps en temps, un café avec lui. Quand il m’a invitée pour la fête de Souccot, je n’ai pas hésité. Afin de revêtir notre rencontre d’une aura de légalité, j’ai mis mon chapeau de journaliste et me suis rendue sur la rue Bayard, dans la basse-ville de Québec.
-


De l’aide pour vivre
Mise à jour 17/08/20 à 15:00 : Jonathan et ses acolytes lèvent le camp. On a annoncé un plan d’action pour sortir Jonathan du CHSLD et la création d’un groupe de travail afin que Coop Assist puisse voir le jour. J’ai pris connaissance du combat mené par Jonathan Marchand pour les personnes handicapées en octobre 2019. Le Journal de Québec avait titré « Il veut de l’aide pour vivre, pas pour mourir ». On y racontait comment le quotidien de cet homme, qui vit avec la dystrophie musculaire, avait été bouleversé par une pneumonie. J’avais été consternée à la lecture de son témoignage. Sur sa
-


À l’orée d’un camp de réfugiés au Rwanda
Nous avons rendez-vous près de l’église afin de rencontrer les enfants du camp de réfugiés de Gihembe. À l’heure convenue, nous les voyons arriver au loin par dizaines. Sac d’école au dos, ils courent le long du sentier qui longe la colline. Ils sont accueillis à bras ouverts par sœur Épiphanie, qui prend des nouvelles de chacun d’eux. Elle secoue la tête en riant : « Tous les enfants de la paroisse sont venus. » Il m’est impossible de distinguer les réfugiés congolais des enfants rwandais. Spontanément, la marmaille se regroupe, tape des mains et entame des chants. À priori, la scène est
-


Le tsunami et le verre d’eau
Andréane Fleury est infirmière clinicienne. Après avoir hésité, elle a décidé d’aller aider ses collègues dans un CHSLD. Elle raconte ici le travail, les défis et les aberrations qu’elle voit au quotidien. Andréane Fleury est infirmière clinicienne depuis plus de dix ans. C’est ce qu’elle a toujours voulu faire de sa vie. Adolescente, elle se voyait envoyée en zone de guerre pour soigner ceux qui en ont le plus besoin. Après avoir mis de côté ce projet pour prioriser sa famille, elle a travaillé à l’urgence, en soins palliatifs et en pédiatrie. Entre la vie et la mort. Depuis un
-


Une mzungu comme les autres
La veille de notre départ du Rwanda, le père Élie, directeur de l’antenne rwandaise des Œuvres pontificales missionnaires, nous a invités au restaurant. Il voulait nous faire oublier nos tracas en nous faisant découvrir une nouvelle table. Face à notre silence persistant, il a insisté : « Nous allons au restaurant. Ce n’est pas loin. Vous avez compris ?! » Pour tout dire, nous aurions été prêts à jeuner pour nous rendre directement à l’hôtel. Nous voulions nous connecter au wifi le plus rapidement possible afin de prendre les dernières nouvelles. Nos vols de retour étaient prévus le lendemain. Après avoir quitté Kigali, nous
-


Résister avec résilience à la pandémie
Je ne pense pas que ça va bien aller. Je n’ai pas l’enthousiasme de mon conseiller financier qui m’invite à acheter des actions au rabais parce que « c’est une pandémie, pas une crise économique ». J’envie la légèreté de ceux qui célèbrent, malgré tout, l’arrivée du printemps. Je n’ai pas l’optimisme béat, car je pense à tous ces gens qui vont mourir, seuls, face contre terre. À ces malades du cancer qui auraient été habituellement sauvés, mais qui ne pourront pas être opérés à temps. Je pense à mes amis qui viennent de perdre leur emploi et dont l’avenir, à court et
-


L’Afrique, ce grand pays
C’est dans ces termes que la rédaction du Verbe m’a proposé ce petit contrat de journalisme : « On aimerait t’envoyer en Afrique pour faire un reportage sur les projets des Œuvres pontificales missionnaires. » L’anthropologue en moi a ri en se disant « L’Afrique, ce grand pays… ». Comme l’illustre cette carte conçue par le journaliste britannique Mark Doyle, l’Afrique est un continent aussi grand que la Chine, les États-Unis et l’Inde… rassemblés ensemble. On y trouve un milliard d’habitants répartis dans cinquante-quatre pays et parlant près de deux-mille langues. J’ai évidemment voulu en savoir plus. C’est alors qu’on m’a parlé du Rwanda et de ses
-


La féminité peut-elle être toxique?
C’est à travers une recherche critique du phénomène qu’on appelait alors l’hypersexualisation que je me suis identifiée, adolescente, au féminisme. Au gala du démérite organisé entre amis à la fin du secondaire, j’ai même reçu le prix de la féministe frustrée. Been there, done that, got the t-shirt. Jusqu’à la fin de mes études en anthropologie, j’aurai consacré l’essentiel de mes travaux scolaires à l’étude de tout ce qui touche de près ou de loin les industries du sexe. J’en ai acquis la certitude qu’en faisant de la sexualité un objet de commerce, nous vivons dans une culture qui déshumanise les
-


Carnaval de Québec : fête populaire ou bizness touristique?
Au fil des siècles, les carnavals de partout dans le monde ont largement débordé des questions de restrictions alimentaires pour devenir des festivités populaires de grande ampleur. Partout, sauf peut-être chez nous avec le Carnaval de Québec. Le terme Carnaval est apparu en français dans les années 1500 et référait à la période qui se trouve entre l’Épiphanie et le Mardi gras. L’expression a pour origine carnelevare, un mot latin formé de carne « viande » et levare « enlever ». C’est ce qu’on fait (entre autres) durant le carême : se priver viande. Un temps de subversion… On raconte qu’à l’origine, on se réunissait
-


Le « périmètre festif », c’est Cadiz au complet
Cela fait une semaine que nous sommes entrés en Carême. Avant d’entamer ces semaines axées sur la prière, le jeûne et l’aumône, certains auront peut-être profité des jours gras. À Cadiz, d’où je vous écris, le Carnaval est une véritable institution. Quand on m’a demandé si, au Canada, nous avions aussi de telles festivités, j’ai répondu « si… pero no ». Il faut dire que le Carnaval de Québec suscite chez moi une profonde indifférence. J’ai d’ailleurs écrit un article à ce sujet: Quand j’écoutais mes parents se remémorer leurs souvenirs carnavalesques, j’étais intriguée par cet événement dont ils se souvenaient par-delà
-


Qu’est-ce qu’une secte?
La diffusion du film Les éblouis a fait apparaitre l’expression « secte catholique » dans les médias québécois. Plus près de nous, c’est la Famille Marie-Jeunesse, visée par un recours collectif, qui a été taxée de ce terme. Un ancien membre accuse son fondateur d’être un « gourou » qui aurait abusé physiquement, psychologiquement et spirituellement de ses membres. Quant au film, la réalisatrice puise dans ses souvenirs pour y relater le parcours d’une famille au sein d’une communauté du Renouveau charismatique. À travers le regard de Camille, adolescente, on observe les dérives de ce groupe rassemblé autour du personnage du Berger. Au début des années 2000, les
-


« Ok Boomer », une expression virale arrogante?
Ok boomer. L’expression a fait les manchettes au cours des derniers jours après que Chlöe Swarbrick, députée néozélandaise, l’ait utilisée en contexte parlementaire. Au moment où elle évoquait l’urgence climatique, un député a rigolé et s’est immédiatement fait rabrouer : « Ok boomer ». Jetons un œil à ce qui se cache derrière cette locution virale. Les grands médias comme le New York Times et le National Post se sont vite emparés de l’affaire néozélandaise. Ils ont décortiqué les tenants et aboutissants de ce mème internet apparu sur l’application Tik Tok à l’été 2018. « Ok Bommer » est une façon de répondre à ceux qui ridiculisent les

