

Jean-Philippe Marceau
Jean-Philippe Marceau a obtenu un baccalauréat en mathématiques et informatique à McGill et une maitrise en philosophie à l'Université Laval. Il collabore également avec Jonathan Pageau au blogue « The Symbolic World » et à sa chaine YouTube «La vie symbolique».
-
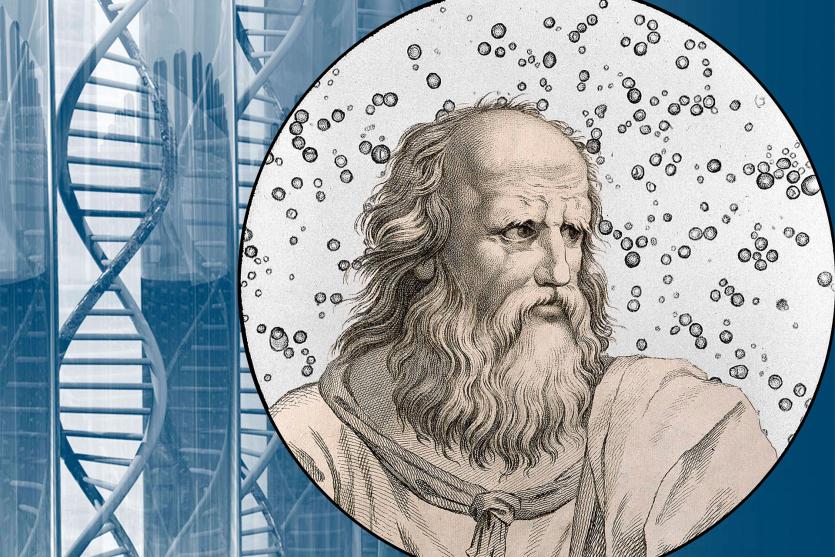
Une découverte qui bouscule les acquis de la science
Michael Levin, biologiste du développement de l’Université Tufts, à Boston, bouscule présentement notre compréhension de la vie et de la cognition. Ses travaux pourraient même avoir un impact majeur dans les prochaines décennies, car ils réfutent empiriquement le matérialisme et remettent l’esprit — et même les esprits — au premier plan. Changement de paradigme en vue.
-
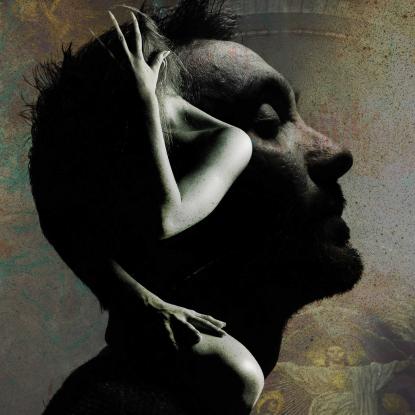
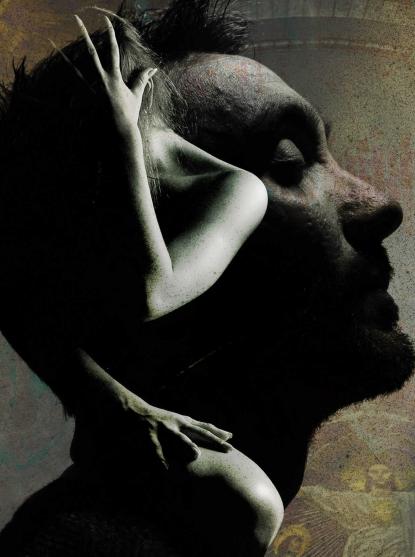
Quand la tête se sacrifie pour le corps
Parce que le corps est un microcosme, c’est-à-dire une petite version du cosmos, il recèle plusieurs symboles qui nous permettent de parler de celui-ci. L’auteur Matthieu Pageau, dans son livre The Language of Creation : Cosmic Symbolism in Genesis, donne un large éventail d’exemples. Probablement prééminente est la relation entre la tête et le corps. Ce symbolisme est tellement primordial qu’il est même utilisé dans les langues naturelles : si on dit que « X est à la tête de Y », on comprend immédiatement ce qu’on veut dire. Tête-corps D’abord, la tête est une médiatrice entre l’esprit et le corps. L’esprit, qui est
-


L’amour d’une mère reflète l’amour de Dieu
Le prêtre suisse Hans Urs von Balthasar est sans doute le penseur qui a poussé le plus loin l’approfondissement de la relation d’amour mère-enfant. Non pas comme psychologue, mais comme théologien. Il s’en est servi pour comprendre la relation entre Dieu et le monde. En psychologie, on reconnait maintenant de façon commune le rôle fondamental de la relation mère-enfant dans le développement de la personnalité de l’enfant. En effet, un nouveau-né n’est essentiellement qu’un chaos désordonné de passions. Il n’est même pas capable de faire la distinction entre lui-même, sa mère et le monde. C’est à travers les interactions avec
-


Comprendre la nature à partir des miracles
Dans son livre Miracles, l’auteur britannique C.S. Lewis défend la plausibilité des miracles chrétiens d’une façon qui pourrait en étonner plus d’un. En effet, au lieu d’évaluer les miracles selon ce qu’on connait de la nature, il essaie plutôt de voir si les miracles chrétiens peuvent éclairer le monde naturel. Ça peut sembler contrintuitif à première vue, mais c’est une stratégie analogue à celle que l’on emploie pour juger de la plausibilité de théories révolutionnaires. C’est ce qui s’est passé, par exemple, avec la théorie gravitationnelle de Newton. Parce que sa théorie fonctionne extrêmement bien, on oublie que Newton
-


Les rituels : science ou superstitions?
Les rituels attirent présentement l’attention en sciences cognitives. Au contraire de ce que certains sceptiques pourraient penser, il s’avère que les rituels sont loin d’être de simples superstitions irrationnelles. En fait, on s’intéresse aux rituels précisément parce qu’ils peuvent nous rendre plus rationnels. Le psychologue Hal Hershfield a étudié un problème précis : épargner pour la retraite. La plupart d’entre nous sont d’accord pour dire que c’est important, mais les statistiques démontrent que peu épargnent réellement. Nous paraissons ainsi irrationnels, d’autant plus que les arguments soutenant la nécessité de l’épargne ne semblent pas vraiment nous affecter. Imagination Ce que Hershfield a
-


Contraception ou méthodes naturelles: quelles différences ?
L’Élise catholique est l’une des seules institutions qui s’opposent aujourd’hui à la contraception. Nombreuses même sont les autres branches du christianisme qui ont cédé à la pression de la société. Ferme dans son enseignement, l’Église permet la planification familiale naturelle par abstinence lors de périodes fertiles. Celles-ci sont détectables assez précisément avec différentes mesures corporelles, telle la température. Comme cette méthode est pratiquement aussi efficace que les contraceptifs artificiels pour prévenir les naissances, on pourrait se demander s’il y a une réelle différence et pourquoi l’Église insiste tant. Déconnexion biopsychologique D’abord, sans même avoir à entrer dans la philosophie ou
-


Saint Jean, l’apôtre caché
Avez-vous déjà remarqué que l’apôtre Jean n’est jamais nommé dans son évangile? Il est toujours désigné comme «le disciple que Jésus aimait». De plus, comme il est fêté le 27 décembre, dans l’ombre de Noël, il est facilement oublié. C’est voulu. En général, saint Jean est un apôtre effacé, mais influent, qui nous enseigne beaucoup sur la contemplation et son importance dans l’Église. Dans les évangiles, Jean apparait souvent en duo avec Pierre, parce qu’ils remplissent des rôles opposés et complémentaires. Pierre est justement la pierre visible sur laquelle Jésus fonde son Église (Mt 16,18). Il mène activement les autres disciples
-

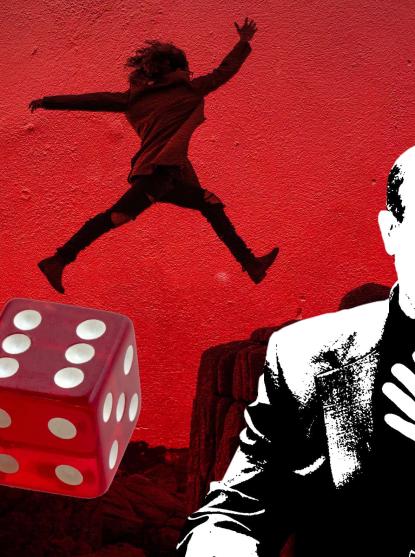
Le christianisme pragmatique de Nassim Taleb
Pourquoi est-ce qu’on raconte des histoires ? Selon le financier et essayiste Nassim Taleb, c’est parce que le monde contient trop de faits. Nous devons donc employer des récits pour le simplifier. Taleb explique cependant qu’en conséquence, nos récits ne tiennent pas compte de l’ensemble du réel et nous exposent à des risques. Comme protection, il recommande de se tourner vers des récits testés par le temps, notamment le christianisme. Taleb explique qu’en général, nous nageons toujours dans une trop grande quantité d’informations. Or, l’information coute cher à obtenir, à conserver et à manipuler. Nous devons donc employer des structures narratives
-


La portée symbolique de l’Halloween
L’automne est déjà bien entamé. Finies, les journées chaudes et les soirées ensoleillées. Dans quelques semaines, il y aura déjà beaucoup de neige… En Occident en 2022, on ne s’en fait pas tant que ça quand l’hiver arrive. Ce sera un peu embêtant, mais on ne manquera pas de nourriture et nous resterons au chaud. Pour nos ancêtres du nord de l’Europe cependant, la situation était plus inquiétante. La récolte avait-elle été assez bonne pour passer à travers l’hiver ? Est-ce que le froid serait trop rude pour nos ainés et nos enfants ? Bref, on entrevoyait la mort arriver. Triduum Comment
-


La Bible, ce manuel de technologie
On ne pense généralement pas à aller fouiller dans la Bible quand on a des questions sur la technologie. C’est bien dommage, parce que ça pourrait grandement nous éclairer.Sans tomber dans un pessimisme naïf, la Bible contient plusieurs récits très lucides sur le lien entre la technologie et l’éloignement de Dieu. Et sans non plus tomber dans un optimisme naïf, la Bible nous montre aussi comment employer la technologie pour emmener concrètement Dieu dans les périphéries. On peut voir apparaitre le lien entre la technologie et l’éloignement de Dieu dès la Genèse. Dans le jardin d’Éden, Adam et Ève n’avaient
-
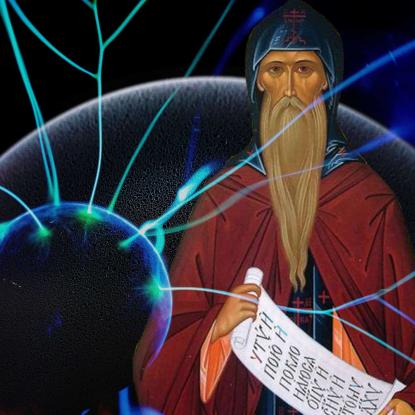
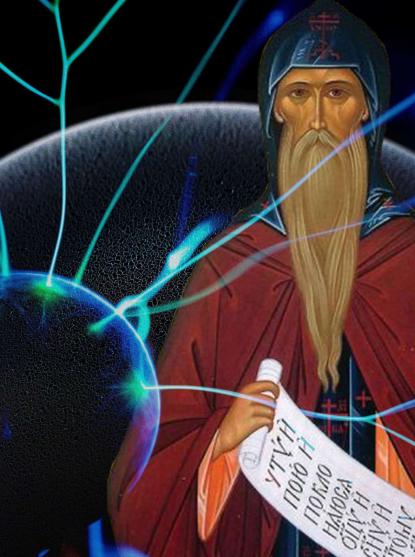
Saint Maxime, précurseur des sciences cognitives
Saint Maxime le Confesseur attire présentement l’attention des sciences cognitives. C’est probablement le sculpteur et conférencier orthodoxe Jonathan Pageau qui est le plus connu pour avoir fait le rapprochement entre le saint et cette discipline scientifique, notamment lors de discussions avec le psychologue Jordan Peterson et le professeur en science cognitive John Vervaeke. À première vue, c’est étonnant, parce que saint Maxime est surtout connu chez les théologiens pour les débats christologiques assez pointus dans lesquels il s’est engagé au septième siècle. En effet, saint Maxime a plus précisément défendu le dogme selon lequel Jésus avait deux volontés (humaine et divine, unies sans mélange ni confusion).
-
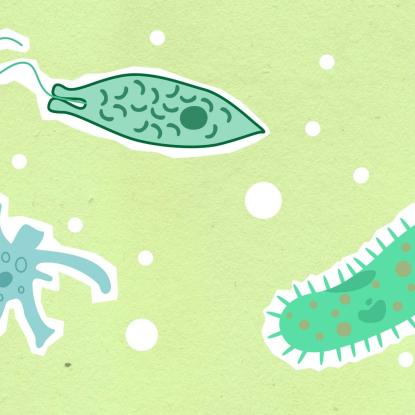

La conscience serait-elle partout ?
Il y a présentement une très vieille idée un peu saugrenue qui fait des vagues en philosophie de l’esprit et en sciences cognitives : une minorité grandissante prend au sérieux le panpsychisme, thèse selon laquelle toute chose serait consciente à un certain degré. Même les molécules de l’écran sur lequel vous lisez ce texte, par exemple, auraient une certaine expérience interne. On ne parle évidemment pas d’expériences très riches, mais quand même ! Si cette position amène ses adeptes à sauter trop vite aux conclusions, elle peut cependant constituer un pont important pour notre culture matérialiste vers une vision du monde plus
-


Le retour de la perception symbolique
L’histoire des deux disciples en route vers Emmaüs reçoit actuellement des échos intéressants en sciences cognitives. On se rappellera ce passage de l’évangile de saint Luc, où deux disciples sont en route après la mort de Jésus et sa disparition du tombeau. Jésus s’approche d’eux, mais ils ne le reconnaissent pas. Ils ne voient qu’un étranger non identifié. Ce n’est qu’après leur avoir expliqué les écritures et avoir partagé du pain avec eux qu’ils réalisent soudainement qui se tient devant eux. L’information que leurs yeux reçoivent n’a pas changé, mais ce n’est pourtant qu’à ce moment que les choses cliquent
-


Sommes-nous des zombies ?
Pourquoi avons-nous produit autant de films, de séries, de livres et de bandes dessinées de zombies dans les dernières décennies ? Pourquoi, avant la crise de la covid-19, des milliers de personnes se déguisaient-elles et se rassemblaient-elles régulièrement un peu partout en Occident pour marcher en hordes de zombies ? Comment ce type de monstre a-t-il pris tant de place dans notre imaginaire ? C’est parce que nous tentons de nous comprendre nous-mêmes. Le zombie est une caricature de notre nihilisme, c’est-à-dire de l’absence de sens que nous détectons dans notre société. Trop souvent, comme le zombie, nous avons tendance à être obsédés par
-


Le matérialisme est mort
Le matérialisme est mort. Le matérialisme philosophique, du moins. C’est-à-dire que le vieux projet de réduire l’humain à la matière a échoué. Dans les sciences cognitives, peu sont ceux qui prennent toujours au sérieux l’idée que l’esprit humain n’est ultimement qu’une affaire de particules physiques. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le matérialisme a perdu tant de plumes. Certaines découlent d’arguments philosophiques, et d’autres de difficultés dans les sciences empiriques. L’expérience de Marie En philosophie, des auteurs comme Frank Jackson et David Chalmers sont devenus célèbres pour avoir défendu des arguments à cet effet. Par exemple, ils nous demandent
