-

Quelques mots après Paris…
Un texte de Laurent Penot Difficile d’écrire sur ce sujet, et en même temps c’est impossible de ne pas en dire un mot sur ce site. Ce sera très partiel, partial, personnel. Quelques jours à peine après la célébration du Christ Roi de l’univers, le scandale est encore plus grand. À moins que la nouvelle ne s’épuise dans une chasse aux sorcières infiltrées en Occident, ou une prétention à nettoyer le monde de ces « parasites »… Comment ce Dieu qui se révèle en Jésus Christ peut-Il permettre ça? Il semble que notre capacité d’indignation s’accroît avec notre capacité à nous identifier
-


La loi, l’Occident et l’islam
Le 18 novembre dernier, quelques jours seulement après les attentats de Paris, le philosophe français Rémi Brague (1) s’est déplacé à Montréal pour y donner une conférence intitulée Three Foundations of Law (2). Le Verbe a assisté pour vous à cet évènement. Provenant de Paris, il n’aura mentionné les récents attentats qu’à la toute fin de son allocution (3). Or il n’avait pas besoin de le faire. Tout le propos que le professeur Brague venait de développer pouvait aider à comprendre cette tragédie, qui ne serait pas tant l’histoire d’une confrontation entre les « valeurs » de l’Occident et la « barbarie » d’un
-


Les grands vents de novembre
Souviens-toi de ma misère et de mon angoisse : c’est absinthe et fiel! Elle s’en souvient, elle s’en souvient, mon âme, et elle s’effondre en moi (Lm 3, 19-20). Le 8 novembre dernier, un article de La Presse + consacré au « discours inspirant » que le cinéaste Bernard Émond a prononcé au Forum sur le patrimoine religieux nous rappelait cette statistique : tous les dix jours, depuis 12 ans, une église disparait du paysage québécois. Notre peuple a donc bazardé ou démoli 432 églises depuis 2003. Si, en tant que chrétien, vous avez comme priorité de maintenir debout l’optimisme, quitte à ce qu’il
-


Les croyants et le bénévolat
Par Daniel Guérin, Ph.D. Contrairement à ce qu’avance une récente étude publiée par Le Monde, les croyants du monde entier contribuent au mieux-être de leur société d’appartenance par leur intense engagement social. En ces années où le terrorisme à connotation religieuse fait la manchette régulièrement dans les médias du monde entier, plusieurs remettent en question le phénomène religieux lui-même, qui serait selon eux une source de divisions et de conflits dans nos sociétés plutôt qu’une source de paix et de concorde comme il devrait l’être normalement. Il est toutefois important de distinguer le phénomène religieux dans son ensemble, de son
-


La liberté selon René Girard
Le 4 novembre dernier, le philosophe René Girard s’éteignait à l’âge de 91 ans. Ce professeur de l’université Stanford en Californie, membre de l’Académie française, aura certainement eu une influence importante pendant toute sa carrière. Toutefois, je crois que cette influence ne fait que commencer. Je ne suis pas un spécialiste de la pensée de Girard. Cependant, par pure coïncidence, j’ai lu un de ses livres pas plus tard que l’été dernier. Dans ce livre qui s’intitule « Le Bouc émissaire », il répond à plusieurs critiques de sa grande thèse sur les processus sacrificiels. J’y ai découvert un philosophe
-


À la défense des maisons bien remplies
Le journal Le Soleil d’hier publiait un « Manifeste pour une maison libre », témoignage d’un homme vivant dans un grand loft vide au cœur du Vieux-Québec – archétype de l’homme postmoderne, dont la liberté déliée peut bien plaire à nos médias et nos élites. L’homme explique comment sa simplicité volontaire – au reste assez sélective et bourgeoise – a affecté son mode de vie et l’aménagement de son logement. Il n’a pas de four, ni de frigo; il dort sur un matelas gonflable; un morceau de bois et quelques coussins lui font office de table et de chaises. Mais il fait
-


Le cri qui vient d’Orient
Du coup de fouet dans le dos je sens la morsure / De ma sueur dans les yeux je sens la brulure / Élohim, Dieu du ciel : entends-tu, ton peuple appelle! Ce vibrant appel d’une chanson d’un film pour enfants a provoqué chez moi un certain trouble. Bien assise et confortablement installée devant mon ordinateur, à réfléchir à des questions passablement théoriques et « élevées », j’ai ressenti une certaine honte, un certain malaise. Cependant, c’est en entendant ce cri déchirant que je me suis sentie retournée. Cet appel, Hans Zimmer l’a mis dans la bouche des esclaves hébreux dans le film
-


Il faut être absolument chrétien
Au terme de sa saison en enfer, dans son poème Adieu, se trouvant face à l’automne qui s’avance, et appréhendant la venue du confortable hiver, Arthur Rimbaud s’exclame : « Il faut être absolument moderne ». Sentence que bien des gens ont prise, à tord et à travers, pour slogan, et dont je ne peux me targuer d’en comprendre vraiment le sens. Mais j’en ai du moins tiré ici une inspiration. En ce jour de la Toussaint, me retrouvant face à la bienheureuse assemblée céleste, cette myriade de myriades toute de blanc drapée, formée de ceux qui viennent de la grande
-


La souplesse des identités partisanes
Cette campagne électorale, d’une longueur inégalée, a certainement permis à tous les Canadiens de se faire une idée du type de gouvernement qu’ils désiraient. Il y a quelques semaines, la Conférence des évêques catholiques du Canada publiait un guide pour aider les citoyens catholiques à voter en conformité avec les exigences de la charité dans notre monde d’aujourd’hui. Quoi qu’il en soit, ce changement de garde sur la Colline nous suggère une certaine santé démocratique. L’élection derrière nous, il serait désolant de considérer notre devoir accompli. En effet, la politique demande une implication et un souci constants. Que ce soit
-


La lutte avec l’ange: réflexions sur l’Occident (2 de 2)
Pour lire la première partie, cliquez ici. Depuis des lustres, l’Occident libéral-libertaire mène sa lutte contre l’ange de Dieu, à l’instar du patriarche Jacob. Et comme il n’a pas encore vécu l’échec cuisant (la blessure à la hanche) qui le guérira de sa démesure (ce que Bertrand Vergely appelle si justement « la tentation de l’homme-Dieu »*), il continue de se poser en juge imperturbable et inflexible de ce que fait et dit l’Église. À l’hostilité des critiques, que les gargouilles médiatiques dégorgent sans cesse, se mêle souvent l’espoir de voir l’Église changer. Au gré des déclarations perçues comme plus ou moins
-


La lutte avec l’ange: réflexions sur l’Occident (1 de 2)
Avec son message de miséricorde et de fraternité vécues, le pape François est parvenu à modifier l’attitude des grands médias occidentaux à l’égard de l’Église catholique. On peut se demander toutefois si la guerre froide médiatique entre l’Église et l’Occident libéral-libertaire ne reprendra pas bientôt. La contribution du pape François à l’assainissement des relations entre ces deux pôles de pouvoir idéologique (pour parler un langage de sciences humaines) est inestimable. Elle ouvre des chemins de dialogue nouveaux et pleins de promesses. Cependant, la détente qui prévaut grâce au pape argentin depuis 2013 pourrait connaitre une fin abrupte après la clôture du
-


Une Église en « révolution permanente »?
Depuis son élection, le pape François ne cesse de surprendre la planète par son style personnel très marqué. Pour employer la célèbre formule du Concile Vatican II, le pape François évangélise gestis verbisque (en parole et en acte). Ces mots, qui furent également prononcés dans le discours de Barack Obama lors du passage du pape François à la Maison Blanche, expliquent à eux seuls l’immense succès, à tout le moins selon nos pauvres lunettes médiatiques, que remporte notre bienaimé pape. Selon moi, ce succès, dont l’accueil très positif des médias américains est un signe éclatant, est dû au fait que
-


L’idéal contemplatif
La révolution au plan théorique, décrite dans mes deux articles précédents (Après Kant, le déluge et Une encyclique politique ?) ne pourra pas se faire sans être accompagnée d’un mode de vie respirant, pour ainsi dire, de celle-ci. Nous devrons donc abattre le mur qui nous détache de notre histoire occidentale et reconsidérer à sa juste valeur une époque depuis longtemps mise au rancart: le Moyen âge. Du point de vue des philosophies dites modernes, l’époque médiévale était un âge sombre où régnaient l’obscurantisme et la superstition et d’où le savoir scientifique et technologique avait eu la plus grande misère du
-

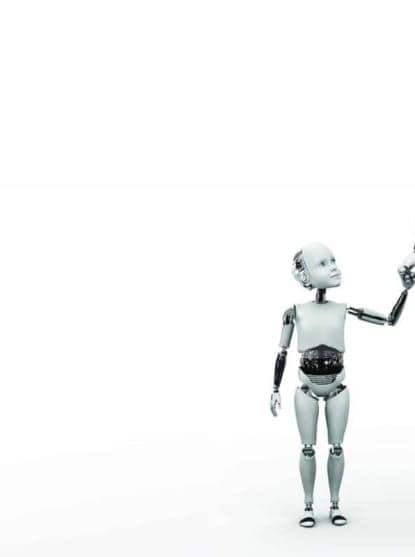
La famille au défi du progressisme
À la veille de la Rencontre mondiale des familles qui se tiendra à Philadelphie en présence du pape, quelques réflexions sur l’idéologie dominante de notre temps : le progressisme, qui entraine un bouleversement des idées et des mœurs relatives à la vie familiale. Dans ce texte : révolution sexuelle des années soixante, militantisme LGBT et « réingénierie » de la famille par l’État. À une époque de domination presque sans partage de la vulgate progressiste dans les médias, le retour au fondement philosophique de la pensée semble être la seule réaction saine de l’intelligence et de l’instinct devant les dérives déconstructivistes et utopistes des
-


Après Kant, le déluge
Au Québec, on le sait, on trouve toujours que l’été a passé trop vite. C’est d’autant plus vrai si l’on considère l’immensité de la matière à assimiler si nous désirions nous atteler à la vision écologique du pape François telle que présentée dans son encyclique Laudato si’. De la même manière qu’Evangelii Gaudium peut-être considérée comme le programme pastoral du pape argentin, Loué sois-tu Seigneur pourrait très facilement être qualifiée de programme « séculier » en ce sens qu’elle est destinée à tous les hommes et femmes de bonne volonté. Comme j’en faisais mention dans mon article précédent, ce haut document magistériel
-


Une encyclique politique ?
Cela fait cinq ans que l’encyclique Laudato Si du pape François est parue. En 2015, vaticanistes et journalistes politiques s’en donnaient à cœur joie en faisant des projections et des analyses de la future visite du souverain pontife en sol américain. Mais il semble que plusieurs d’entre eux soient passés à côté du message essentiel de cette encyclique. Bien sûr, la tournée américaine de septembre 2015 avait de quoi attirer l’attention. Il s’agissait de la première visite d’un pape sud-américain aux États-Unis et qui, de surcroit, est reconnu pour ses positions très critiques face aux idéologies néolibérales. Après un court
-


Les fondements de l’islam
Dans le contexte social actuel, les polémiques autour de l’islam sont légion. Elles touchent le djihad, le halal, la charia, le voile, la construction de mosquées… D’un débat l’autre (comme dirait Louis-Ferdinand Céline) chacun se fait sa petite idée. Mais au-delà des divers débats sur l’un ou l’autre aspect de cette religion, d’aucuns se questionnent sur son essence, qui n’apparait pas clairement, puisque, dans un contexte de fort clivage idéologique, des discours contradictoires s’affrontent et créent la confusion. Beaucoup en effet perçoivent l’islam comme une menace à notre civilisation, tandis que d’autres le voient comme un enrichissement à la trame
-


Les limites de la Révolution tranquille
Depuis son élection le 7 avril 2014, le gouvernement libéral de Philippe Couillard a concentré ses efforts sur l’atteinte du déficit zéro. Certains y ont vu une décision responsable et nécessaire en vue de garder la bonne cote de crédit du Québec. D’autres, l’agenouillement du pouvoir politique devant le pouvoir financier. De mon côté, j’ai l’impression que nous sommes, dans les deux cas, dans une optique de politique partisane se refusant à regarder la réalité dans toute sa profondeur. En effet, il est impossible de comprendre la situation actuelle du Québec sans la remettre dans son contexte historique. Plusieurs commentateurs
-


Des milliers d’Ukrainiens déplacés
Alors que l’attention médiatique internationale est tournée vers les combats – non moins tragiques – ayant cours au Moyen-Orient, le drame de milliers de familles déplacées se poursuit en Ukraine. Selon l’ONU, il y aurait plus d’un million de personnes déplacées à l’intérieur du territoire ukrainien, tandis qu’environ 500 000 autres ont plutôt cherché refuge dans les pays limitrophes. Si le cessez-le-feu signé plus tôt cet hiver ressemble à un bout de papier sans conséquence sur le terrain, c’est que les forces en présence poursuivent les combats, accroissant du coup le nombre de victimes civiles et militaires. Appels à l’aide Dans
-


Les racines de la social-démocratie
La politique québécoise est actuellement le théâtre de nombreux débats sociaux ayant pour objet les politiques de retour à l’équilibre budgétaire du gouvernement. Ces politiques « d’austérité » – certains préfèrent l’euphémisme « rigueur » –, justifiées ou non, opèrent actuellement une transformation plus large de l’État québécois, ce qui n’est pas sans conséquence pour le lien social. Afin d’examiner cette transformation, un rappel préalable des fins de l’État en général, puis des fins de l’État québécois en particulier, s’impose. Les fins de l’État D’un point de vue chrétien, le Compendium de la doctrine sociale de l’Église nous informe d’abord que « la personne humaine
-

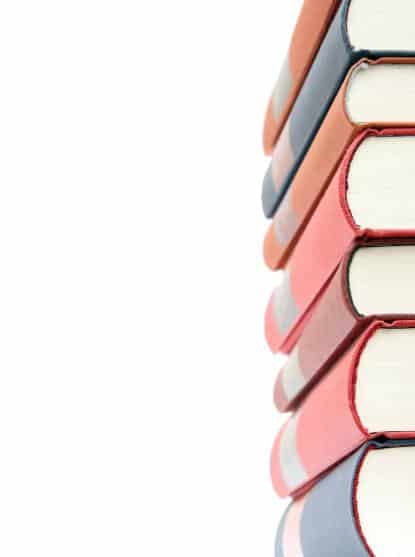
Religion et identité: « ÉCR » dix ans plus tard
Un texte de Pierre Cardinal, directeur de la revue En son Nom – Vie consacrée aujourd’hui Un long chapitre a été tourné le 19 mars dernier, alors que la Cour suprême rendait une décision favorable au Collège Loyola dans la cause qui l’opposait au Gouvernement du Québec. L’institution privée anglophone réclamait le droit d’enseigner le cours Éthique et culture religieuse dans une perspective catholique. C’est en 2005 qu’avait été annoncée la mise en place d’un cours axé sur l’enseignement culturel des religions doublé d’un volet éthique. Dix ans plus tard, retour sur un débat où se mêlent religion et identité.
-

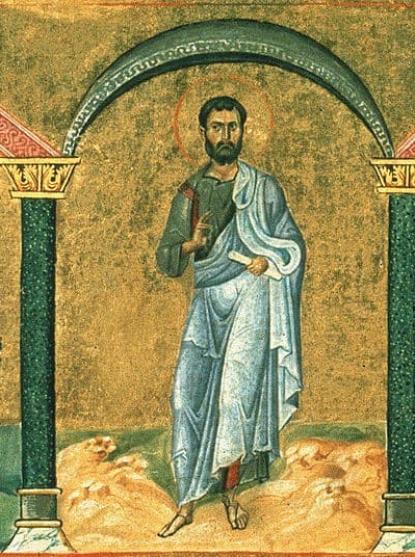
Le diaconat : l’appel à la charité et témoignage pour l’unité (1ère partie)
Par Daniel Guérin, catéchète, paroisse Saint-Paul, Gatineau (Aylmer), Québec. Aux sources de la mission: le ministère diaconal à la lumière des textes fondateurs des Actes des apôtres. Cette contribution se veut une réflexion sur le contexte de la mission dans lequel le diaconat fut mis en place au sein de l’Église primitive (cf. Ac 6). À partir de certains textes fondateurs des Actes des apôtres, des pistes d’action et de réflexion seront ouvertes aux diacres d’aujourd’hui qui souhaitent relever les défis actuels de l’évangélisation dans nos sociétés occidentales marquées par une importante sécularisation. (1) Il est question ici de revisiter
-
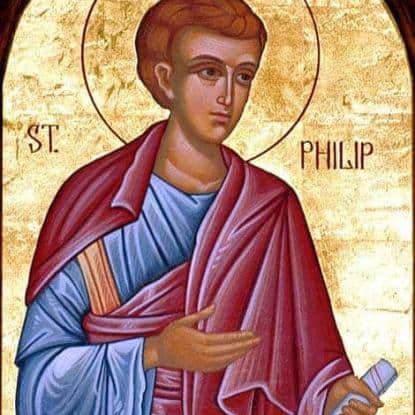
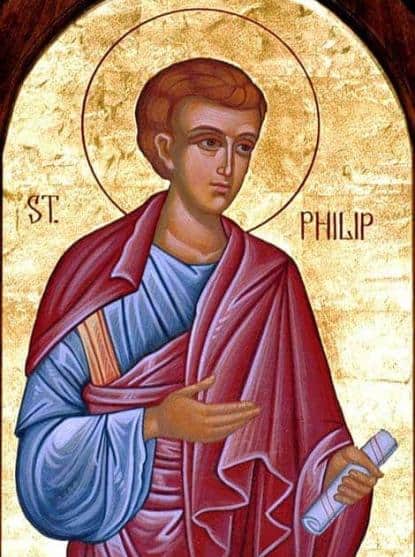
Le diaconat : l’appel à la charité et témoignage pour l’unité (2e partie)
Par Daniel Guérin, catéchète, Paroisse St-Paul, Gatineau (Aylmer), Québec. Accédez à la 1ère partie de ce texte ici. Aux sources de la mission: le ministère diaconal à la lumière des textes fondateurs des Actes des apôtres Cette contribution se veut une réflexion sur le contexte de la mission dans lequel le diaconat fut mis en place au sein de l’Église primitive (cf. Ac 6). À partir de certains textes fondateurs des Actes des apôtres, des pistes d’action et de réflexion seront ouvertes aux diacres d’aujourd’hui qui souhaitent relever les défis actuels de l’évangélisation dans nos sociétés occidentales marquées par une
-


Rémi Brague et Le règne de l’homme
Il y a un siècle déjà Chesterton écrivait : « Supprimez le surnaturel, il ne reste que ce qui n’est pas naturel. » Ce à quoi Rémi Brague pourrait aujourd’hui ajouter: « Supprimez ce qui dépasse l’homme, il ne reste plus d’homme. » Telle est, grossièrement résumée, la thèse qu’il défend dans son dernier ouvrage, Le Règne de l’homme, sous-titré : Genèse et échec du projet moderne. Titre paradoxal, puisque ce « règne de l’homme » que le philosophe Francis Bacon (1561-1626) souhaitait que l’on réalisât, correspond précisément à la disparition de l’homme. Émancipation totale? Le « règne de l’homme », c’est son émancipation par rapport à tout ordre qui lui
Page précédente

